Entretien avec Gérald Wittock « Le féminisme a du bon pour autant qu’il respecte l’hominisme »

Gérald Wittock est un auteur-compositeur. Né à Rome en 1966, il voyage depuis son plus jeune âge, ce qui lui permet de parler couramment six langues. En 1992, il crée sa maison d'édition et de production audiovisuelle. En 2005, il monte son propre label, NO2 Records. En 2011, il s'installe à Marseille et il se consacre à l’écriture, après avoir parcouru le monde. Je l’ai rencontré au Petit-Benoît, à la place habituelle de Marguerite Duras. On a discuté de son premier roman, Le Diable est une femme (Editions Vérone, 2022), ce qui nous a entraîné sur les pentes dures de l’idéologie néo-féministe actuelle, et de cette curieuse époque de revendications en tous genres et de diabolisation. Il en est ressorti cet entretien qui est paru dans Boojum. Il est désormais en accès libre dans l’Ouvroir.
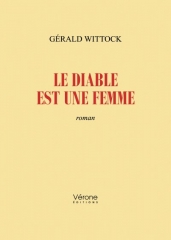 Marc Alpozzo : Votre livre est un roman divisé en quatre nouvelles, et dont le titre est pour le moins cocasse, et surtout un brin provocateur, Le Diable est une femme. On imagine sans mal le clin d’œil à l’idéologie dominante et néoféministe, qui cherche systématiquement à discréditer le « mâle blanc dominant de cinquante ans » auquel on affuble tous les maux modernes. Pourquoi ce choix ?
Marc Alpozzo : Votre livre est un roman divisé en quatre nouvelles, et dont le titre est pour le moins cocasse, et surtout un brin provocateur, Le Diable est une femme. On imagine sans mal le clin d’œil à l’idéologie dominante et néoféministe, qui cherche systématiquement à discréditer le « mâle blanc dominant de cinquante ans » auquel on affuble tous les maux modernes. Pourquoi ce choix ?
Gérald Wittock : Je ne me retrouve pas dans cette société qui fait progressivement marche-arrière et qui anéantit les avancées importantes des idées progressistes et libertaires que nos parents ont défendues à coups de pierres en mai 68. Sans faire de la philosophie politique, que je laisse aux spécialistes du genre, bien plus érudits que moi, je me bats, avec comme arme le second degré et la légèreté de ma plume, contre l’autoritarisme de l’État et d’une Presse à sens unique, qui le sert en épousant et promouvant l’idéologie d’une minorité bienpensante, au mépris de la majorité silencieuse.
Le féminisme a du bon, pour autant qu’il respecte l’hominisme. Je rejoins Joseph Déjacque dans son pamphlet De l’Être-Humain mâle et femelle - Lettre à P.J. Proudhon publié en 1857 : « L’émancipation ou la non-émancipation de la femme, l’émancipation ou la non-émancipation de l’homme : qu’est-ce à dire ? Est-ce que – naturellement – il peut y avoir des droits pour l’un qui ne soient pas des droits pour l’autre ? Est-ce que l’être-humain n’est pas l’être-humain au pluriel comme au singulier, au féminin comme au masculin ? Est-ce que c’est en changer la nature que d’en scinder les sexes ? Et les gouttes de pluie qui tombent du nuage en sont-elles moins des gouttes de pluie, que ces gouttes traversent l’air en petit nombre ou en grand nombre, que leur forme ait telle dimension ou telle autre, telle configuration mâle ou telle configuration femelle ? ».
Je me sens néo-féministe, au sens strict du terme, mais pas pour ses dérives qui conduisent à la haine des hommes et desservent les femmes, puisque j’accepte les différences biologiques entre les sexes, et que je vénère leur complémentarité plutôt que de prôner une quelconque égalité ou supériorité d’un sexe sur l’autre. Je pourrais également me qualifier de néo-antiraciste, puisque je respecte les différences biologiques entre les races, et que j’épouse leurs richesses culturelles et sociales plutôt que d’imposer une illusoire et appauvrissante supériorité de couleur.
Mais je ne cherche nullement à discréditer qui que ce soit en général. Surtout pas le mâle blanc dominant de cinquante ans sur qui, effectivement, la société actuelle, hypocrite et bienpensante, n’hésite pas à tirer. Et pas à blanc, à boulets rouges, surtout quand il a été blessé. Les médias, et donc ceux qui les suivent et les font vivre, retrouvent un malin plaisir ancestral à le lapider sur la place publique. Pourquoi ne juge-t-on pas ces hommes, ou ces femmes, en respectant la présomption d’innocence, entre les quatre murs d’un Tribunal ? Pourquoi tant de publicité gratuite aux dépens des suspects, des coupables et, inévitablement, des victimes (qui parfois s’enrichissent de cette nouvelle et inespérée célébrité) ? Le bourreau, la Presse encouragée par ses lecteurs avides de cancans, ne devient-il pas criminel par la même occasion, en détruisant inutilement la vie d'un homme (ou d'une femme) et de sa famille, en les jetant ainsi en pâture ?
Fort heureusement, je ne traite que de certaines individualités, qui se sont comportées en véritable diablesses, et sur qui je me permets de cogner, en respectant leur anonymat, par lâcheté ou bienveillance, avec des mots bien choisis, qu’elles seront les seules à savoir qu’ils leur sont adressés.
M. A. : Vous m’avez dit que vous veniez de l’univers de la musique, ce qui se retrouve bien dans la musicalité de votre style, ainsi que le métier de votre personnage principal. Votre roman commence par les 7 vies des chats, ce qui vous permet d’introduire les 7 villes que traversera votre narrateur, de Rome à Paris, en passant par Anvers, Marseille ou encore Londres. Peut-on dire que votre roman soit autobiographique ?
G. W. : Quel roman n’est pas autobiographique ? En écrivant Le Diable est une Femme, j’ai voulu parler de l’Amour, en latin, l’Amor. Et quand on pense, qu’on écrit ou l’on dit « Je t’aime.», on se met d’abord et inévitablement en avant. Autant le premier Acte s’attarde sur le « Je», la vie d’un héros qui me ressemble étrangement et qui porte mon prénom et son diminutif, autant le deuxième Acte est son contraire, axé sur le « t » apostrophe, le « toi » qui m’habite et que j’abrite, ou plutôt, l’image reflétée à travers son miroir. Un antihéros qui ne me ressemble pas et qui ne partage ni ma vie, ni ma religion, ni mes préférences sexuelles. Et pourtant, nous sommes complémentaires et nous nous allierons dans une cellule de la prison des Baumettes, à Marseille. C’est le yin et le yang. La complémentarité que l’on retrouve dans toutes les différences et que l’on essaye de porter en soi. Dans le troisième Acte, je recherche la fusion du mot « aime ». Je m’amuse à inverser les sexes, les complémentarités, afin d’essayer de mieux les unir et de comprendre l’être humain. Au bout du compte (et du conte), la femme n’est pas meilleure que l’homme. Ils s’attirent l’un à l’autre et se repoussent comme des aimants, comme des amants, en fonction de leur polarité du moment. La femelle et le mâle cohabitent sur terre, comme le bien et le mal. Enfin arrive le quatrième et dernier Acte. Il symbolise la souffrance et le diable. Le point final. La mort. La boucle est bouclée. Je (Acte I) t’ (Acte II) aime (Acte III) . (Acte IV).
M. A. : Vous nous racontez les affres de l’amour rencontrés par votre narrateur avec Eva, ce qui rappelle inévitablement la première femme de l’humanité, mais d’autres femmes défilent dans ce récit. Les femmes et les villes alternent au point de croire que ce texte est une ode au féminin, n’est-ce pas ? Peut-on dire, que vous partagez la thèse de Romain Gary qui préférait le féminin au féminisme ?
G. W. : Vous me flattez en me renvoyant à ce grand homme et à ce grand écrivain, l’unique à avoir remporté à deux reprises le prix Goncourt. Et vous avez mis le doigt sur la plaie. La tentation de la pomme qu’on ne peut refuser. La quête de l’amour en parcourant les femmes et donc forcément les villes, les métiers, les rôles et les vies. Oui, je préfère le féminin au masculin, le féminin au féminisme, le féminin envers et contre tout. Et mon obstination m’aura servi. J’ai fini par retrouver la Femme, celle de mes rêves.
Chercher l’amour, c’est chercher la vie, ou plus précisément, donner un sens à sa vie. Que l’on doit dès la conception, et pendant les neuf mois qui ont précédé notre naissance, à la Femme. Nous sommes en elles avant même d’avoir commencé à respirer. Pas étonnant que l’on cherche constamment à retourner en elles. Et le coup d’envoi, notre venue au Monde, n’est-il pas précisément orchestré et sifflé par la femme ?
Puisque l’homme est incapable d’enfanter, en cherchant l’âme sœur, ne cherche-t-il pas à revivre sa naissance, non plus en spectateur, mais en acteur ?
Dans ce récit, j’ai posé quatre actes qui ont tous débouché sur une multitude de rencontres amoureuses ou chargées d’émotions fortes, pour arriver enfin à accoucher de ce premier roman. Un autodafé autobiographique ?
M. A. : Les histoires d’amour se succèdent dans votre roman, mais sont sans lendemains, les femmes le sont tout autant. Cette recherche de l’âme sœur, désespérante et aporétique sur la fin, laisse songeur. Qu’avez-vous voulu nous dire ? Que la femme n’est que le plaisir phallocrate de l’homme, à l’image de cette phrase si célèbre de Lacan, qui disait que « La femme n’existe pas », lorsqu’on la mal comprise, ou plutôt que LA femme n’existe pas, quand on la confond avec la jouissance phallique, lorsqu’on a bien compris Lacan, puisque cliniquement la jouissance féminine ne peut s’y réduire. Est-ce là encore une ode à la femme, la femme introuvable pour l’homme qui se laisse enfermer dans une quête de la jouissance masculine ?
G. W. : Dans cette quête de l’âme sœur, l’on ne peut parler uniquement d’aporie, car cette contradiction insoluble en apparence, la recherche de l’Amor, se résout, si ce n’est pendant la vie, inéluctablement à travers la mort. Pour Gérald, dans La Vie ne dure que 7 Villes, la chasse désespérée finit à Marseille, au bout de 25 ans, puisqu’il y retrouve son âme sœur. Mohammed, dans Antipodes, l’a très vite rencontrée dans les bras de son meilleur ami, mais il ne s’en est rendu compte que trop tard. L’on pourrait penser que tomber amoureux d’un transsexuel est à l’opposé de l’ode à la femme, introuvable pour Mohammed qui se laisse enfermer dans sa quête de la jouissance masculine, et se réduit à devenir un criminel, assassin de l’amour impossible, maculant de sang les draps de son bienaimé, comme le linceul enveloppant le fils de Dieu que nous, ses frères, avons crucifié. Dans La Mutation, c’est grâce à l’assassinat également, celui du leader des hoministes, que l’impossible trio formé par César, Fanny et Marius, pourra finalement exister. Le couple, Marius et Fanny, poursuivront ainsi l’œuvre de leur César chéri. Et dans le dernier Acte, Le Diable est une Femme, c’est cette même faucheuse qui sépare les deux amants en herbe, Gabrielle et Michel. Alors on est en droit de se poser la question : qui de la vie, cette quête désespérante de l’âme sœur, ou de la mort, est la plus aporétique ?
Effectivement, je rejoins le Docteur Jacques Lacan quant à la primauté du phallus parmi les autres signifiants. Mais cela ne fait pas de moi une personne phallocentrée ni un antiféministe. « Les hommes croient avoir le phallus quand les femmes croient en manquer, alors que personne ne le possède et que tous le désirent. » Le phallus est donc le signifiant du manque. Il ne doit pas être confondu avec l’organe, le membre qui pend bêtement entre nos jambes, et ne jamais être réduit à sa plus simple expression, le pénis. LA femme n’existe pas si on la confond avec la jouissance phallique. La femme et ses multiples jouissances sont bien plus complexes que notre coït binaire, et les résoudre au simple plaisir phallocrate de l’homme qui se croit supérieur, ne nous mène nulle part, et nous éloigne assurément de notre quête éternelle.
M. A. : Le diable est une femme, ou LA femme, si l’on essentialise la femme, et que l’on compare son essence à la domination supposée de l’homme. Que pensez-vous des combats modernes des courants néoféministes, portées aujourd’hui par Alice Cuffin, qui dit vouloir supprimer les hommes, dans son livre Le génie lesbien, (Grasset, 2020), ou Pauline Harmange, qui prétend détester les hommes, dans un livre qui porte le même titre, Moi, je déteste les hommes, (Seuil, 2020.) Ne pensez-vous pas que nous revivons-là un retour de la guerre des sexes ?
G. W. : Ah bon, parce que vous pensiez réellement qu’elle était finie, cette guerre des sexes ? Ce serait comme affirmer qu’il n’y a plus jamais eu de guerre après la seconde guerre Mondiale. Faut-il qu’un Poutine reprenne l’Ukraine pour que tout d’un coup, l’on prenne conscience des différentes visions géopolitiques des uns et des autres ? Et les guerres en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, elles comptent pour des prunes ? Loin des yeux, loin du cœur, c’est ça ? Alors oui, une Alice Coffin est là pour nous rappeler que le diable peut également prendre la forme d’une lesbienne. Réduire le génie des femmes à une orientation sexuelle, est un crime de guerre contre les sexes et devrait être jugé devant le tribunal de Lahaie. Qui d’autre que Brigitte pourrait donner son avis éclairé sur la question ?
Plus sérieusement, je comprends la haine et la révolte endurée pendant de longues années par les femmes ou les hommes qui n’ont pas pu vivre librement leur amour, leur sexualité, condamnés par une société qui n’était pas à sa place, soucieuse du qu’en dira-t-on, et qui s’infiltre avec son venin mortel dans la sphère privée de l’individu. L’amour consentant ne regarde que les personnes concernées. Qui sommes-nous pour oser les juger ? Mais réduire le génie à une attirance ou à une préférence sexuelle me semble tout aussi débile que condamner cette même préférence ou attirance sexuelle.
Faut-il, comme le pense Pauline Harmange, défendre la misandrie en réponse à la misogynie ? La sororité serait-elle la seule réponse appropriée aux fraternités ou autres mouvements franc-maçonniques strictement limités aux hommes ? Ne serait-ce pas répondre uniquement par les armes ? Œil pour œil, dent pour dent : les américains nous ont montré, à Nagasaki et Hiroshima, comment cela allait finir. Notre monde politique et les médias qui donnent raison à ces ultra-féministes, veulent-ils vraiment la guerre nucléaire, cette fission qui viendrait définitivement séparer les hommes et les femmes ?
M. A. : Lorsqu’on lit votre roman, désenchanté à propos de l’amour entre les hommes et les femmes, femmes peut-être trop libérées et rebelles aujourd’hui pour être réduites à l’âme sœur d’un homme en recherche d’un amour phallique, et, lorsqu’on observe la société moderne et ses nouvelles lunes féministes et obsessions androphobes, ne croyez-vous pas que nous vivons un séparatisme nouveau, un séparatisme qui verra les hommes et les femmes vivre face à face, alors qu’hier encore, ils vivaient côte à côte ? Est-ce le message que livre votre roman ?
G. W. : J’espère que non. L’amour phallique est ancestral. Il remonte à la nuit des temps. Pour les hommes, il représente nos mères qui nous ont portés avant même notre naissance, et cet irrésistible besoin de retourner en elles. Pour les femmes qui ont accouché, l’énorme vide laissé en elles, et le besoin incommensurable de le combler. Dos à dos, face à face, côte à côte… peu importe la position qu’ils adoptent : les femmes et les hommes sont heureusement condamnés à vivre ensemble. Il faut l’union des deux pour créer la vie. Alors, tant qu’il y aura un phallus, un manque, ils chercheront à s’unir. Et comme on dit si bien dans le plat pays d’où je viens : « L’Union fait la Force ! »

Gérald Wittock et son attachée de presse Guilaine Depis
Gérald Wittock, Le diable est une femme, Vérone éditions, 2021.