Entretien avec Charles-Éric de Saint Germain. Sombrons-nous dans la barbarie ?

Face au déferlement de violence qui a secoué l’actualité française depuis le début de l’année, j’ai rencontré, pour rendre compte des multiples démissions des gouvernements successifs de ces quarante dernières années, mais aussi de la pensée elle-même, le philosophie Charles-Éric de Saint Germain afin qu’il nous propose un éclairage, quelques clés et pourquoi pas quelques solutions quant à notre modernité et ses dérives idéologiques, ses dictats relativistes. Né en 1967, est ancien élève de l'ENS Saint Cloud-Fontenay-Lyon, Charles-Éric de Saint Germain est agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de philosophie allemande (Kant et Hegel surtout), protestant de confession baptiste, il est aussi passionné pour la théologie et les Écritures saintes. Il enseigne la philosophie en classes préparatoires (Hypokhâgne et Khâgne) et il est l’auteur d'une dizaine d'ouvrages consacrés majoritairement à la philosophie, parmi lesquels on trouve un texte volumineux et dense, La défaite de la raison. Essai sur la barbarie politico-morale contemporaine paru chez Salvatore en 2015, courageux sans être vindicatif, et qui est une sorte de lecture critique de notre époque. Il est surtout la mise en lumière de l’effondrement de la raison d’un point de vue politico-moral. Tout en soulignant le refus des élites de réfléchir à l’individualisme forcené et dévastateur (féminisme exacerbé, Queer Theory, hédonisme désenchanté, etc.) ou de régler les questions semble-t-il coincées dans une vision historiciste dépassée des dogmes modernes (égalitarisme, négation de la liberté de conscience, laïcisme dogmatique, etc.) ce texte pose un diagnostic sans appel, et sous la forme d’un cri d’alarme, quant à notre crise morale et spirituelle. Aussi, l’auteur affirme que la décivilisation secouant la « civilisation européenne » pourrait nous être fatale si l’on ne renoue pas rapidement avec nos racines judéo-chrétiennes. Son texte, puisant dans des sources d’inspiration diverses, rappelle ou s’inscrit dans le sillage d’autres lectures pour notre temps, notamment La défaite de la pensée d’Alain Finkielkraut (1987), La Barbarie de Michel Henry (1987), La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne de Jean-François Mattéi (1999), tout en proposant une réflexion renouvelée sur la barbarie qui nous guette. Je l’ai longuement questionné, et, ses réponses, souvent étendues et denses, demandent avant tout une régularité dans la lecture, et un effort de la pensée, afin d’en saisir la profondeur et la pertinence. De fait, cet entretien-fleuve est à l’opposé du prêt-à-penser de notre époque, et loin de la lecture brève et rapide souvent de mise aujourd’hui dans la presse et l’édition. Je me suis refusé de réaliser la moindre coupe. Aussi, cela demandera de la part du lecteur la patience et la constance du métronome dans l’effort intellectuel nécessaire pour comprendre la modernité dans laquelle il vit, les influences et les impasses d’une époque, la sienne. Cet entretien est paru dans Entreprendre. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
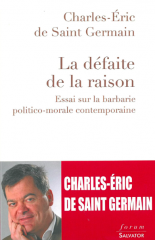 Marc Alpozzo : En 1987, Alain Finkielkraut publie La défaite de la pensée. En 2015, vous publiez La défaite de la raison. Vous sous-titrez ce livre Essai sur la barbarie politico-morale contemporaine[1]. Vos mots sont très forts. Si l’on ouvre Le Larousse, on y trouve deux définitions essentielles : « Caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est barbare, cruel, féroce » ainsi qu’« État d'une société qui manque de civilisation. » Le philosophe Jean-François Mattéi a publié en 1999 un ouvrage intitulé La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne[2]. Quand on vous lit, il nous semble que vous prolongez ses thèses, mais en vous focalisant sur l'abandon de nos principes politico-moraux, ce qui nous fait retomber dans la barbarie. L’actualité récente (assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard et l’assassinat en bande organisée du jeune Thomas lors d’un bal de village à Crépol) peut nous laisser penser que la décivilisation évoquée par Macron est un abandon avec nos principes fondamentaux. Je sais que vous êtes agrégé et docteur en philosophie, mais aussi un chrétien engagé. Pouvez-vous nous expliquer quelle est cette coupure et de quoi cet abandon est-il le nom ?
Marc Alpozzo : En 1987, Alain Finkielkraut publie La défaite de la pensée. En 2015, vous publiez La défaite de la raison. Vous sous-titrez ce livre Essai sur la barbarie politico-morale contemporaine[1]. Vos mots sont très forts. Si l’on ouvre Le Larousse, on y trouve deux définitions essentielles : « Caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est barbare, cruel, féroce » ainsi qu’« État d'une société qui manque de civilisation. » Le philosophe Jean-François Mattéi a publié en 1999 un ouvrage intitulé La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne[2]. Quand on vous lit, il nous semble que vous prolongez ses thèses, mais en vous focalisant sur l'abandon de nos principes politico-moraux, ce qui nous fait retomber dans la barbarie. L’actualité récente (assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard et l’assassinat en bande organisée du jeune Thomas lors d’un bal de village à Crépol) peut nous laisser penser que la décivilisation évoquée par Macron est un abandon avec nos principes fondamentaux. Je sais que vous êtes agrégé et docteur en philosophie, mais aussi un chrétien engagé. Pouvez-vous nous expliquer quelle est cette coupure et de quoi cet abandon est-il le nom ?
Charles-Éric de Saint Germain : L'abandon des principes politico-moraux que je dénonce dans mon livre me semble inséparable d’une phase historique, celle que nous vivons, qui est en train de rompre avec les valeurs qui ont rendu possible la civilisation européenne. La civilisation européenne s’est en effet construite sur la base d’un dialogue entre trois cultures (la culture grecque, Athènes ; la culture romaine, Rome ; la culture judéo-chrétienne : Jérusalem) qui ont rendu possible l’émergence de valeurs universelles. Or un premier aspect de cet abandon réside dans le fait que cette même Europe est en train de renier le triple héritage de Rome, d’Athènes et de Jérusalem, pour promouvoir une humanité nouvelle, arrachée à tous ses particularismes, désormais « indifférenciée » ou « unisexe », pour reprendre une expression de Jacques Attali. On vit aujourd’hui dans la confusion de l’indistinction. Par exemple, on confond égalité et identité, comme si l’émancipation de la femme ne pouvait se faire qu’en neutralisant la différence sexuelle et en niant la complémentarité des sexes, alors que cette différence sexuelle est pourtant la source de la vie, et ce qui fait toute la richesse de l’humanité (dont Lévi-Strauss rappelait qu’elle « se décline au pluriel ») et l’on ne conçoit l’émancipation humaine et la liberté que par arrachement à un « donné », que ce donné soit notre identité nationale, culturelle, sociale, biologico-sexuelle, etc. Nul doute que la mondialisation tend à accélérer ce processus d’uniformisation, mais elle conduit à un déracinement et à une perte complète de repères au profit d’une confusion générale qui n’est pas sans évoquer le « mythe de Babel », où l’homme tente de rejoindre Dieu par ses propres forces, dans l’illusion qu’en s’arrachant à tout ce qui le particularise, il ne sera plus limité par aucune barrière ou frontière, qu’elle soit ethnique, sexuelle, culturelle etc. C’est là le « fantasme de toute-puissance » qui anime l’homme moderne : devenir Dieu par lui-même (ce que l’on voit aussi dans le transhumanisme, même si je n’en parle pas directement dans mon livre). Mais en niant sa dimension « incarnée » pour instaurer une humanité uniformisée (songez à la théorie du Genre, dans sa version Queer), et qui ne soit plus divisée par tout ce qui pourrait particulariser cette humanité (le sexe, l’ethnie, la langue, la culture, etc), l’homme se prend désormais pour un ange (on sait que les anges n’ont pas de sexe), il tend à oublier sa finitude, qui le rappelle à ses limites. Pascal disait que « qui veut faire l’ange fait la bête ». Je crains que ce « changement de civilisation », pour reprendre l’expression employée par Mme Taubira lors de la légalisation du mariage homosexuel, ne puisse en réalité que conduire l’humanité à retomber dans une forme de chaos indifférencié, dans ce tohu-bohu originel qui précède les limites que Dieu impose à sa création, en distinguant et en séparant. Ces distinctions et séparations sont nécessaires, car ce sont elles qui nous constituent en tant que créatures incarnées, dotées d’une identité spécifique. La négation des limites, des frontières, des déterminations, qui semblent être le propre de notre humanité émancipée, ne permettra pas une véritable réconciliation des hommes entre eux, mais elle s’apparente à une fusion dans une totalité indifférenciée qui conduit à la mort là où le judéo-christianisme prêche une communion entre les hommes qui n’abolit pas leur spécificités propres, leurs « distinctions », mais les relativise au profit d’une identité plus profonde, notre identité en Christ, celle qui, moyennant la foi et régénération par le Saint-Esprit, fait de nous des frères en Christ.
En outre, un deuxième aspect de cet abandon réside dans l'hédonisme de la société de consommation, qui tend à la marchandisation de toutes les relations humaines. On le voit notamment à travers les perspectives ouvertes par la GPA et la PMA, qui débouchent sur le fait que l'enfant devient à son tour un bien de consommation, que l'on pourra acheter ou vendre et ce au mépris de certains de ses droits fondamentaux (comme le droit d'avoir un père et une mère ou le droit à la connaissance de ses origines) où alors au fait que la technique nous permettra bientôt de choisir le sexe de l'enfant, la couleur de ses yeux, débouchant sur des pratiques eugénistes qui, faut-il le rappeler, avaient été mises en place par le nazisme. Par ailleurs, comme la marchandisation est liée à la possibilité d'évaluer et de calculer (par exemple le prix d'une marchandise), cette évaluation purement quantitative déteint aussi sur la manière dont chacun vit sa sexualité, à cause des « nouvelles normes » que la pornographie tend à imposer. Ces nouvelles normes ont des effets psychologiques désastreux, car on va par exemple privilégier, dans la relation sexuelle, la performance sexuelle (mesurée en terme d'intensité et de durée) sur la qualité même de la relation, d'où une réduction de la relation humaine à de la pure mécanique. La sexualité, réduite à cette dimension quantitative, se trouve alors soumise à une logique sportive, mais elle échoue à créer une véritable communion entre les personnes, car la rencontre des corps ne peut être vécue de manière satisfaisante que si elle est le signe d'une réelle communion des cœurs. On ne redira jamais assez combien cette culture de la jouissance (Jean-Claude Guillebaud parlait à ce sujet d'une sorte de « tyrannie du plaisir », car le plaisir devient désormais une injonction impérative, une sorte, paradoxalement, de « nouvel ordre moral » auquel chacun serait sommé de se soumettre, ce qui ne peut que gâter le plaisir) est directement liée à l’idéologie soixante-huitarde, qui continue, malheureusement, à faire ses ravages aujourd’hui dans les cervelles, et ce alors même que cet hédonisme militant, dans son matérialisme désenchanté, ne comble pas le cœur des jeunes, puisque beaucoup d'entre eux confondent la quête effrénée du plaisir (toujours teintée, en réalité, d’amertume et de désespoir) avec la joie spirituelle d’un cœur unifié et réconcilié avec lui-même et avec Dieu.
Enfin un dernier aspect de cet abandon se manifeste, à mon sens, par une forme de christianophobie qui tend à nier et à rejeter tout l’héritage « humaniste » véhiculé par la religion chrétienne. On réduit aujourd’hui le christianisme à des clichés caricaturaux, en passant sous silence tout son apport, pourtant considérable, à la culture. D’où le développement d’un laïcisme virulent à l’égard des religions et du christianisme en particulier, qui confond neutralité de l’État et de ses institutions et neutralisation de l’espace public, ce qui constitue, à mon sens, une trahison de la saine laïcité et de l’esprit de la loi de 1905, qui visait plutôt à garantir la liberté religieuse et un certain pluralisme confessionnel, comme si nos élites ne pensaient l’émancipation des citoyens que par arrachement à tout ce qui pourrait les enfermer dans une appartenance héritée. On voit ainsi resurgir le vieux rêve rousseauiste d’une sorte de nouvelle religion civile (lisez les écrits de Vincent Peillon à ce sujet) venant se substituer aux autres confessions religieuses, et ce alors même que cette utopie révolutionnaire a été à l’origine de la terreur de 1793. Et je ne parle pas des restrictions qui planent sur la liberté de conscience et sur la clause de conscience : le risque est aujourd’hui de retomber dans un légalisme et dans une sacralisation de la loi civile qui tend à étouffer la « voix de la conscience », et qui conduit le peuple à une obéissance servile dont H. Arendt a bien montré, en analysant le cas Eichmann, ce fonctionnaire nazi qui obéissait aveuglément aux ordres de ses supérieurs sans s’interroger sur la moralité des commandements qu’on lui prescrivait, qu’elle risque de générer une forme de barbarie inédite : Eichmann est, en effet, le symbole même de « l’homme de masse », qui exécute servilement les ordres sans « penser » ce qu’il fait. Or l'homme de masse est celui qui se trouve fondu dans l'anonymat d'une foule indifférenciée qui devient extrêmement facile à manipuler (notamment par la propagande médiatique) car la masse, privée des repères que donne l'appartenance à un groupe ou à une communauté caractérisée par des objectifs précis, est extrêmement perméable à toutes les idéologies. Les atteintes multiples à la liberté de conscience (que ce soit celles des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement ou celles des maires qui refusent de marier des couples homosexuels) ne sont pas un bon signe, car c'est tout notre héritage humaniste qui est en train de partir en fumée sous la pression des lobbys, principalement gays et féministes.
M. A. : Le visage de la famille, qui est aujourd’hui une « famille décomposée » ou, dites-vous, le « nouveau visage » de la barbarie politique moderne, et précisément une lettre de Jean-Paul II, « Lettre aux familles », dans laquelle il nous met en garde contre la dissolution progressive de la famille. En quoi, la disparition de la famille, est-elle le début de la barbarie politico-morale ?
C.-É. de S. G. : Les régimes totalitaires, je le rappelle dans l'introduction de mon ouvrage, ont toujours commencé par s'attaquer à la famille, car la famille, en tant qu'elle transmet des valeurs, est le lieu par excellence de résistance à l'idéologie. Mais la redéfinition actuelle de la famille et du mariage, qui n'est plus perçue comme une institution, mais comme une unité artificielle, fondée sur des liens contractuels que l'on peut faire et défaire à volonté, contribue à l'éclatement des familles, ainsi qu'à la fragilisation ou au déracinement des individus, qui se retrouvent du coup isolés et insignifiants, tous prêts à se fondre dans cette masse qui leur apporte le refuge et la sécurité à laquelle ils aspirent, mais tout en y perdant toute autonomie individuelle et liberté de pensée. Ainsi, en refusant à la famille le statut « d'institution naturelle » fondée sur la différence des sexes en vue de la procréation, on réduit du coup la famille à un simple « contrat » fondé sur l'engagement d'une volonté susceptible de défaire ce qu'elle a fait. Dans le système « institutionnel », le mariage était quasiment considéré comme indissoluble, et si l'adultère était présent, il ne remettait pas en cause la stabilité de la famille, envers qui le fautif (l'adultère étant encore considéré comme une faute morale) se reconnaissait malgré tous des devoirs imprescriptibles. D'ailleurs, le mot « institution » n’est que la traduction laïque du mot « sacrement », et les devoirs du mariage civil sont en réalité calqués sur les devoirs engendrés par le « mariage religieux » - raison pour laquelle Portalis, définissant le mariage civil, y verra « la plus sainte des institutions, le contrat le plus sacré ». La famille ne naît donc pas d'un contrat entre deux volontés, elle n'est pas une association, mais elle unit les hommes sur le mode de de la filiation, dans la succession temporelle des générations de mortels, et c'est pourquoi le mariage-institution s'inscrit bien dans une théologie de l'alliance (liée à cette dimension sacrée, sur le modèle de l'alliance de Dieu et de son peuple) plus que dans une philosophie du contrat. C'est seulement dans les années 1960 qu'advient la « contractualisation » du couple (et partant, celle du droit de la famille). Cet avènement, qui est la conséquence de la libération de la volonté contractuelle de l'individu posée au fondement du mariage, va faire perdre progressivement à l’union conjugale son caractère « institutionnel » pour le ramener au rang d'un simple « contrat » dont on peut se désolidariser par un simple désir. Une telle réduction de la famille à sa dimension contractuelle ne peut cependant que fragiliser les liens familiaux, ceux-ci n'offrant plus aux enfants la sécurité et la protection dont ils ont besoin pour se construire et devenir, dans la société, des adultes responsables. Si le rôle de la famille est de protéger l’individu, et notamment les enfants qui y sont accueillis, de la violence sociale et de la vie publique en leur apportant le refuge et la sécurité affective dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir, alors il faut que la famille soit une structure solide, et le droit doit, bien sûr, veiller à garantir cette solidité, au lieu de la fragiliser par sa contractualisation. C'est seulement lorsque la famille ne peut plus remplir cette fonction de protection que ce rôle doit alors échoir à la collectivité afin d’aider l’individu en difficulté dans sa propre famille. Or c'est justement ce que notre droit n’offre plus aujourd’hui, puisque tout le monde constate (parfois pour le déplorer) la précarisation du droit conjugal et partant du droit familial. Mais ne serait-il pas judicieux de la part de l’État (au moins autant pour des considérations économiques que morales) de mettre sur pied une politique sociale visant à resserrer les liens familiaux et à reconstruire la famille, si malmenée aujourd'hui ? À moins que le but inavoué de l'État ne soit de profiter de cette fragilisation des familles pour mieux imposer aux individus, désormais privés du rempart familial, une idéologie qu'ils accepteront d'autant mieux qu'ils n'auront pas bénéficié des repères structurants que la famille, dans sa mission « éducative », a pour vocation de transmettre. L'un des principaux ressorts du totalitarisme, en effet, a toujours été de supprimer les communautés intermédiaires qui peuvent s'interposer entre l'individu et l'État, ce qui suppose au préalable, comme l'analyse judicieusement Hannah Arendt dans Le système totalitaire, l'atomisation de la société civile, c'est-à-dire la suppression de toute distinction, de toute appartenance spécifique qui pourrait enraciner l'individu dans une communauté, qu'elle soit familiale, culturelle ou spirituelle. Le « système totalitaire » a ainsi pour effet et pour but d'isoler, de séparer les individus, tout en les fondant dans une masse anonyme, afin qu’aucun esprit de corps ou de communauté ne soit plus possible, et que la soumission ainsi que le sacrifice de l'individu à l’État et à la nation soient assurés par ce biais. En favorisant l'atomisation massive de la société par la dissolution des liens familiaux, le système totalitaire isole l’individu, lui interdit de s'intégrer dans une communauté quelconque, qui puisse lui apporter un refuge en faisant tampon entre lui et L'État. L’isolement des individus contient donc en germe le totalitarisme, l'État totalitaire se présentant alors comme un remède à cet « esseulement » hors de toute communauté intermédiaire. Ainsi atomisé, l’individu est superflu et désolé, il n'est plus qu’un numéro anonyme et insignifiant, privé de l'identité que lui procurait l'appartenance familiale ou communautaire, et ce déracinement ne lui laisse pas d’autres ressources que de s'abandonner docilement à l'État, un État qui façonne alors l’individu pour qu’il adhère pleinement à l’idéologie du pouvoir et cesse d'éprouver la crainte qui menace l’individu atomisé. On le voit, pour que l’individu abdique sa souveraineté et sa liberté, il doit être mis à nu sous le regard de l’État, sans qu'aucune institution ne puisse s’interposer entre l'individu et l’État puisque celui-ci se veut le seul garant de sa protection et le seul capable de le sanctionner. La famille, les parents notamment, doivent donc abandonner à l'État leur mission d'éducateurs et être niés en tant que toute première des institutions. Coupés de leurs liens naturels et familiaux, qui permettaient de donner aux enfants une protection contre l'idéologie du pouvoir par les valeurs que transmettent les parents, les enfants sont alors façonnés par l'idéologie totalitaire comme des petits robots dociles, sans trop d’âme ni de sentiments. On voit a contrario que l'épanouissement bien compris des enfants implique bien plutôt qu’ils puissent trouver dans leur famille le premier des refuges, et le lieu où ils peuvent se construire en tant qu’individus autonomes, ce qui correspond bien au principe de subsidiarité : l'État ne peut s'immiscer dans la sphère inférieure que s'il y est convié et que les parents ne sont plus en mesure d'assumer la responsabilité d'éducateurs qui est la leur.
M. A. : J’ai cité, parmi toute la barbarie qui jaillit aujourd’hui dans nos sociétés modernes, deux faits de société qui sont marquants, mais je voudrais revenir à cette coupure avec nos racines judéo-chrétiennes, notamment due à un libéralisme débridé, et que vous déplorez dans votre ouvrage : vous accusez le dogme égalitariste, notamment le nouveau libéralisme accolé à la théorie de la justice de John Rawls : pour résumer votre thèse : on passe sans transition de l’égalité des chances à l’égalité dans la culture et surtout dans l’inculture. On passe alors de la récompense des talents à la négation des talents pour ne pas défavoriser ceux qui n’ont aucun talent (en imaginant que ce soit seulement possible, je ne crois pas personnellement qu’on trouve des gens sans talent). En quoi l’égalité des chances nous a conduits à la culture de l’excuse, et au nivellement vers le bas, ce qui conduit de la civilisation à la barbarie ?
C.-É. de S. G. : En 1984, personne ne s’offusquait, à gauche, d’entendre Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Éducation nationale, décréter qu’il fallait « apprendre pour entreprendre », ou défendre la notion « d’élitisme républicain », appliquée à l’école du mérite. En brandissant aujourd'hui la menace d’un « égalitarisme niveleur », Jean-Pierre Chevènement a fait écho à ce que ressentent les 60% de Français, opposés à cette réforme du collège qui est perçue comme un affaiblissement supplémentaire infligé à la maison France. C'est cet « égalitarisme niveleur » qui semble être désormais le dénominateur commun de toutes les réformes entreprises à l'École, comme si l’École étant aujourd'hui devenu le principal lieu de lutte contre les inégalités sociales. Mais le risque n'est-il pas alors d'instrumentaliser l'École à des fins strictement idéologiques ? Peut-on concilier « l'idéal méritocratique », longtemps mis en avant par l'École de la République lorsqu'elle jouait encore pleinement son rôle d'ascenseur social pour des jeunes issus de milieux populaires ou défavorisés, avec l'exigence d'égalité dont nos gouvernements depuis quelques décennies ont fait leur unique mot d'ordre ? Un rapide détour par l'histoire s'impose pour comprendre les évolutions suivies par l'École, et de comprendre pourquoi, notamment, l'élitisme républicain, qui a longtemps fait du système éducatif français l'un des plus performants au monde, est devenu aujourd'hui l'ennemi à abattre pour tous ceux qui préfèrent l'égalité dans l'inculture, c'est-à-dire l'égalisation « de fait » des conditions, à « l'égalité des chances » que la méritocratie républicaine s'était donné pour mission de promouvoir - une « égalité des chances » que je ne critique aucunement, bien au contraire, mais dont je déplore qu'on lui ait progressivement substitué un égalitarisme niveleur !
On sait que Condorcet, philosophe des Lumières, fut à l'origine de l'idéal méritocratique et de l'élitisme républicain. Chargé de rédiger un rapport Sur la nécessité de l’Instruction Publique, Condorcet avait donné pour mission à l’instruction publique de diffuser le plus largement possible un « savoir élémentaire », censé assurer l’autonomie de chacun, grâce à la maîtrise de bases de l’écriture, de la lecture et du calcul, et lui offrir l’opportunité d’élargir ce savoir par la suite. Ce savoir élémentaire (que l’on retrouve aujourd’hui sous l’appellation de socle commun de connaissances et de compétences marqué par la maîtrise de la langue française, la pratique d’une langue étrangère, les principaux éléments des mathématiques, de la culture scientifique et technologique, la maîtrise des NTIC, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l’autonomie et l’initiative) s’oppose aussi bien au refus rousseauiste d’instruire l’enfant avant un certain âge qu’au savoir cumulatif, tout aussi préjudiciable en ce qu’il préfère une tête bien pleine à une tête bien faite, confondant ainsi érudition avec éducation. Condorcet faisait ainsi reposer la nécessité de l’instruction publique, et donc la prise en charge de l’enseignement des jeunes citoyens par les pouvoirs publics, sur une double exigence :
1) D’une part, celle de diffuser partout les Lumières, pour rendre impossible cette confiscation du savoir entre quelques mains, et l’asservissement qu’elle entraîne. On dit en effet que le savoir libère, mais si je suis seul à disposer, avec quelques pairs, de ce savoir, il ne libère pas, il asservit. Mais Condorcet ne veut pas supprimer pour autant toutes les inégalités. Car si je demande que tous possèdent, au même degré, ce savoir, je propose alors une utopie plus propice à conforter le despotisme qu’à émanciper réellement le peuple. Vouloir détruire complètement toutes les inégalités serait absurde et dangereux.
2) D’autre part, si l’on veut prétendre donner à chacun la chance de jouir de ses droits fondamentaux, encore faut-il lui permettre de comprendre les enjeux de cette liberté et des choix qu’il a à réaliser. Si l’instruction doit donc être réellement ouverte à tous, c’est parce que cette disposition seule peut rendre réelle l’égalité stipulée par la loi et effective la jouissance des droits déclarés par la constitution.
Reste que Condorcet ne tranche pas vraiment entre l’élitisme et l’égalitarisme, problème majeur sur lequel ne cessera de s’échouer l’Ecole républicaine, mais il cherche plutôt à concilier les deux aspects. Car l’excellence est pour lui un droit, au même titre que l’instruction élémentaire pour tous. Si l’on doit aux droits de l’homme de faire sortir un être ignorant de son ignorance, on doit aux mêmes droits de donner à chacun la possibilité de développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la nature. Loin d’être une injure à l’égalité et à la démocratie, l’élitisme républicain dont se prévaut Condorcet repose sur l’idée que les élites doivent se mettre au service de la République et du peuple, car leur supériorité doit éclairer et faire progresser une nation entière de citoyens, étant entendu que pour instruire le peuple, il faut les meilleurs esprits, l’inégalité des talents étant ici au service de l’égalité politico-juridique. Pourtant, c'est cet élitisme républicain qui est battu en brèche depuis des décennies. Deux ouvrages de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la culture (1964) et La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement (1970), vont prétendre que l’école a failli totalement a sa mission démocratique et que, loin de contribuer à promouvoir l’égalité des chances, en permettant à des élèves d’origine modeste de bénéficier de l’ascenseur social offert par l’école républicaine, elle ne fait, en réalité, que contribuer à la reproduction des inégalités sociales existantes. L'école républicaine classique serait donc profondément anti-démocratique. Ce faisant, en mettant en avant de telles idées, on commet, en réalité, une double erreur :
1) Tout d'abord, on peut penser que l’école n’est pas – et elle ne doit pas être – une sorte de laboratoire de la démocratie. Son rôle n’est pas de former des citoyens égaux (bénéficiant d’une formation identique), mais de former des citoyens éclairés, dotés d’un solide jugement critique, afin d'éviter que les enfants ne deviennent la proie de toutes les manipulations idéologiques. Or on ne peut éclairer le jugement d’un élève sans lui donner la culture qui lui permettra de comprendre le monde, car on ne peut avoir accès aux clefs d'interprétation du monde sans savoir d'où l'on vient, et comment s'est façonné, au cours des siècles, la figure de ce monde. Que beaucoup d’élèves ne soient pas capables de s’approprier cette culture héritée du passé (qui est à la fois historique, sociologique, philosophique, artistique, etc.) est un fait que personne ne contestera, mais le rôle (le seul d'ailleurs) de la pédagogie n'est pas de renoncer à transmettre ce savoir - sous prétexte qu'il ne serait pas immédiatement assimilable par une bonne partie des enfants - pour se concentrer sur les « savoir-faire » (la tâche du maître se limitant désormais à montrer comment apprendre un savoir, et non à lui transmettre celui-ci, faisant disparaître alors le savoir et les contenus disciplinaires pour la pédagogie) il est, bien plutôt, de réfléchir aux modalités permettant de faciliter l'acquisition de celui-ci. Il serait donc dramatique de renoncer, au nom de la préservation de l’égalité, à ce patient travail de « déchiffrement » du monde. Or si l'on s'intéresse à l’idéologie qui sous-tend toutes les réformes scolaires qui ont conduit, depuis la réforme Jospin, à une démocratisation massive de l'école, on voit vite qu’elle participe d’une volonté de faire comme si l’école avait pour finalité de réduire les inégalités sociales, et que c’était là sa seule et unique vocation. Mais ces thèses inspirées de Bourdieu et Passeron reposent, en fait, sur une confusion entre l’école et la société. Comme le rappelait Jean-Pierre Chevènement dans sa critique de la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, « l'école est un sanctuaire, il faut éviter que la société y pénètre trop, et aujourd'hui nous souffrons que la société veut s'ingérer dans l'école à tout moment ». Or Bourdieu et Passeront reprochent à l’école sa cécité aux inégalités sociales, sans prendre conscience de leur propre cécité sociale à l’égard des finalités de l’école.
2) En outre, et de manière assez paradoxale, on peut observer que la démocratisation de l’enseignement et le refus de transmettre une culture jugée trop « élitiste » aboutit, dans les faits, à l’inverse du résultat recherché : en abaissant ses exigences (pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre), l’école ne permet plus à certains talents de se révéler, car les élèves capables de réussir dans les concours des grandes écoles sont désormais ceux qui seront passés par d’autres voies que celles proposées par le système scolaire, ou qui auront eu accès à d’autres sources d’informations, celles transmises par le milieu familial ou par les réseaux de relations. La démocratisation des études nuit ici à l’idéal démocratique : loin de réduire les inégalités sociales, en permettant à des jeunes issus de milieux défavorisés de bénéficier, grâce à l’école, d’un véritable ascenseur social, l’abaissement des exigences scolaires conduit, bien plutôt, à l’autoreproduction des élites, comme si l’école ne parvenait plus à remplir aujourd’hui sa mission. Or nos « pédagogues » modernes, aveuglés par leur « idéologie égalitariste », semblent ne pas voir que plus l'école renoncera à transmettre une culture et des connaissances structurées, plus elle favorisera la reproduction sociale là où la méritocratie républicaine, qui visait seulement l'égalité des chances (et non l'égalité tout court), rendait possible une réelle mobilité sociale. Comme le souligne François-Xavier Bellamy, « Bourdieu a produit, au nom même de l’égalité, l’école la plus inégalitaire qui soit. A partir du moment où l’on interdit à l’école de transmettre la culture, au motif qu’elle est discriminatoire, on rend l’origine sociale des élèves plus déterminante que jamais. Puisque le savoir n’est pas transmis à l’école, seuls seront sauvés ceux qui le reçoivent dans leur famille… La dernière enquête PISA, en 2013, a montré que nous avons désormais le système scolaire le plus inégalitaire des pays de l’OCDE, celui qui conserve le plus les inégalités sociales d’origine. Bourdieu a produit le système scolaire qu’il dénonçait »[3].
M. A. : Le retour de la barbarie, c’est aussi lié, selon vous, aux idéologies hédoniste, libertaires et laïque. Le péché originel prenant sa source dans deux choses : la Révolution de 1789, avec son corollaire liberté, laïcité et méritocratie, et la société de consommation avec ses tentacules que sont l’hédonisme et l’individualisme. On retrouve aujourd’hui les conséquences négatives, avec la « théorie du genre » et « l’inclusif », qui sont un peu comme un basculement, le premier nous conduit à une haine de la nature, l’autre à une haine de la souffrance et de la vie, une haine même du groupe, de ce qui fait le corps politique. D’ailleurs toute cette partie me fait penser à La Barbarie[4] de Michel Henry. Comment cette idéologie nous conduit à une bascule et surtout au chaos social ?
C.-É. de S. G. : Nous vivons une époque hautement paradoxale. D'un côté, on ne cesse de mettre en avant le souci écologique, l'importance des équilibres naturels dont on reconnaît qu'ils jouent un rôle régulateur pour l'écosystème, mais autant nous sommes capables de prendre en compte ce nécessaire respect de la nature en dehors de nous, autant nous sommes devenus aujourd'hui totalement incapables de percevoir cette part naturelle qui nous constitue en tant qu'être biologiquement sexué, bref de reconnaître que notre sexe biologique est bien constitutif de notre identité. Il est vrai que l'homme est avant tout un être de culture, dit-on souvent, et qu'étant une exception dans la nature, il a la capacité de s'arracher à celle-ci, ce qui est la marque de son humanité. Pour reprendre l'expression d'un livre de Clément Rosset, il est un être « d'anti-nature » au point qu'on pourrait se demander si un homme laissé à lui-même, en l'absence de toute culture, serait encore « humain ». Ce cas s'est d'ailleurs présenté avec Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage, dont le comportement ne se distinguait pas de celui des animaux, et la vulgate marxiste s'est emparé de ce cas pour en conclure (un peu rapidement...) qu'il n'y aurait pas de « nature humaine », et que tout ce qu'il y a d'humain en l'homme serait le produit de la culture. Pourtant, Victor se distingue déjà des animaux par le simple fait qu'il est capable de les imiter (alors qu'on ne verra jamais, excepté chez quelques chimpanzés, un animal imiter l'homme) ce qui tend à montrer que la nature humaine est moins absente en l'homme qu'elle se définit bien plutôt par sa plasticité, par son indétermination, bref par son éducabilité, et c'est précisément la raison pour laquelle l'homme a besoin d'être éduqué là où l'animal peut seulement être dressé. Mais cette éducation ne signifie pas que l'homme serait de la pâte à modeler que l'on pourrait ployer dans n'importe quel sens. Car le corps humain, dans sa dimension biologique, est un « texte » qui fait sens, et qui demande à être déchiffré. S'il y a bien quelque chose de construit en l'homme, le sens qui préside à cette construction repose sur un donné naturel signifiant, qui n'est pas lui-même construit, sans quoi la construction serait hors sol. L'erreur du naturalisme, c'est sans doute d'avoir cru à l'existence d'une nature masculine ou à l'existence d'une nature féminine qui nous disposeraient à certaines tâches spécifiques, en oubliant que les rôles sociaux relèvent en grande partie de constructions culturelles qu'il est certes possible de déconstruire. Mais l'erreur inverse et opposée, qui est tout aussi funeste, c'est de croire que rien ne fait sens dans notre héritage biologique, pas même notre corps sexué, bref qu'il n'y aurait aucun lien entre la psychologie féminine et le corps sexué femelle ou entre la psychologie masculine et notre corps sexué mâle. En réalité, naturalisme et culturalisme doivent donc être renvoyés dos-à-dos, comme deux fictions unilatérales. Comme le souligne Marguerite Léna dans « Une différence créatrice. Eduquer des femmes », « il faut renvoyer ici dos à dos le naturalisme, qui met hors culture une identité féminine dont le développement se fait on ne sait comment et le culturalisme, pour qui l’éducation fait tout, y compris la femme. Car ils méconnaissent l’un et l’autre le paradoxe de l’homme, être inséparablement naturel et culturel, charnel jusque dans son esprit et spirituel jusque dans sa chair ». Même s’il ne suffit pas de naître femelle pour être femme, ni de naître mâle pour être homme, la « féminité » ou la « masculinité » ne se décrètent pas par choix, parce qu’ils s’enracinent déjà dans cette dimension corporelle biologique qui fait sens (et qui nierait que l'instinct maternel que l'on observe chez la quasi-totalité des femmes ne doive quelque chose à son corps biologique, qui a porté l'enfant ?). En d’autres termes, la différence anthropologique de l’homme et de la femme a bien sa source, bien qu’elle ne s’y réduise pas, dans la différence anatomico-biologique des corps sexués, et l’altérité sexuelle, posée au fondement du corps humain, doit être considérée, pour cette raison même, comme signifiante et comme fondatrice. Le corps sexué manifeste en ce sens, de manière indubitable, une « limite » : je suis homme ou femme, mais je ne peux pas être les deux, car je ne suis pas androgyne, je ne suis pas l’un et l’autre. Nier l’ancrage biologique de la différenciation sexuelle, c’est nier la finitude, c’est opter pour une toute-puissance démiurgique comme si l’homme était à lui-même sa propre origine. Si le biologique ne dicte pas directement, de manière univoque, les significations des comportements, on ne peut pas pour autant dissocier une nature biologique de comportements signifiants toujours médiatisés et repris à l’horizon d’une culture, car cette dissociation réintroduirait un dualisme corps-esprit. Ainsi, nier tout ancrage biologique de l’identité de genre, c’est opter pour une toute-puissance démiurgique, comme si nous étions à l’origine de nous-mêmes. Cette négation risque fort d’aboutir, à plus ou moins long terme, à une désincarnation et à une perte du sens de l’humanité elle-même s’il est vrai que le « sens de l’humain » s’enracine dans ce donné naturel qui lui indique un « sens » (au double sens de direction et de signification) que la culture viendra actualiser, dans une expression toujours particulière. Elle risque aussi de créer une humanité qui, désormais indifférenciée, ne reconnaîtra plus de limites extérieures lui permettant de se structurer, alors que la psychanalyse nous enseigne pourtant que la « limite » est une condition de la structuration psychique des individus. Le risque de cette indifférenciation, c’est donc bien de générer le « chaos » social, celui de la confusion des genres, et même Margareth Mead, pourtant pionnière pour montrer la part culturellement construite (et donc arbitraire) des rôles sociaux, soulignait néanmoins, dans L'un et l'autre sexe, que toutes les cultures sans exception différencient, à travers des marqueurs identitaires (qui peuvent, certes, varier d'une culture à l'autre), le masculin et le féminin, cette distinction universelle étant le seul « invariant » qui transcende la diversité culturelle. Par où l'on voir que la « haine de la nature » et la tentation actuelle de vouloir s’affranchir de toute limite, en refusant la différenciation des genres fondée sur la différence des sexes (ce qui revient, pour l’homme, à vouloir être Dieu, à être à soi-même sa propre origine, au lieu de se recevoir d’un « donné » naturel qui est pourtant, pour lui, déjà signifiant et structurant) risque fort de rendre l’homme obscur et indéchiffrable à lui-même, et de conduire la société au chaos : toute complémentarité naturelle entre l'homme et la femme (reposant sur des vocations spécifiquement distinctes) ayant disparue, ne restera plus que des luttes pour le pouvoir et la domination ou pour la neutralisation des différences, et ce alors même que c'est cette différence (faussement perçue par les féministes comme une inégalité en raison d'une grave confusion entre égalité et identité) qui fait toute la richesse de l'humanité.
M. A. : Votre livre est moins un pamphlet qu’une réflexion de fond pour donner quelques pistes, car vous semblez inquiet pour notre civilisation, et son effondrement à venir. Face à une société de plus en plus délitée, on a l’impression que plus rien ne peut encore faire rempart : ni la démocratie, ni la laïcité, ni l’égalitarisme. Finalement, tous nos outils démocratiques et modernes ont échoué à maintenir le corps social. Nous sombrons dans la barbarie, et vous vous en faites l’écho. Y a-t-il encore une solution qui nous permettra de remettre notre civilisation sur pied, ou pensez-vous que c’est déjà trop tard ? Si l’on prend toutes les injonctions sociales, on a l’impression que l’on ne peut plus rien faire, pas même écrire un livre comme le vôtre, qui peut passer pour réactionnaire, parce que regardant d’une certaine manière dans le rétroviseur : or, la nostalgie est interdite aujourd’hui[5]. On ne peut pas sortir du discours « laïcard » et progressiste sans se faire « nazifier », bannir socialement. On ne peut même plus parler de Noël dans l’espace public sans brimer un cœur et se faire accuser de sectarisme. Bref, la sensiblerie est à tous les étages, et plus grave, le totalitarisme est en marche : on se sent de plus en plus face au cercle des saints d'esprit d’un côté, les agents actifs, la généralisation de la surveillance, l’autocontrôle ou le contrôle du peuple par le peuple, un peuple d'inquisiteurs, avec une généralisation des suspects, un peu comme en ex-URSS où le fascisme venait du bas et remontait depuis les masses, et puis de l’autre, les mal-pensants, ceux qu’il faut rééduquer, ou qu’il faut exclure. Est-ce que cette dérive sectaire par l’Empire du Bien, pour reprendre les mots de Philippe Muray, n’est pas en train de nous conduire à un face-à-face irréparable ?
C.-É. de S. G. : Je suis assez pessimisme car malgré les « lanceurs d'alerte » qui montrent le déclin inexorable de notre civilisation, sa décadence inéluctable, nous restons divisés à l'intérieur de notre pays entre des « progressistes » vraiment niais et béats, qui continuent aveuglément de croire que nous « progressons » alors même que tous les indicateurs de ce déclin sont au rouge, et de l'autre côté, un conservatisme certes beaucoup plus lucide sur la situation actuelle, mais qui vit trop dans le passé et n'offre pas de réelles solutions alternatives à la décadence accélérée que nous observons. Mon livre ne prétend pas apporter des remèdes à cette situation, mais poser un diagnostic juste est sans doute le point de départ pour sortir de cet aveuglement, de cette fuite en avant dans ce que Arendt appelait une « pathologie de la nouveauté » qui n'est pas un réel progrès car la rupture avec le passé, la rupture d'avec la tradition fondatrice de notre civilisation judéo-chrétienne ainsi que la volonté révolutionnaire de faire table rase de tout notre passé, nous condamne paradoxalement à reproduire les errances de celui-ci. Quand je vois les dérives de la « cancel culture » et du wokisme, je me dis que ces gens-là sont totalement incapables de comprendre ce qu'est vraiment le progrès : ils regardent le passé (qu'ils rejettent) à la lumière des yeux que nous a donné notre présent, mais ils demeurent totalement aveugles aux progrès de la conscience historique, ils sont incapables de comprendre le contexte historique aussi bien la mentalité qui animait les hommes du passé. Il est facile, pour prendre un exemple, de dénoncer l'inquisition au nom du respect de la liberté de conscience, mais outre que l'inquisition a constitué un réel progrès dans le sens de la justice quand on s'intéresse aux formes de justice antérieures (ce que Michel Foucault a d'ailleurs parfaitement montré), qui ne voit que la liberté de conscience est un acquis de la modernité, un héritage direct du protestantisme, et que celle-ci était de peu d'importance à l'époque comparée aux risques que faisaient planer l'hérésie, souvent assimilée à un virus dangereux menaçant le corps de l'Eglise toute entière ? Or le vrai progrès, Hegel l'avait bien compris, n'implique pas l'effacement du passé, mais il est inséparable de la conservation de ce qu'il dépasse, il implique à la fois l'ouverture à l'appel de l'avenir (ce qui évite l'immobilisme dont on accuse parfois les conservateurs) tout en réintériosant constamment le passé comme étant cet héritage fondateur de notre identité, dont nous sommes redevables et que nous avons à assumer, en le ré-intériorisant comme notre passé, un passé dont nous sommes provenus et qui nous constitue dans ce qui fait notre identité propre. Renouer avec cet héritage fondateur constitutif de notre identité, ce n'est pas se condamner à vivre dans le passé, c'est plutôt retrouver l'inspiration et la source qui nous permettra, peut-être, de prolonger l'élan qui fut à l'origine de notre civilisation par-delà l'épuisement actuel de ses forces vives et dont l'art contemporain se fait, hélas, le triste reflet quotidien. Si nous n'y parvenons pas, nous subirons alors le destin de toute civilisation décadente, qui a fini par être remplacée par une autre civilisation pourtant moins avancée, mais restée davantage fidèle à ses propres valeurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment crucial de notre histoire : soit nous décidons enfin d'assumer clairement ce que nous sommes, en retrouvant la fierté de nos racines judéo-chrétiennes qui porteront les branches futures, et tous les espoirs seront encore permis, soit nous continuons à sombrer dans ce nihilisme wokiste de la « tyrannie des minorités », qui délite progressivement le lien social en refusant tout horizon universaliste qui permettrait de nous élever au-dessus de cette surenchère dans la victimisation permanente, grâce à un projet commun qui puisse faire sens pour tous. Ma foi m'amène toutefois à penser que nous ne pourrons pas nous en sortir sans un petit « coup de pouce divin » pour éclairer les consciences, notamment celle des politiciens, afin de les faire sortir de leur léthargie actuelle, de leurs difficultés à servir leur bien commun, souvent par peur du « médiatiquement correct » plus que par conviction (même si certains témoignent d'un réel courage et d'une lucidité supérieure).
En couverture : Otto Dix Les joueurs de skat 1920 tempera sur bois de 468 x 204 cm (détail).
_________________________________________
[1] Paris, Salvator, 2015.
[2] Paris, PUF, 1999.
[3] F-X. Bellamy, « Bourdieu a créé l'école qu'il dénonçait », Causeur, 7 Novembre 2014
[4] Paris, Le Seuil, 1987.
[5] Voir mon entretien avec Thomas Morales dans ces pages.