Entretien avec Stéphane Barsacq « Ma morale est avant tout une morale du feu poétique »

Stéphane Barsacq publie le dernier volume d’une trilogie de pensées, de maximes et d’aphorismes. Un ouvrage à savourer, à méditer. Cet entretien a paru dans le Livr'arbitres de la livraison n°41. Il est désormais en accès libre dans l’Ouvroir.
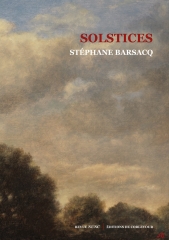 Marc Alpozzo : Cher Stéphane, c’est toujours un grand plaisir de vous lire. Ce troisième volet de la trilogie Mystica, est encore un très beau texte, où s’y mêlent des aphorismes, des exercices d’admiration, des extraits de votre journal intime, et des lettres, ainsi que de longues citations d’auteurs, d’éclaireurs pour notre temps. Vous faites une fois de plus œuvre de moraliste, du type XVIIe.
Marc Alpozzo : Cher Stéphane, c’est toujours un grand plaisir de vous lire. Ce troisième volet de la trilogie Mystica, est encore un très beau texte, où s’y mêlent des aphorismes, des exercices d’admiration, des extraits de votre journal intime, et des lettres, ainsi que de longues citations d’auteurs, d’éclaireurs pour notre temps. Vous faites une fois de plus œuvre de moraliste, du type XVIIe.
Stéphane Barsacq : Je vous remercie pour votre invitation à dialoguer de nouveau, cher Marc. Dès l’abord, je dois m’interroger sur le sens d’un mot. Vous parlez de « moraliste ». Suis-je un moraliste ? Si l’on entend un homme attaché à faire la morale à autrui, le prêcheur d’une moralité, voire d’une moraline, je ne le suis en rien, dois-je le confesser. Le mot morale, pourtant si beau, a tellement été démonétisé, qu’on ne l’entend d’ailleurs plus guère que sous sa forme héritée du grec, et qui, bien que plus ancienne, est plus récente, je veux parler de l’éthique. On pourrait même avancer que ceux qui parlent d’éthique le font par peur de la morale, comme si la morale était une branche du catéchisme, et l’éthique, de la philosophie ! Pour autant, s’il s’agit d’être sérieux, il est vrai que le courant moraliste est l’un de nos plus forts courants littéraires. Il s’est illustré autour des acteurs déchus de la Fronde, comme La Rochefoucauld, ou avant lui, autour des femmes de lettres qui ont forgé notre langue, comme Mme de Sablé. Pour moi, s’il est un moraliste dont l’œuvre a modelé, pour partie, ma vie, c’est Pascal. Que dire de lui, que tous ne sachent déjà ? Pascal a été un grand mathématicien de la mystique, et un mystique génial de la raison : un écrivain que je pratique depuis l’adolescence chez lequel « l’esprit de géométrie » ne fait qu’un avec « l’esprit de finesse ». Pascal a voulu dire le Tout de la création, et a laissé une œuvre inachevée, ce qui est, somme toute, la plus riche possibilité d’accéder à l’entièreté des phénomènes, parfois si complexes. Mais de quoi est-il question chez Pascal ? Non pas de la morale, entendue comme un ensemble de règles contraignantes, dont le propre serait de rétrécir nos vies à de la pauvreté. C’est tout le contraire. Il y va d’une observation des misères et des grandeurs, de ce qui permet de convertir les unes aux autres. C’est une manière de ressaisir un élan vers la hauteur. A cet égard, je crois nécessaire de tenir la balance entre la lucidité, qui est l’observation de la pesanteur, et l’espérance, qui est cette grâce, d’où notre vie tire son énergie pour ne pas céder. Mais si je me sens proche de Pascal, dois-je ajouter aussitôt un nom ? Ce serait celui du Caravage, qui offre un double un Pascal, de même que son suiveur, Georges de La Tour. Regardez les tableaux du Caravage : il est question d’une noirceur et d’une lumière qui la rachète, d’un monde comme dévoré par le mal et l’horreur, mais qui se soumet à une autre loi.

M. A. : Nous vivons cependant une époque absolument amorale, sur divers plans. En quoi selon vous, le moraliste au début de ce siècle empreint de nihilisme, a-t-il son rôle à jouer ?
S. B. : Diversité imposée, vivre-ensemble conflictuel, écriture inclusive, discrimination positive, intersectionalité, indigénisme, communautarisme, gender studies, black lives matter, politically correct, cancel culture, black face, mansplaining, manspreading, white privilege, et, bien sûr, transition de genre incontrôlée, voire pédophilie d’élite et de réseau : nous vivons une époque étonnante dans la mesure où l’amoralité, sinon l’immoralité, se donne parfois pour le degré suprême du moralisme. C’est l’aboutissement de la logique libérale-libertaire prophétisée par Michel Clouscard et mise en scène par son disciple, Michel Houellebecq – une logique qui avance à pas de géant avant « liquidation », puisque le mot d’ordre semble celui des soldes : Tout doit disparaître. Je ferais volontiers remarquer pour enfoncer le clou que le dernier poème des Illuminations est non pas « Génie », mais « Soldes », où Rimbaud écrit avec une prescience surhumaine la situation de notre époque, mieux qu’aucun critique. Jugez-en ! Que dit le poète qui est tout sauf un rêveur, ou dit autrement qui est celui dont l’œil voit en face l’avenir : « À vendre les Corps sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance ! » Mais si ce n’était que cela ! Rimbaud voit tout : « À vendre l'anarchie pour les masses ; la satisfaction irrépressible pour les amateurs supérieurs ; la mort atroce pour les fidèles et les amants ! » Heureusement qu’on ne l’a pas mis au Panthéon ! On n'imagine pas notre président réciter ces mots qui dévoileraient la finalité de son programme. Rimbaud continue : « À vendre les habitations et les migrations, sports, féeries et comforts parfaits, et le bruit, le mouvement et l'avenir qu'ils font ! » Non, vraiment : trop, c’est trop ! De fait, dès lors que le commerce trouve son intérêt, tout devient licite, comme nous le voyons, et l’objet de croisades pour le Bien, même s’il est le Mal, je pense à tout ce qui touche à la GPA, à la traite au profit de passions tristes des utérus de femmes pauvres. Sans doute peut-on continuer les développements sur des pages. Ce qu’on appelait Satan se déchaîne en ricanant contre toute illumination rimbaldienne. C’est assez dire si ma morale, si jamais ce mot a un sens, est avant tout une morale du feu poétique.
M. A. : Solstices (Corlevour, 2022) est le troisième volet d’une trilogie qui commence par Mystica (Corlevour, 2018) puis se continue avec Météores (Corlevour, 2020). Après votre très beau roman Le piano dans l’éducation des jeunes filles (Albin Michel, 2016), vous aviez opté en 2018, pour une forme plus ramassée, le recueil d’aphorismes. Pourquoi ?
S. B. : Je me souviens d’un texte ironique de Jacques de Lacretelle sur La Rochefoucauld. Il montrait que La Rochefoucauld était d’abord romancier. Il citait un aphorisme du duc, et le continuait par une narration parfaitement conforme à l’art du roman traditionnel, une narration elle-même arrêtée par un nouvel aphorisme, puis reprise sur plusieurs pages, jusqu’à un nouvel aphorisme. Autrement dit, il montrait que l’aphorisme était le point de gouverne d’un art du roman, qui n’offrait guère que des transitions, plus ou moins développées, d’un aphorisme à l’autre, ce qui est certes vérifiable jusqu’à Balzac et Hugo, voire Roger Nimier ou Antoine Blondin. À cet égard, tout bon recueil d’aphorismes est avant toute chose un art du roman, qui a su faire sauter les parties intermédiaires, pour laisser l’imagination plus libre. Pour moi, il est vrai par ailleurs que j’ai toujours aimé changé de forme : j’ai écrit de la poésie, de la critique, de la philosophie, de la musicologie, mais encore un livre sur l’art. Après un roman, art du développement, j’ai voulu faire le contraire : proposer des essences. On peut être long et court, ce qui est propre des romans ratés, qu’on pourrait ramener à une nouvelle, mais aussi court et long, comme Cioran, chez lequel tout engage soudain le cosmos.

La vocation de Saint Matthieu de Caravage
M. A. : Votre premier volet, Mystica, pose la question du salut. Avec Solstices, on a l’impression que vous posez la question de l’entre-deux, l’entre-deux mondes, l’entre-deux humanités, l’entre-deux époques, la nuit et le jour. Inter canem et lupum, entre chien et loup, il nous incombe de choisir, n’est-ce pas ? Et vous choisissez la lumière, non pas celle des ténèbres, mais la lumière du divin.
S. B. : Je parlais du Caravage. Combien de fois suis-je allé à Saint-Louis-des-Français à Rome ? En 1600, grâce à ses amitiés dans le milieu pro-français, Caravage obtient la commande de la Vocation et du Martyre de saint Matthieu. Cette première grande commande de sujets religieux marque le principal tournant de sa carrière, lui permettant de démontrer sa capacité à traiter ce type de peinture. Son approche des sujets religieux est aussi ambivalente que la vie en clair-obscur qu’il mène entre les salons des princes et les bagarres de rue. Cette attitude le rend inclassable. Autant qu’une manière picturale, le clair-obscur est le reflet de sa propre recherche spirituelle. Au-dessus de la main du Christ, une fenêtre ouverte, à meneaux en forme de croix, annonce la mort et la résurrection du Christ par laquelle il rachète les péchés. La vocation de Matthieu devient alors, non seulement le pardon de ses fautes, mais aussi une naissance, le passage de la mort à la vie, de l’ombre à la lumière. Le Christ lui-même sort de l’ombre, son entrée dans la pièce n’a rien d'éblouissant ; de même que la lumière qui accompagne son appel, si elle vient toucher tous les personnages, ne trouble pas l’intérêt que le jeune et le vieillard mettent à compter leur argent. Les visages des différents personnages expriment une certaine distance vis-à-vis de la scène : ont-ils de l’indifférence ? De la surprise ? De la défiance Matthieu a gardé une main posée sur ses pièces, mais avec l’autre il hésite à se désigner. Cette réponse au dialogue ouvert par le Christ nous fait douter que ce personnage soit bien celui de Matthieu. Il ne s’est pas encore levé, son expression est étonnée : toute la scène est dans l’instant où la grâce passe. Et le Christ attend la réponse de Matthieu qui va devoir laisser son argent pour suivre ces hommes dont les pieds nus expriment la pauvreté. Saint Pierre est situé entre le spectateur et le Christ. Il est celui sur qui le Christ a bâti son Église, médiatrice entre Dieu et les hommes. C’est ainsi l’Église qui répète à son tour le geste du Christ invitant à le suivre. Toute proportion gardée, je me place dans tradition de Pascal et de Caravage, tels, je l’espère, les personnages de Georges de La Tour.

Hélène Grimaud
M. A. : Peut-on dire que votre principe de composition est avant tout musical ? Vous faites de nombreuses références aux compositeurs et aux musiciens, notamment votre amie Hélène Grimaud, à laquelle vous consacrez des lettres émouvantes dans Solstices.
S. B. : Ma conception de l’écriture est aussi bien musicale qu’architecturale. Je cherche aussi bien à développer une ligne à l’horizon, que de faire que chaque page puisse être verticale. Sans doute ai-je le plus appris auprès des musiciens, je pense naturellement à Bach, chez qui tout est conçu comme un art de l’amour des notes entre elles. Pour aller plus avant, je dirais volontiers qu’on apprend mieux à écrire à écouter Glenn Gould qu’à potasser Roland Barthes. Je m’explique : Gould, quand il joue Bach, joue chaque morceau selon son énergie propre, mais encore dans une économie d’ensemble, comme si chaque morceau était une note d’une plus vaste partition, elle-même à entendre avec ce qu’on appelait « la musique des sphères ». Hélène Grimaud, rencontrée quand nous étions tous deux très jeunes, est une femme de génie. Je n’ai cessé d’être inspiré par elle, par tout ce qu’elle m’a montré dans un sens ascendant, avec un panache, une insolence, une liberté qui sont le propre des êtres marqués par l’étoile. J’aime que cette artiste n’ait rien sacrifié à la mode pour se gagner et obtenir d’être elle-même. Je lui suis reconnaissant de m’avoir démontré que les grandes figures du passé ne lui appartiennent pas, mais sont des tremplins pour pouvoir vivre nos vies à l’octave du destin. En arrière, quel travail ! Mais c’est le propre de nos vies qu’elles sont ce que nous en faisons. Je regrette de ne pas la voir plus souvent, mais elle est toujours au-devant de ce que je devine.
M. A. : Dans vos trois textes, vous abordez aussi de nombreuses figures d’inspiration comme Chénier, Novalis, Hölderlin, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Suarès, Paul Valéry, Gustave Thibon, Simone Weil, Armel Guerne, Jean Baudrillard, Lucien Jerphagnon et, naturellement, les deux maîtres de votre adolescence : Edmond Jabès et Emil Cioran. En relisant l’ensemble de votre trilogie, j’ai d’abord le sentiment qu’on peut la voir comme un formidable exercice d’admiration, pour les morts comme pour les vivants, ce qui nous tient en éveil, et ce qui donne du sens à nos existences. N’est-ce pas ainsi qu’il faut avant tout la lire ?
S. B. : Oui, sans doute. « Dans mon pays, on dit merci », comme l’a écrit René Char, - le même René Char qui a lui aussi l’œuvre de Georges de La Tour. Je le cite : « La reproduction en couleur du Prisonnier de Georges de La Tour que j’ai piquée sur le mur de chaux de la pièce où je travaille, semble, avec le temps, réfléchir son sens dans notre condition. Elle serre le cœur mais combien désaltère ! » Ces propos, je pourrais les tenir à mon tour au sujet de ceux que vous avez cité. Car si j’aime les citer, c’est parce que je les sais profitables à chacun. Pour moi, les grands écrivains sont des amis d’une folle prodigalité – peu importe qu’ils soient morts depuis des années. Au cœur de leurs écrits, ils sont plus vivants que quiconque. Par ailleurs, dans la tradition qui court de Baudelaire à Breton, en passant par Apollinaire, j’ai souci de parler de peintres vivants, que je tiens en haute estime. Ainsi de Stanislas Bouvier. Un ami comme le sont Paul Kichilov, Denis Polge, Pierre-Edouard et Augustin Frison-Roche. Sans les peintres, au même titre que les musiciens, manqueraient l’affleurement de l’invisible.
M. A. : De Mystica à Solstices, trois volets, trois textes qui peuvent être lus séparément ou à la suite. Ce sont des fragments. Si l’on prend la trilogie sous l’angle d’une trinité de textes, qu’avez-vous voulu y exprimer d’essentiel ?
S. B. : Ces trois livres forment une trilogie avec à chaque fois une singularité. Dans Mystica, je ne cite personne : je m’attache à Dieu et à nos silences, de refus, de connivence ou d’extase, en écho avec ce que nous ne savons pas déchiffrer de Lui, ou qui ne nous apparaît, par fulgurance, que dans une entrevision, où comme le dit la liturgie « les cieux s’ouvrent ». Par contraste, dans Météores, je dis les objets de mon amour, ce qui va des êtres, artistes ou amis, aux paysages, en particulier ceux de la Bretagne, la terre qui me décrit en profondeur ; enfin, dans Solstices, j’achève dans la passion, qui dit est la vérité de l’être, malgré la mort. Jeune encore, j’ai été très marqué par ce que saint Grégoire Palamas (1296-1359) appelle la théorie des énergies divines. Dans la tradition de saint Irénée de Lyon (140-200), le théologien explique que nous sommes convoqués par le Créateur pour participer à sa Création, et l’extasier. J’ai également placé ces livres sous l’invocation du Paraclet, à savoir le dernier terme de la Trinité, où chacun est appelé à manifester la Déité pour achever Dieu. Peut-être sont-ce des grands mots, mais je ne le crois pas : à nous de n’en pas démériter ! Puisque je parlais de Pascal, Caravage, Georges de La Tour ou Bach, qu’ont-ils fait d’autre ? Ils n’étaient pas différents de nous. Nous sommes seulement devenus en exil de nous-mêmes. Aussi, plutôt que de nous lamenter, quitte à en tirer parti, ayons la folie de reprendre la route.

Christ de Saint-Jean de la Croix de Salvador Dali
M. A. : Vos textes sont avant tout intimistes. Du premier sur votre père Goudji (L’Amateur, 2002), jusqu’à Solstices, c’est à la fois une œuvre foisonnante et en même temps très ramassée. Quelle cohérence peut y trouver un lecteur ?
S. B. : Il y a déjà la cohérence d’un style, qui renvoie à une vision. J’ai composé une rosace. En son centre, un feu indestructible – l’or du jour à son sommet, quand le disque du soleil est à son midi -, et sur chacune de ses branches, la lumière qui tombe sur elle selon les heures. J’ai écrit avec mes doutes, mes failles, mes erreurs, et j’ai essayé de ne pas chuter plus bas, mais de me ressaisir, selon une vérité que je sais plus forte que moi, et qui m’offre la joie. Pour moi, nulle différence entre mes livres sur Brahms, Rimbaud ou Cioran et le texte qui clôt Solstices, « Christos Pantocrator », où je m’interroge sur les visages du Vainqueur suprême. Je ne cherche rien de social, sinon à dire ce que personne ne veut plus dire, sinon entendre. Au fond du fond, je sais que la Croix est le centre, mieux : une certitude. Nonobstant, je persévère. Si je pense à toutes les victimes innocentes crucifiées, je le leur dois plus qu’à moi. À l’Enfer répond la voie non pas contraire, mais radicalement alternative : celle de l’amour. Au soir de notre vie, comme l’a dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur notre cœur. Après quoi, libre à chacun soit de s’arc-bouter sur ses certitudes, soit d’ouvrir une porte.
 Paru dans le n°41 de Livr'arbitres, Mars 2023.
Paru dans le n°41 de Livr'arbitres, Mars 2023.