Entretien avec Chantal Chawaf : « Je voulais dénoncer la condition de la femme dans un monde d’immigrés »

Chantal Chawaf est une femme de lettres, née en 1943 à Paris. Elle publie son premier livre en 1974. C'est Antoinette Fouque qui accepte son texte au sein de sa maison Les éditions des femmes, inaugurant ce que la critique de l'époque appelara l'écriture féminine (aux côtés d'Hélène Cixous, Catherine Clément, Julia Kristeva et Luce Irigaray). À travers son œuvre, Chantal Chawaf explore les thèmes de la relation mère-fille, du couple, de la guerre et de l'angoisse, se munissant des outils du langage et de l'écriture pour libérer la partie non verbalisée du corps et de la féminité, et donner ainsi voix à l'expérience directe intime d'une façon rarement abordée en littérature. À l'occasion de la sortie de son roman Les obscures, j'ai rencontré Chantal Chawaf au sein de la vénérable maison dirigée par Antoinette Fouque, au 33 rue Jacob, à Paris. Cet entretien est paru dans le numéro 19, du Magazine des livres,en septembre 2009. Il est désormais accessible dans l'Ouvroir.
Marc Alpozzo : Vous publiez votre nouveau roman, Les obscures, aux éditions des Femmes (2008), qui est une maison d’édition à vocation militante. Doit-on comprendre par-là, que votre roman serait un roman à thèse ?
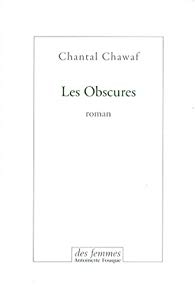 Chantal Chawaf : Veuillez m’excuser, mais je ne vois pas vraiment les choses de cette manière. Antoinette Fouque a été la première à me publier en 1974, et ça n’est pas une éditrice habituelle, mais unique, qui n’a aucun équivalent. J’ai certes publié ailleurs, mais Antoinette, c’est avant tout ma jeunesse, c’est la pureté face à ce monde de l’édition actuel. À l’époque, je découvrais ce groupe que je ne connaissais pas, et qui était fascinant de haut niveau intellectuel et de modernité. J’étais vraiment en état de grâce, et je captais ce vrai bouleversement qu’elle représentait et qui émanait d’elle.
Chantal Chawaf : Veuillez m’excuser, mais je ne vois pas vraiment les choses de cette manière. Antoinette Fouque a été la première à me publier en 1974, et ça n’est pas une éditrice habituelle, mais unique, qui n’a aucun équivalent. J’ai certes publié ailleurs, mais Antoinette, c’est avant tout ma jeunesse, c’est la pureté face à ce monde de l’édition actuel. À l’époque, je découvrais ce groupe que je ne connaissais pas, et qui était fascinant de haut niveau intellectuel et de modernité. J’étais vraiment en état de grâce, et je captais ce vrai bouleversement qu’elle représentait et qui émanait d’elle.
Dans ce roman, il y a deux femmes qui sont un croisé, une dont on ne peut pas dire qu’elle fut abandonnée mais dont l’enfance fut volée ce qui est plus grave, et l’autre qui fut délaissée.
Oui, mais le mot « abandon » est tout de même tout à fait juste en ce qui concerne les banlieues abandonnées. Ce sont des territoires de notre société littéralement livrés à eux-mêmes. Et en ce sens, on peut également dire que ce sont la littérature et l’art qui sont abandonnés. Toute la symbolisation des problèmes, même toute la révolution, ou en tout cas l’esprit de révolution qui refuserait ce que l’on impose, ce que l’on oblige, là où l’on néglige les humains, la santé, l’environnement, la paix, et dans tous les cas ce qui est bafoué de tous côtés, que ce soit les individus, le collectif, tout cela marginalisé. À présent, afin de les vivre et de les reconnaître, de les prendre dans les mots et de s’en faire humblement le porte-parole, individuellement et intimement, il faut se mettre dans la marge de cette marge qui n’est en fait pas du tout marginale, c’est la société qui est dans la marge du réel et de la modernité, tout en étant au centre. Il faut donc se mettre en marge de ce centre-là. Ce sont les marginaux, dont je parle. Marginaux dont certains se retrouveront dans les hôpitaux psychiatriques, ou les prisons, car de ces sentiments impossibles, afin d’être libre de réagir et de refuser d’être mal dans sa peau, ou d’avoir la liberté d’être mal dans sa peau dans ce que l’on vous impose d’accepter, et la liberté de refuser ce que l’on vous impose et qui va vous polluer, il faut partir, quitter irrémédiablement le système.
Dans votre roman, ressort nettement l’idée du sacrifice de la femme par la société. Par exemple, dans l’acte d’amour, valorisé par la littérature à tous les siècles, le conte pour enfant et son prince charmant, il y a l’enfermement du corps de la femme dévolue à un seul homme. La violence dans l’amour, la violence même de l’acte sexuel, de la « rage » sexuelle, puisqu’au final, la femme est considérée comme « sale ». L’homme doit se laver à grande eau après la copulation. C’est d’ailleurs inscrit dans le Coran.
Ce n’est bien sûr pas ma vision du sexe, n’est-ce pas ? Mais je voulais dénoncer la condition de la femme dans un monde d’immigrés qui sont en quelques façons en retard. Mon roman est un roman du sensible et non de l’intellect. Ça n’est pas un livre écrit en conformité par la logique, ou le rationnel, le phallique, donc qui suivrait toute ma formation. Il est écrit à partir du corps et du sensible, et s’adresse au lecteur à partir de ce qu’il ressent. Donc, ce qu’il ressent, à savoir ici le sexe et le sacrifice. Cette jeune femme qui est en rupture avec son milieu, à la limite, elle n’est même pas abandonnée, mais c’est elle qui abandonne ce milieu. Elle vient d’un milieu où il y a eu tricherie. Son propre milieu lui a été perverti, et elle a découvert trop tôt la tricherie sociale. À partir de cette découverte et de sa déception, elle abandonne tout, et entre dans un autre milieu social, celui des « abandonnés » de la société. Or, ce côté est extrêmement représenté par les immigrés, et le Maghreb, les Turcs, etc. Beaucoup d’exclus issus de la religion musulmane où la femme y est infériorisée, mal traitée, séparée, sans que cela ne l’empêche par ailleurs de faire des études, ou de bien réussir socialement, et même d’avoir du pouvoir. Par exemple en Syrie, il y avait des femmes ministres, alors qu’il n’y en avait pas encore une seule, ici, en France, ce qui permettait d’ailleurs de donner une caution au machisme là-bas. Cela dit, affectivement et sexuellement, dans l’inconscient de tous, l’homme était un maître ou un roi, alors que la femme, psychologiquement, ne se sent rien d’autre que la servante, la prêtresse de son dieu et du culte de l’homme. Cela est flagrant en Orient, et cela leur empêche d’avoir l’esprit critique. Et même dans des milieux très protégés, les femmes auront beau être universitaires et instruites, cela ne les empêchera pas de rester toute leur vie dans l’ombre de leur mari, car elles se seront complètement éclipsées. C’est autant l’éclipse que l’ellipse, d’ailleurs. Elles renoncent à tout. Elles sont dans le culte. Et c’est symbolique de tout ce que j’observe de ces femmes. Même si elles sont complètement libérées intellectuellement et culturellement, il y a quelque chose dans le sexe masculin qui est beau et supérieur, et cette adoration pour cela tient d’une forme de l’amour et de l’hystérie. C’est véritablement le rapport de force, à savoir le pouvoir à la place du sentiment. Cela représente l’adoration de la force et de la supériorité du sexe masculin, à laquelle les femmes sont conformes. Et de plus en plus, cela devient universel, et même « people ». Les gens sont en adoration devant tout ce qui est masculin : le nom, le pouvoir, le succès, l’argent, la force, la domination. Le contenu, cela ne compte pas. Que ce soit le sensible, ou ce que cela vaut, le mal ou le bien que cela peut faire, ça n’est pas cela qui compte. Donc nous sommes bien dans l’adoration. Vous êtes là devant ce qu’il y a de plus phallique, symbolisé par cette société dite « people ». Mais à l’état archaïque ou à l’état primitif, dans les sociétés en Orient ou au Proche-Orient, on retrouve le même phénomène dans le couple homme/femme. Et quand les femmes se voilent, cela veut dire qu’elles n’ont pas compris, ou bien qu’elles ignorent l’histoire durant laquelle elles ont été horriblement sacrifiées, minimisées, alors qu’elles descendaient d’une civilisation qu’on appelait les amazones. Notre civilisation a asservi les femmes. Et cela continue sous d’autres formes aujourd’hui, comme en banlieue.

On court, on court après la banlieue... © jean-pierre charbonneau
Vous dénoncez cela dans votre récit Infra-Monde, reprenant les termes violents et insultants qui sont utilisés part les garçons pour rabaisser les filles. Lorsqu’on vous lit, on croirait qu’il y a du documentaire dans vos romans.
Oui, c’est vrai. J’ai un côté journaliste cachée ou avortée. Je me mets en danger, et je suis très curieuse des êtres humains. Je vais dans des endroits où il peut y avoir du danger, car ce qui l’emporte chez moi, c’est la curiosité, l’intérêt, la compréhension, et pour cela, me rendre caméléon. Mais c’est vrai que dans les Obscures, il y a du grand reportage, et dans les dialogues il n’y a rien d’inventé. Je me fonds dans la chose, j’entends, et je note. J’ai de la mémoire. Je me mets là où l’on va me parler, j’écoute et je reçois tout cela. J’aime ce qui se rattache à l’humain, ça n’est même pas pour écrire, mais pour comprendre. Le sacrifice, par exemple. C’est une société qui sacrifie les femmes. Ces femmes qui se voilent ou qui le revendiquent, elles ne connaissent pas leur histoire, celle des sociétés Ottoman. Qui connaît aujourd’hui Dumézil, le grand spécialiste de ces sociétés ? On parle d’Europe aujourd’hui, et on ignore Dumézil. Et ce sont les hommes qui arrangent les choses. Tout est expliqué, justifié par les hommes, et le réel est censuré. Et bien sûr, ce réel, c’est celui de la femme, du corps, de la vie. Il faut même faire très attention à tout ce que l’on dit, lorsqu’il s’agit de l’Islam. On ne peut pas toujours parler librement sur le sujet. Pourtant, là-bas, il y règne un éternel masculin de l’homme oriental du Proche-Orient. Je l’ai vue, je l’ai subie, et j’ai analysé tout cela. J’ai envie de le dénoncer, mais je ne peux pas, alors je m’y suis prise comme cela. Car les conséquences, vous savez, peuvent être dramatiques parfois. Ce livre est né de certaines choses que j’ai entendues, c’est-à-dire de quelque chose qui n’est pas dans le livre. Si par exemple, les femmes ne jouent pas le jeu, vous n’imaginez pas. Ces femmes, souvent très attachées à leur mari, qui sont dans les pires souffrances, le pire manque affectif, le pire besoin, et l’abandon total. Et cela va de soi, le mari très pieux, est dans la religion. C’est une répudiation. Le mari répudie sa femme. À partir de là, très touchée par ces femmes qui ont besoin de leur mari, qui le cherche, ont besoin de lui, mais d’une cruauté et d’un sadisme, qui va de soi en Orient, les ignore, j’ai commencé mon roman là-dessus. C’est un roman qui démarre sur la banlieue, les immigrés, l’injustice, le malheur. Ces banlieues de pauvres, mais éclairés à partir de la souffrance des femmes, et celle-ci nous conduit tout de suite au problème refoulé ou tabou de comment ces religions, ces cultures, l’homme traite les femmes. Mais je ne pouvais pas le dire ainsi. Vous voyez l’anathème que l’on jette sur ce genre d’initiative intellectuelle. Mais en aucune manière, je ne suis contre les hommes, le corps, ou quoi d’autre. Il faut le préciser. Car attention ! Le personnage de mon roman, c’est tout à fait le père abusif, vaguement incestueux. Et cela tient de quelque chose de purement culturel : les femmes sont mises ensembles, et l’homme à sa vie. Certes, il revient à elles pour la procréation, aussi, il les adule comme des icônes intouchables, la virginité. Mais c’est tout. Pas de vrais contacts. C’est cela le monde de l’islam.
Mais n’est-ce pas également le monde chrétien ? N’y a-t-il pas un anathème jeté sur la femme par le christianisme ?
Complètement. Ce qui est intéressant, c’est lorsqu’on isole une région, une histoire, un personnage, ça n’est intéressant que si cela peut avoir une portée pour les autres. Donc, effectivement ! Vous avez sûrement raison. Mais ça n’est pas le sujet de mon texte, même si c’est également valable pour le christianisme, et que mon roman dénonce un certain religieux.
Dans vos textes, la banlieue est un thème récurrent. Ne serait-ce pas là, en réalité une métaphore pour dénoncer l’enfermement voire l’effacement de l’identité féminine ?
Ce sont les deux. Regardez les textes des « stars » d’aujourd’hui, Carla Bruni, Christine Angot, ou même dans la variété internationale, je pense à Madonna par exemple, pensez-vous qu’elles soient véritablement libérées ? Ne sont-elles pas, enchaînées et effacées d’une autre manières, présentées, voire se présentant, sous la forme d’objets sexuels ? C’est déifié, aujourd’hui. Plus que jamais. Cela me choque. Quel rapport cela a-t-il avec l’amour ? Un homme qui aimerait vraiment une femme par exemple, il la laisserait complètement libre. Mais je n’aimerais pas que cela passe ici, dans ce texte, comme une forme de loi absolue. Chez les Arabes, ou les Orientaux, vous trouvez des femmes complètement libres. Il y a même parfois sous le voile, une plus grande liberté dévolue aux femmes, un plus grand respect dû, que dans notre Occident contemporain, où la femme doit s’y « striptiser ». Il y a aujourd’hui un obscurantisme qui recouvre aujourd’hui notre société qui se dit si « ouverte ». Et en effet, j’ai été sensible à la souffrance de la femme sacrifiée.

La Mode des Femmes en Iran en 1970 avant la Révolution islamique
Et la banlieue, dans vos textes, cela sert à dénoncer en grande partie le machisme, la misère, l’humiliation, la déchéance, c’est la violence des hommes.
Je ne sais pas s’il faudrait le dire comme cela. Il y a une telle violence aujourd’hui, un tel climat de fanatisme, de communautarisme, de combats politiques, je n’aimerais pas être récupérée d’une manière ou d’une autre. Car les banlieues, ça n’est pas que cela non plus. D’ailleurs, mon personnage est une caucasienne pour éviter l’écueil politique. Je n’aimerais pas être récupérée par les racistes ou d’autres fanatiques. Et puis le Caucase, c’est notre origine aussi. Ils sont les ancêtres de l’Europe. Ça n’est donc pas aussi séparé que cela. Ils sont l’origine de notre Occident avant les Grecs. Et dans les mythologies des caucasiens, qui inspireront Platon pour son texte La République, puisque les caucasiens, venus des montagnes étaient les occupants de la Grèce avant qu’ils n'arrivent, avaient des valeurs très ouvertes, les hommes et les femmes étaient libres et égaux et respectés. C’était avant l’Islam. Et ce sont nos origines.
Pourrait-on relier cela a un thème inhérent à votre œuvre qui est celui de l’origine falsifiée ?
Dans mon histoire personnelle, je n’ai jamais été adoptée, j’étais volée. Il n’y a donc pas eu adoption, puisqu’on ne peut légaliser le vol, c’est un crime. Donc je n’ai pas été institutionnalisée, mais marginalisée, et en cela c’est une tricherie d’origine dans notre culture, il n’y a pas d’adoption. C’est la raison pour laquelle mes personnages recherchent ce que l’on nous cache et ce que l’on nous dérobe et nous dépouille. Mais je pense qu’il faut surtout parler dans ce roman, du culturel. Il y a des choses dans ce livre où l’on nous montre qu’elle ne sait pas, mais dans la réalité c’est un peu plus complet. Quand je me suis intéressé à la Cheikhesse, j’avais mon histoire, celle de la famille de mon mari, qu’on appelait, à l’époque de sa naissance, on les appelait les féodaux. Il était d’une famille féodale, et le père était le fils d’une Cheikhesse, car tel que le raconte Pierre Loti, quand le sultan veut anoblir une personne pour services rendus, lui donnait une femme de son harem, vierge, parfaitement éduquée, choisie pour sa pureté et sa beauté. Et le sultan avait donné au grand-père Chawaf, ma grand-mère pour son mari. Mais mon propre mari ne savait rien. C’est un oncle qui se rappelait sa mère, grand mince et blonde, et toute sa famille imbue de leur pouvoir et leur richesse et de leur terre, ne s’intéressait pas du tout à la Cheikhesse, elle n’existait pas, seul le père, le nom comptait. Et comme on m’avait séparée de mes origines, de ma famille, on avait mis de côté ma famille et mon histoire, cela a dû me parler. Mais ce qui compte, c’est ce que vous venez à l’instant dire, à savoir qu’on nous fait la même chose avec nos origines culturelles, historiques ; et puis même dans le corps de la mère, on refoule d’où l’on vient, ce que l’on a vécu durant neuf mois avant notre naissance. Les scientifiques savent des choses sur la vie embryonnaire et fœtale qui ne sont ni vulgarisées ni sues. Idem pour les origines même biologiques ne sont spiritualisées, symbolisées, et en ce sens, voilà pourquoi je reviens toujours chez Antoinette Fouque, vous savez, sa théorie de l’utérin et du symbolique de l’utérin et de la mère. Sa pensée est importante alors qu’elle est négligée, diffamée. Personne ne le prend au sérieux alors que c’est pourtant capital.
Et vous reliez cela aux corps que vous montrez « traumatisés ». traumatisés par le sacrifice qui se fait par la sexualité.
La sexualité socialisée selon un modèle. Dans la sexualité en soi, si elle était naturelle, vous serez d’accord, qu’il n’y aurait aucun sacrifice. Ce viol dans le livre par exemple, il est consenti, cherché. Il y a même un malentendu, elles cherchent un papa. Il y a quelque chose qui appartient à la régression. Alors qu’il n’y a pas de paternité. Car on pense souvent que les MLF sont contre les hommes, le père. Ce que je dénonce dans ce livre, c’est le manque du père, la défection du père. La défaite du père, et du masculin, de la virilité et de l’esprit chevaleresque. Tout cela manque à notre société. Elle est châtrée.

La révolution sexuelle après mai 68
N’y aurait-il pas alors, inspirée peut-être par la religion, une dialectique du viol et de la castration dans nos sociétés entre les hommes et les femmes ?
Mais bien sûr. Et souvent, on dit que les violeurs sont des hommes qui admirent trop les femmes, les mettant trop haut, qu’ils se sentent tellement châtrés qu’ils passent à l’acte.
Les obscures, c’est les femmes qui sont le mystère de la création, et les hommes, qui, pères que par ouï-dire, ne le vivent pas, n’ayant jamais le lien qu’aura la mère avec son fœtus et son embryon.
Vous savez, en ce qui concerne mon histoire, dès que j’ai appris à écrire, j’ai écrit de petits textes, et sans que l’on me dise mon histoire, la mort de mes parents, le bombardement de leur voiture, la petite fille, que j’étais, qui demeurait toute seule. On ne m’avait pourtant rien dit, mais j’écrivais cela. Voyez ! On enregistre ! Il y a une mémoire du corps qui s’oppose à la mémoire sociale, culturelle qui falsifie.
Qui est la conscience collective, et à l’inverse, il y a également l’inconscient collectif.
En effet. Aussi, dans ce roman, Les obscures, il n’y a pas cet éclairage qu’apporterait une harmonie du père et de la mère dans un rôle ou une éthique réelle, ni de l’homme ou de la femme dans une liberté d’émotion, de sensation et de corps, et ce qui est aussi important, sur le plan de l’écologie, l’individu totalement empoisonné, une pollution qu’on lui impose. L’individu qui se sent menacé. Qui sent bien qu’on lui impose des choses qu’ils avalent, sans savoir quoi, mais il le ressent tout de même.
Et on peut finir sur cela. En prenant le terme « Obscur », on pourrait également parler d’époque obscure.
Écoutez, je vous citerez in extenso, si vous me le permettez, ces quelques mots d’Edgar Morin qui me semblent très justes : « On peut supposer que l’inconscient collectif ressent obscurément la grande menace sur l’identité, le déracinement à l’égard d’un passé perdu, et l’insécurité d’un futur inconnu, la dégradation d’une qualité de vie. » C’est tout mon livre ! Voyez ! Yashar par exemple se retrouve psychiatrisée, elle ne s’adapte pas au système, dans sa nature de corps foncier, il y a rébellion. Mais inadaptée, on l’enferme. La fuite sera pour ces deux femmes dans mon roman, en devenant des sortes de hippies. Et entre les deux femmes, cela devient un conflit intériorisé. L’une contre l’autre, car on ne leur permet de vivre cette révolte que sur le modèle individuel, alors qu’elle devrait être collective. Donc communauté contre communauté. Ethnie contre ethnie. Chacun devient névrosé dans sa bulle. Deviens consommateur. On est dans une civilisation qui rend fou. Alors que ça n’est pas de la folie. Alors que quelqu’un qui reste naturel et proche de son corps ne peut plus marcher. Alors on dit que son corps ne fonctionne plus et on l’enferme. Par exemple, les hippies, une grande culture, qui n’avaient pas de mauvaises idées, on les a séparés, on a séparé leurs idées par la drogue. Là encore, ils ont été châtrés. Voyez comment on dresse, et comment on atomise le pays. On renvoie les gens à leur religion, leur communauté. Et c’est très très dangereux.

Chantal Chawaf
 Entretien paru dans le Magazine des livres, n°19, Sept-Oct 2009.
Entretien paru dans le Magazine des livres, n°19, Sept-Oct 2009.