Sartre et le regard d'autrui

On trouve, à propos du regard d’autrui, de très longues descriptions phénoménologiques dans le grand œuvre de Sartre, L’Être et le Néant. Elles vont ici occuper mon analyse. On verra ainsi comment une relation intime noue subtilement ma liberté au regard d’autrui. On verra également comment Sartre entraîne les consciences à ne pas savoir se hisser hors d’un conflit inextricable et infini. Cette longue étude est parue dans le numéro 15, des Carnets de la Philosophie, de janvier 2011. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
1. Le regard d’Autrui comme scandale
Je prends d’abord conscience de l’existence d’autrui par son corps. Par exemple, je vois cet homme à la machine à café du hall de l’université, et aussitôt, ce dernier m’apparaît comme un objet. Certes, dans cette « relation d’objectivité », je n’ai aucune certitude de son existence. Comment puis-je être sûr que ma perception ne me fait pas défaut ? Le problème bien sûr est cartésien. Mais Sartre sait se tirer de ce mauvais pas en montrant que la relation à l’autre ne s’épuise pas dans le champ de la connaissance abstraite. On ne trouve donc pas d’objectivation de la relation à l’autre. D’abord, parce qu’il s’agit pour Sartre d’en finir avec l’idéalisme établissant par exemple que cet ordinateur que je vois posé sur ma table de travail renvoie à une série infinie d’apparitions. Ensuite, parce qu’il veut, à la suite de Heidegger, nous montrer que l’homme n’est jamais enfermé dans son intériorité. Pour cela, il va montrer que ma liberté est livrée au regard d’autrui. Suivons l’exemple de Sartre : je suis installé dans un jardin public. Il y a des chaises le long d’une pelouse non loin de moi. Un homme passe près des chaises. Je vois cet homme marcher. Mais je ne le saisis pas une seule seconde comme chose parmi les choses. Certes, je le saisis comme objet, mais également comme homme. Je le saisis comme homme, et non en tant que seul objet, car je sais que je ne pourrais jamais le réduire à une chaise, ou à une poupée, et ainsi le ranger dans les « choses temporo-spatiales »[1]. Pourquoi ? Si cet homme se différencie des choses, et qu’ainsi, je l’en différencie, c’est parce qu’il peut, comme moi, distinguer cette pelouse, ces chaises. Il peut les percevoir comme je peux les percevoir. Je réalise alors que, ce que je tenais pour mon monde, m’est soudain « volé » par autrui. Ce monde qui était mon monde et dans lequel j’étais au centre, m’apparait soudain, par « l’apparition d’autrui », comme étant aussi le monde d’autrui. Cette décentration de mon monde en un monde pour autrui se fait par-devers « la centralisation que j’opère dans le même temps » (EN, p. 313). Néanmoins, autrui demeure un objet pour moi. On ne peut donc dire que mon monde m’échappe ; en réalité, il s’échappe à travers autrui. Le regard d’autrui est cause d’une désintégration partielle de mon univers, c’est-à-dire dans les limites contenues par cet univers, à la façon d’un trou de vidange ; le regard est cette faille ontologique par laquelle s’écoule perpétuellement mon monde. La lutte des consciences trouve là, dans le regard, une seconde vie. Cette désintégration de l’univers qu’autrui représente doit être comprise sur le mode symbolique. C’est-à-dire qu’autrui continue tranquillement de faire sa vie. Je suis là, au café Flore, en train d’écrire cet article. Autrui peut jeter un œil sur moi, mais en réalité, il ne voit rien, ni n’entend rien. Peut-être même me tourne-t-il le dos, tout entier absorbé à sa propre activité, lire Le Monde, prendre un café, bavarder avec un ami. Et pourtant, si je regarde cet homme, par exemple déplier et lire le journal du soir, je remarque que la rencontre avec autrui est dans le regard. « Au milieu du monde, je peux dire « homme-lisant » comme je dirais « pierre froide », « pluie fine » ; je saisis une « Gestalt » close dont la lecture forme la qualité essentielle et qui, pour le reste, aveugle et sourde, se laisse connaître et percevoir comme pure et simple chose temporo-spatiale et qui semble avec le reste du monde dans la pure relation d’extériorité. »[2] Par le regard, je fige l’autre en objet, en forme ou figure, et réciproquement. C’est dans cette seule mesure qu’autrui n’est pas constitué, mais seulement rencontré. C’est par là que se révèle l’antagonisme. Sartre conférant au conflit des consciences, – qui est le propre de ma relation à autrui –, un statut intégré à l’ontologie à partir du dévoilement de sa nature originelle. Autrui va soudain m’apparaître comme menaçant. Probablement même se révèlera-t-il à moi comme un « scandale » dans la mesure où, autrui n’étant pas seulement cet être qui, me volant mon monde, voit les mêmes choses que je vois, il est surtout celui qui me regarde : « Si autrui-objet se définit en liaison avec le monde comme l’objet qui voit ce que je vois, ma liaison fondamentale avec autrui-sujet doit pouvoir se ramener à ma possibilité permanente d’être vu par autrui. C’est dans et par la révélation de mon être-objet pour autrui que je dois pouvoir saisir la présence de son être-sujet. »[3] Probablement est-ce là la véritable rencontre avec autrui. C’est lorsque je m’aperçois que ses yeux ont erré sur la pelouse, ont embrassé le paysage environnant, et très naturellement, parce que je me trouvais à un endroit du paysage, sont venus se poser sur moi. Il est évident que je ne serai pas regardé comme la chaise sur laquelle je suis assis est regardée, ni comme la pelouse, ou ces arbres, etc. Pourquoi ? Parce qu’autrui que j’ai transformé par mon propre regard en objet, ne peux que me transformer à son tour en objet. « […] je ne saurais être un objet pour un objet » (EN, p. 314). Or, jusqu’ici, face à cet arbre qui me protégeait du soleil grâce à son épais feuillage, j’existais, j’étais là, assis, lisant un livre. J’agissais. Je faisais ce que j’avais à faire, sans y réfléchir. J’étais sur le mode irréfléchi. Je n’avais pas besoin de prendre conscience de ce que je faisais, ni même du fait que j’existais. J’étais sujet, et tout ce qui m’entourait ici, y compris autrui, était objet pour mon regard. Mais voilà qu’autrui apparaît et me regarde. Son regard change soudain tout. Ce ne sont pas ses yeux, c’est-à-dire « l’organe sensible de vision », que le regard masque. C’est le regard en lui-même qui me parait brusquement une menace posée sur mon monde, car ce « regard tourné vers moi paraît sur fond de destruction des yeux qui me « regardent » […] » (EN, p. 316). Maintenant que ce regard est posé sur moi, à la fois sans distance et en me tenant en même temps à distance, je prends conscience que je suis à présent regardé. Un rapport essentiellement hostile[4] s’engage entre autrui et moi. Je me sens soudain « vulnérable ». Autrui en me regardant me fait prendre conscience que je suis vu. Pris dans son champ de vision, son regard a ce pouvoir de me faire prendre conscience que je suis, et de ce que je suis. Je suis comme percé à jour. Je suis tombé dans le monde. Le regard d’autrui étant essentiellement lié à cette chute. Jusqu’ici, je pouvais bien écouter aux portes, comme je suis à la fois ce que je ne suis pas, et je ne suis pas ce que je suis, échappant à cette définition provisoire de moi-même par toute ma transcendance, je ne pouvais me constituer comme un homme jaloux qui commet là une indiscrétion. Mais voilà que j’entends des pas dans le corridor ; voilà que soudain, je surprends des yeux qui me regardent. Voilà que deux libertés adverses se menacent. Jusqu’ici, la conscience de soi existait sur le plan des « objets du monde ». Ce regard va à présent me figer, me stigmatiser. Je serais désormais celui qui écoute aux portes. La honte qui soudain me parcourt l’échine, puis tout le corps, prend naissance dans ce regard qui me surprend ; elle est « honte de soi ». Il me faut bien reconnaître que je suis comme l’autre me voit. La honte étant « reconnaissance de ce que je suis bien cet objet qu’autrui regarde et juge. Je ne puis avoir honte que de ma liberté en tant qu’elle m’échappe pour devenir objet donné. »[5] Cette analyse phénoménologique du regard nous apprend désormais que la présence d’autrui est nécessaire pour que je sois moi-même, c’est-à-dire pour que je sois extirpé du stade de conscience irréfléchie solitaire et que je sois ainsi constitué en conscience réfléchie jugée par autrui. Je ne pourrais désormais plus me réfugier dans la mauvaise foi[6], comme auparavant, cette mauvaise foi se transformant alors en aveu même de ma faute.

Huis clos – de Jacqueline Audry – 1954
Dans cette dialectique sujet-objet, opérée sur le mode du conflit des consciences, deux libertés s’expriment, l’une regardant l’autre et la jugeant, et, en faisant que soudain, cette conscience regardée ne s’échappe plus : « La liberté d’autrui m’est révélée à travers l’inquiétante indétermination de l’être que je suis pour lui »[7]. Ma liberté s’arrêtant lorsque le regard d’autrui se pose sur moi. Il y a cette « dimension d’être » qui me sépare de mes possibles par un « néant radical ». À présent regardé, je suis entre les mains de la liberté d’autrui. Il y a comme une liberté fausse chez Sartre. Je suis libre tant que le regard d’autrui ne m’a pas figé dans cette liberté qui se retourne contre moi. A la manière d’un libre-arbitre qui m’aurait été accordé pour pouvoir être jugé et châtié. Donc, autrui me regarde, et voilà que je suis ce que je suis. Je ne suis plus libre, mais un possible pour autrui, une probabilité pour lui[8]. Dépossédé, j’affirme cette honte comme mienne, alors qu’en réalité, elle est liberté d’un autre. Ma honte me révèle comme étant ce que l’autre voit de moi, en-soi. Rappelons-nous Garcin dans la cinquième et dernière partie de Huis-clos, pris au piège d’un trio infernal, condamné à vivre ensemble pour le reste de l’éternité, se lamentant : « Le bronze… (Il le caresse.) Eh bien, voici le moment. Le bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent… (Il se retourne brusquement.) Ha ! vous n’êtes que deux ? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. (Il rit.) Alors, c’est ça l’enfer. Je n’aurais jamais cru… Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le gril… Ah ! quelle plaisanterie. Pas besoin de grill : l’enfer, c’est les Autres. »[9] Les Autres ne sont là que le regard d’autrui. Il est porté sur moi ; il me révèle à moi-même ce que je suis objectivement ; ce regard est précisément le grill de l’enfer sartrien.

Cet article, paru dans la revue Philosophie pratique, n°9, jan-fev. 2012
2. Le regard d’Autrui comme miroir déformant
La pièce de Sartre Huis-clos, mettant en scène deux femmes et un homme enfermés dans une pièce censée représenter l’enfer, nous présente ce trio parfaitement diabolique qui est le propre même de la dramaturgie sartrienne. Nous l’avons bien compris, si l’homme vivait seul sur terre, c’est-à-dire à peine entouré d’objets (un arbre, une chaise, un animal, etc.) qui ne pensent pas le monde extérieur, il n’aurait pas à s’intéresser à sa liberté ; il serait entièrement libre. Il penserait le monde à sa façon, sans limite, puisque ce monde n’existerait en réalité que pour lui. Entouré d’autrui en revanche, l’homme doit tenir compte des autres ; notre pensée ne saurait se suffire à elle-même. Je l’ai démontré : le regard que je jette sur le monde, est en permanence contredit par le regard d’autrui. Entre ma liberté et la sienne, s’engage alors un conflit des consciences dont on ne peut réchapper. Ce conflit portant à la fois sur ma vision du monde qu’il me faut défendre contre la vision des autres qui viennent la heurter, mais également ma liberté. La liberté d’autrui ayant la fâcheuse propension à venir l’annexer, voire la supprimer, en détournant les choses des significations que je leur donnais jusqu’ici, pour leur en conférer de nouvelles. « Ce n’est pas, à proprement parler, que je me sente perdre ma liberté pour devenir une chose, mais elle est là-bas, hors de ma liberté vécue, comme un attribut donné de cet être que je suis pour l’autre. Je saisis le regard de l’autre au sein de mon acte, comme solidification et aliénation de mes possibilités. »[10] Je ne suis pas extrait du monde lorsque l’autre me voit, mais saisi dans la situation même où j’ai été surpris. Pris au piège du regard d’autrui, je suis soudain transformé en un quelqu’un au milieu du monde, par exemple cet homme qui est assis sur cette chaise, qu’il ne voit pourtant point. De fait, il y a quelque chose qui m’échappe, et qui est utilisée par l’autre en tant que ses propres possibilités. L’utilisation d’une cachette par exemple, que l’autre pourrait découvrir. Dans ce conflit basé sur le regard, chacune des consciences devient désormais le bourreau de l’autre, à l’image des personnages de Garcin, Estelle et Inès dans la pièce Huis clos, où chacun des deux autres, à tour de rôle, persécute le troisième, faisant de la présence du tiers un véritable sacerdoce. L’enfer étant ce tiers-là, intimidant, menaçant, paralysant, nous livrant aux tourments incessants par son seul regard. Mais ce qui est proprement caractéristique de la phénoménologie sartrienne, ce sont les mots mêmes qu’elle emploie, et qui semblent très justes en ce qui la concerne : le regard d’autrui est un « regard guetteur », une « arme braquée sur moi » (EN, p. 322). Certes, j’apprends qu’il me met en joue, car je le vois dépasser l’arme et la désarmer. Mais aurais-je pu seulement me cacher de lui ? Sartre vous répondrait bien évidemment par l’affirmative. Et pourtant, à tout moment, il peut me débusquer, me démasquer, m’identifier ; cette cachette devenant, pour lui, à la fois un obstacle, mais également un moyen, c’est-à-dire un instrument qu’il pourrait utiliser contre moi. Que faut-il donc retenir de cette dialectique conflictuelle ? Précisément la mort de mes possibilités, car autrui représente concrètement la mort cachée de mes possibles. En effet, ce « guetteur » peut à tout instant me surprendre dans ma cachette, et aliéner cette liberté qu’il n’est pas. Il se transforme en un témoin de mes possibilités, il en calcule les effets, tout en se plaçant devant ma liberté et mes possibilités. Son jugement porté sur moi m’échappe alors. Certes, grâce au langage, je peux avoir quelques informations, mais me ravissant mon monde et ma liberté, autrui fait de ceux-ci, ainsi que de mes possibilités, une esquisse-fantôme qui m’atteint au plus profond de mon être. Cela me révolte, m’enrage, me fait honte. Que dois-je assumer ? Je ne sais pas. Je suis simplement ce qu’il pense que je suis. On retrouve dans cette idée, le symbole du miroir, – qui apparait d’ailleurs à plusieurs endroits de la pièce de Sartre[11]. Ce jeu de miroir est précisément celui du regard que nous jetons sur autrui. Symboliquement, le miroir est le regard dans lequel nous nous regardons ; un regard nous permettant de nous considérer comme objet, c’est-à-dire comme les autres nous voient, ayant là, la possibilité de réintégrer notre unité, en transcendant notre dualité sujet-objet. Par exemple, lorsqu’Estelle tentait autrefois, de son vivant, de surmonter son existence artificielle et d’ainsi se retrouver, en multipliant les miroirs dans sa chambre à coucher[12]. Le miroir devenait là, une sorte de réconfort. Je me regarde à la fois sujet-regardant et objet-regardé, cela me permet de croire que je pourrais ainsi me retrouver moi-même. Ce que j’apparais aux yeux des autres n’est probablement pas ce que je pense de moi-même. Mais ce regard, à la fois posé sur moi et pesant sur moi, vient me donner de la consistance et me définir. La vérité de mes actes m’échappant continuellement, c’est le regard de l’autre qui me permettra d’accéder à telle ou telle pensée de moi-même. Pour autant, le regard d’autrui est un miroir bien plus cruel. « Avec le regard d’autrui, la « situation » m’échappe ou, pour user d’une expression banale, mais qui rend bien notre pensée : je ne suis plus maître de la situation. […] l’apparition de l’autre fait apparaître dans (une) situation un aspect que je n’ai pas voulu, dont je ne suis pas maître et qui m’échappe par principe, puisqu’il est pour l’autre. »[13] Soit. Établissons ainsi que nous devenons, en permanence, dès qu’autrui apparaît, l’objet de son regard. Or, que ce regard puisse nous déformer à volonté pose évidemment problème. Car je suis précisément aliéné au regard d’autrui. Pour comprendre, prenons un dernier exemple tiré de la pièce de Sartre : Inès propose à Estelle, – qui ne dispose d’aucun miroir –, d’être le sien, si cette dernière se penche sur ses yeux. Mais voilà qu’à cet instant Inès dit, perfidement, à Estelle : « Là ! là ! Je suis le miroir aux alouettes ; ma petite alouette, je te tiens ! Il n’y a pas de rougeur. Pas la moindre, Hein ? Si le miroir se mettait à mentir ? Ou si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder, que ferais-tu de toute cette beauté ? »[14]. Essayons de comprendre. Je suis immergé dans l’espace et le temps, ce qui signifie que ma présence et simultanée dans le monde à celle d’autrui, et que ce verre est au même moment ce verre pour moi comme pour Paul. Dans son temps, autrui m’emmène avec lui, c’est-à-dire que son regard porté sur moi me confère soudain un temps nouveau pour moi. Qu’est-ce qu’Estelle pense de son propre visage ? Elle ne le sait pas elle-même. Je suis immergé dans le présent temporel partagé avec autrui ; dans ce temps universel où je lui apparais, ma présence à un dehors, c’est-à-dire que le regard d’autrui peut me croquer, au sens où l’artiste-peintre immortalise une personne en acte sur une toile blanche ; je suis alors cet objet spatio-temporel qui s’offre au jugement d’autrui. Rappelons-nous cette fameuse supplication, « Miroir ! Miroir ! Dis-moi qui est la plus belle » prononcée par la marâtre du conte des frères Grimm, Blanche-neige. Précisément, dans cette histoire, le miroir dit la vérité au grand désespoir de sa propriétaire. Mais peut-on attendre autant d’objectivité de la part d’autrui dont la liberté d’affirmer, de douter, de nier, de dénier, etc. semble entièrement en son pouvoir. Cette contingence, liée au regard, et au jugement d’autrui, accroit la lutte et les rivalités. Certes, les trois protagonistes du Huis-clos de Sartre ont chacun un lourd pêché sur la conscience. Ces derniers auraient été des hommes exemplaires, cela n’aurait rien changé à l’affrontement, et à la violence qui pèse sur eux. Lorsqu’autrui me regarde, je perçois bien que plus rien ne me sépare de lui. Son regard vient là de s’affranchir de toutes les distances, de toutes les frontières. Je suis désormais réduit, constitué par autrui, à un être « sans défense ». Cette liberté que je crains n’est pas la mienne, mais celle d’un autre. Je suis ainsi réduit, par son regard, à l’état d’esclavage. Pas au sens de l’esclave de Hegel, dans la dialectique du maître et du serviteur. Je suis esclave non point d’une conscience dont j’aurais reconnu la liberté, mais de cette liberté inconditionnée appartenant à autrui qui peut, à tout instant, me clouer sur place et me figer dans des possibilités qui ne sont pas mes possibilités. Le regard de l’autre est ainsi une liberté étrangère qui me possède, c’est sa liberté qui me dépouille de la mienne. Et cela, éternellement. Inès révèlera-telle à Estelle la vérité sur sa grande beauté, ou au contraire se plaira-t-elle à (se) jouer sadiquement de sa souffrance ? L’autre peut m’attribuer l’identité qui lui plaît. Une question qui précisément nous renvoie au problème de l’angoisse sartrienne. Est-elle une angoisse libératrice[15] ? Autrement dit, l’angoisse que je ressens au moment où je prends conscience de ma liberté est-elle en réalité angoisse devant moi ou au contraire angoisse devant autrui ? Bien sûr, Sartre nous reprochera de ne pas voir qu’il envisage la rencontre d’autrui comme une libération, c’est-à-dire que le regard d’autrui jeté sur moi est là l’occasion de me constituer en être pour-autrui, ce qui peut largement représenter un événement absolu pour moi. Le regard qu’autrui me porte est certes pénible parce qu’objectivant, mais il n’est pas désagréable de se sentir ainsi transformé en objet, d’autant que sans ce regard objectivant qui est la médiation entre moi et moi-même, jamais je n’accèderai à la deuxième dimension de mon corps, pour que la conscience se révèle elle-même comme corps pour l’autre[16]. Pensons à Estelle qui, s’adressant à Inès, lui dit : « quand je ne me vois pas, j’ai beau tâter, je me demande si j’existe pour de vrai. »[17] Mais voilà, par ce regard, je suis comme « figé au milieu du monde ». Le regard d’autrui m’a pétrifié[18] en me renvoyant à ma contingence fondamentale. Je ne me saisis donc pas comme objet pour moi-même. Si je veux me délivrer de lui, lui échapper, ne serait-ce qu’un instant, il me faut le faire comparaître à son tour devant moi comme objet. Je m’affirme alors comme sujet devant l’autre, en choisissant de l’objectiver[19]. Aussi, dans cette dialectique en forme de jeu de miroirs, je deviens tour à tour sujet et objet, puisqu’il m’est loisible de me délivrer d’autrui, en le tournant en objet par mon propre regard. Et inversement.
Aussi, ce que je reprocherais à Sartre, dans ce perpétuel renversement des rôles, c’est qu’il ne laisse guère de place pour la reconnaissance mutuelle, égale et réciproque, puisque la conscience ne peut être à la fois sujet et objet, c’est-à-dire maître et sujet. Sartre s’en tient au deuxième stade de la dialectique : dans un conflit perpétuel, la relation entre les consciences sartriennes devient nécessairement une lutte à mort par l’intermédiaire de la violence du regard d’autrui. Dans ce chiasme des consciences, la relation devient jeu de miroir, au point que l’Autre se transforme en une inquiétante étrangeté pour moi. Dans son insaisissable présence, s’établit une ontologie de l’aliénation – l’erreur sartrienne aura été, selon moi, de définir essentiellement ma relation à l’autre par la conscience et sa négation active. Sartre voulait réfuter le Mitsein heideggérien. Pour cela, il ne pouvait fonder ontologiquement la relation intersubjective dans la coexistence, mais dans la lutte des consciences[20]. Aussi comprend-on désormais l’utilisation constante par Sartre d’un vocabulaire négatif pour décrire la relation intersubjective, telle « chute », « aliénation », « fuite vers », « désintégration », « décentration de l’univers», ou encore « l’autre m’a volé mon monde ». Bien évidemment, le lecteur ne trouvera point étonnant à présent, que les personnages sartriens les plus célèbres, probablement, soient enfermés ensemble, et pour l’éternité en enfer, tant le monde de Sartre est un champ de batailles infernal, où les consciences n’ont guère d’autre choix, que de se combattre, plongées dans une relation intersubjective, fondée sur la violence et l’agressivité, et dont la seule issue est la dualité permanente[21].

Jean-Paul Sartre
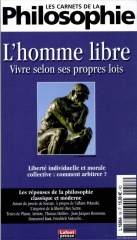 (Paru dans les Carnets de la Philosophie, n°15, jan-fev-mars 2011, et dans la revue Philosophie pratique, n°9, jan-fev. 2012.)
(Paru dans les Carnets de la Philosophie, n°15, jan-fev-mars 2011, et dans la revue Philosophie pratique, n°9, jan-fev. 2012.)
[1] Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, EN, Paris, Gallimard, 1943, pp 311.
[2] EN, pp 313-314.
[3] EN, p. 314.
[4] G. Marcel, L’Existence et la liberté humaine chez Jean-Paul Sartre, Paris, Vrin, 1981, p. 65.
[5] EN, p. 319.
[6] Voir EN, « La mauvaise foi », Chapitre II, p. 85 sq.
[7] Ibid, p. 320.
[8] F. Jeanson, Le problème moral et la pensée de Sartre, Paris, Le Seuil, 1965, p. 214.
[9] J.-P. Sartre, Huis-clos (HC), Paris, coll. « Foliothèque », Gallimard, 1947, p. 93.
[10] EN, p. 321.
[11] Il est intéressant de noter que ni le personnage de Garcin, ni celui d’Estelle ne supporte l’absence de miroir dans leur « cellule ». Voir à ce propos, HC, p. 24 et 43-45.
[12] « Il y a six grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois. Mais elles ne me voient pas. Elles reflètent la causeuse, le tapis, la fenêtre… comme c’est vide, une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m’arrangeais pour qu’il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler. Je me voyais comme les gens me voyaient, ça me tenait éveillée. (Avec désespoir.) Mon rouge ! Je suis sûre que je l’ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace pour l’éternité. » Ibid, p. 45.
[13] EN, pp. 323-324.
[14] HC, p. 48.
[15] Comme c’est en effet le cas chez Heidegger.
[16] Cf. EN, Troisième partie, Chapitre II.
[17] HC, p. 44. Voir également, J.-P. Sartre, Le sursis (Les chemins de la liberté, t. II), Paris, Gallimard, 1945, Le livre de poche, p. 469 : « On me voit, donc je suis […] Celui qui me voit… me fait être ; je suis comme il me voit. »
[18] Ne perdons pas de vue que Sartre écrit : « la pétrification de l’en-soi par le regard de l’autre est le sens profond du mythe de Méduse » (EN, p. 502.) La métaphore et la référence au mythe exprimant alors parfaitement la violence de la métaphysique sartrienne du regard.
[19] Deux attitudes fondamentales sont possibles : première attitude, appréhendant le pouvoir d’autrui de m’objectiver comme destructeur de ma propre capacité à l’objectiver, je choisis de l’ignorer, en le haïssant, ou le méprisant par l’indifférence. Désormais, serein, tranquille et sûr de moi, j’ignore que je puis avoir un corps-pour-autrui, puisque j’ai réduit l’autre à l’état d’objet, c’est-à-dire qu’il apparaisse ou disparaisse, il ne m’affecte pas plus que cette chaise en face de moi, ou cette pierre. C’est un projet de mauvaise foi qui, par la cécité, ne permet pas au projet fondamental du pour-soi de se fonder et de parvenir à ses fins, puisqu’il nie être vu et objectivé, alors que cette négation du fait n’a pas empêché pour autant le regard d’autrui de se poser sur lui. Seconde attitude, à travers mon désir de l’autre, je me révèle comme chair. C’est-à-dire que dans l’amour, le langage ou le masochisme, la stratégie consiste cette fois-ci, à récupérer mon être-pour-autrui en me faisant objet pour l’autre, et à accepter totalement d’être regardé d’un regard objectivant. Par exemple, dans la relation amoureuse, je cherche à me faire aimer, c’est-à-dire à être objet pour l’être aimé. Si ce dernier consent à me donner son amour, alors il le fera en tant que sujet, et m’aimera en tant qu’objet. Inutile donc de préciser ici, que les deux attitudes sont vouées à un terrible échec, en ce qui concerne la relation d’égal à égal entre les consciences.
[20] Contre les notions heideggériennes de Dasein et d’être-au-monde, Sartre se replie sur les principes fondamentaux des métaphysiques cartésienne et hégélienne. Mais n’oublions pas, en ce qui concerne le problème du regard d’autrui, et de l’interprétation sartrienne de la thèse de Hegel, que la dialectique hégélienne du maître et du serviteur est triadique. Or, s’il est vrai que dans un premier temps, la lutte des consciences empêche que la reconnaissance puisse être réciproque, – au terme d’une lutte à mort l’une des deux consciences sera asservie par l’autre –, par un système de dialectique ascendante, le serviteur, grâce au travail et à la culture, parviendra, à terme, à une reconnaissance de soi, c’est-à-dire à devenir pleinement homme, tandis que le maître trouvera, dans sa position, une impasse, puisqu’il a été reconnu par un individu qu’il n’a pas lui-même reconnu. Or, nous l’avons constaté ici, la triade hégélienne est réduite par Sartre à une relation intersubjective parfaitement binaire, dans laquelle chaque conscience tente de ramener l’autre au statut peu enviable d’objet, sans espoir, ni libération par la forme du dépassement dans la synthèse.
[21] Probablement Sartre voulait-il valoriser la « singularité » de chaque conscience dans son pro-jet contre « l’intuition heideggérienne […] de l’équipe » (EN, p. 303) où les individus se mettent ensemble pour accomplir un projet commun. Mais on voit là que la singularité de la conscience et de son pro-jet a été forcée, au point de se demander, si Sartre n’avait pas ignoré que, précédent un réel retour sur soi, aucun homme, dépendant d’une communauté et soumis aux mêmes valeurs, ne trouve, comme par enchantement, sa singularité propre, n’étant en réalité au départ, qu’une mimésis, c’est-à-dire une copie de la copie, si je puis m’exprimer ainsi.
Commentaires
Bonjour,
Est-ce que l'image sur la première page sur autrui représente un tableau et de qui serait-il ? Quelle interprétation ? Merci.
Cordialement,
C. MORIN