Éloge de la rencontre. Un cheminement de l'autre à soi

Cet article a d'abord été une allocution que j'ai prononcée à Spa, en Belgique, le jeudi 24 février 2022. Le Spa Waux-Hall Club m'a invité à un Dinner Business Meeting, afin d'y débattre de la vraie rencontre, qui ne se nourrit ni du désir, ni de l'utilité, ni du plaisir mais de l'attention portée à l'autre en tant qu'il est un autre moi - c'est-à-dire une fragilité et un infini. Voici désormais cette allocution en accès libre dans l'Ouvroir.
1.
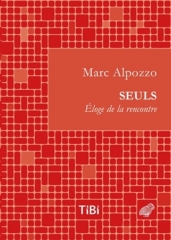 Bonsoir à tous, le thème de ce soir est la rencontre. C’est un thème fondamental en philosophie, puisque la rencontre suscite toujours en nous la curiosité, mais aussi la défiance et le changement. Dans le choc de la rencontre, je ne peux sentir qu’un trouble et une surprise. Or, en faisant un petit détour par l’étymologie, nous découvrons que là où le français dispose du seul verbe « rencontrer », le grec ancien en a deux : apantò, rencontrer, mais aussi tugkàno, qui signifie rencontrer par hasard, ce qui laisse évidemment penser à cette fissure soudaine à laquelle je ne m’attendais pas, qui vient me décentrer, briser ma carapace identitaire. La rencontre serait donc due au hasard, serait involontaire et inattendue. Pourquoi donc « involontaire » et « inattendue » ? Peut-être parce que dans la rencontre je fais l’expérience d’une inconnue à laquelle je ne m’attendais pas, cette inconnue étant l’altérité, autrement dit ce qui n’est pas moi et que je n’attendais pas. Dans la rencontre je fais donc l’épreuve du réel. Je passe de l’idéal, ce à quoi je m’attendais, au réel, ce qui vient me surprendre et me dérouter.
Bonsoir à tous, le thème de ce soir est la rencontre. C’est un thème fondamental en philosophie, puisque la rencontre suscite toujours en nous la curiosité, mais aussi la défiance et le changement. Dans le choc de la rencontre, je ne peux sentir qu’un trouble et une surprise. Or, en faisant un petit détour par l’étymologie, nous découvrons que là où le français dispose du seul verbe « rencontrer », le grec ancien en a deux : apantò, rencontrer, mais aussi tugkàno, qui signifie rencontrer par hasard, ce qui laisse évidemment penser à cette fissure soudaine à laquelle je ne m’attendais pas, qui vient me décentrer, briser ma carapace identitaire. La rencontre serait donc due au hasard, serait involontaire et inattendue. Pourquoi donc « involontaire » et « inattendue » ? Peut-être parce que dans la rencontre je fais l’expérience d’une inconnue à laquelle je ne m’attendais pas, cette inconnue étant l’altérité, autrement dit ce qui n’est pas moi et que je n’attendais pas. Dans la rencontre je fais donc l’épreuve du réel. Je passe de l’idéal, ce à quoi je m’attendais, au réel, ce qui vient me surprendre et me dérouter.
Mais on trouve également un autre substantif, sumbolè qui signifie rencontre, un rapprochement, une contribution, la notion d’engagement (dans un combat). Ce rapprochement n’est pas inintéressant, car il renvoie à la rencontre, sous sa forme la plus noble, puisque ce terme ayant donné « symbole » en français fait référence à un rituel de reconnaissance éminemment « symbolique ». Si sumbolon désignait un objet coupé en deux (souvent un morceau de poterie) lors de la rencontre de deux hôtes, chacun en conservait la moitié qu’il transmettait à ses enfants. Cela nous permet d’établir que la rencontre incombe aux deux parties rapprochées à faire reconnaître les porteurs et à prouver les relations d’hospitalité contractées antérieurement. Le « symbole » est donc un signe conventionnel, il témoigne dans une culture de l’obligation de rencontrer.
Dans son acception plus courante, le verbe rencontrer signifie à la fois le fait de se trouver en la présence d’autrui sans l'avoir cherché. La rencontre serait donc souvent inattendue et fortuite. Mais c’est aussi une entrevue, une conversation concertée entre deux ou plusieurs personnes, une rencontre entre hommes d’affaires ou chefs d'État. Ça peut être aussi un colloque, une conférence comme ce soir, un rendez-vous, une réunion, une compétition sportive, un combat, un match, une partie, un engagement, un combat imprévu entre deux détachements ennemis en mouvement, un duel, un combat singulier. Mais c’est aussi le fait d'entrer en contact ou en collision, un peu comme un choc, un heurt, un tamponnement, un télescopage. Bref, on le voit ici, une rencontre implique au moins deux personnes, ou une chose, comme une ville, une maison, un livre, ou que sais-je encore...
Si donc notre réflexion nous porte du côté de la philosophie, elle est tout autant anthropologique et sociologique, et émerge non seulement des modalités de la rencontre, mais encore de ses aléas. La rencontre est donc ce qui nous surprend, nous prend de cours, nous ébranle, et nous dépossède peut-être même. La rencontre permet de déployer en nous des ressources insoupçonnées grâce au choc de la découverte (de l’autre et peut-être de soi) grâce à la découverte de l’autre. Une question cependant se pose : comment vais-je pouvoir rencontrer l’autre, en me défaisant de moi ? Souvent les rencontres sont superficielles, car chacun cherche à préserver son identité. Les rencontres peuvent même déboucher sur une lutte pour conserver sa puissance. Ce que je dois faire dans la rencontre semble donc moins chercher à changer l’autre qu’à l’accueillir, cela consiste donc moins à lui imposer mon identité et mon monde qu’à entrer en contact avec son identité et de son monde. Car l’autre demeure un mystère. C’est en m’intéressant à sa complexité, la dualité qui est en lui et qui est en moi que j’ai une chance de réaliser une vraie rencontre.
Lorsque donc, l’on m’a proposé de réaliser cette conférence, j’ai choisi très spontanément le thème de la rencontre pour deux raisons : d’abord, parce que j’ai écrit un petit livre sur la rencontre en 2014 (Seuls. Éloge de la rencontre, Les Belles lettres), mais surtout parce que cette pandémie et ses mesures sanitaires, semble remettre en cause la rencontre, la relation à l’autre, jusqu’à nous transformer en petits dictateurs de poche, maîtres de notre univers personnel contre l’univers de tous les autres. C’est aussi parce que j’ai commencé un livre qui s’intitule Je parle à de masques, qui a pris naissance le mercredi 16 septembre 2020 au matin, lorsqu’assistant à une conférence dans une salle de cinéma de la rue de Rennes à Paris, l’organisatrice nous a demandé de laisser un siège entre chaque participant, en précisant ceci : « N’oubliez pas que le vrai souci c’est l’autre ! »
La réflexion qui va suivre est donc partie inspirée de cette période troublée, qui a fait suite au confinement décrété à partir du 17 mars 2020 en France et aux mesures sanitaires mises en place pour combattre le Covid-19, et dont le corollaire aura certainement été l’installation d’une société hygiéniste, où chacun est devenue une menace pour chacun. Et si je qualifie ces mesures, qui relèvent de décisions politiques quasi-militaires, d’« hygiénistes », c’est parce qu’elles m’ont apparues comme des mesures à l’origine d’un nouveau mode de « misanthropisme », basée sur la méfiance et la défiance vis-à-vis de l’autre homme, recherchant en lui le bacille à éliminer.
Là où la rencontre montrait quelque chose de spontanée, d’inattendue, ce qui avait pour vertu de nous mettre en joie, désormais elle nous oblige à aller à l’encontre de l’autre, non plus parce que ce qui en jaillit va à l’encontre de l’attendu, mais parce que ce qui apparaît n’est autre que source d’anxiété, de peur, voire de défiance.
Ce qui sera donc au centre de cette réflexion, c’est une critique, qu’il sera important d’enraciner dans la question à mon avis majeur, et qui se pose (ou s’est posée) depuis l’interdiction des embrassades et des serre main, et dans les distances physiques qui nous ôtent toute la joie et la fragilité de la rencontre, nous impose de voir l’autre désormais comme un danger potentiel.
C’est donc à partir d’une question fondamentale : sur quoi repose la rencontrer avec l’autre ? qu’il sera nécessaire de se demander de quoi l’urgence de la rencontre est-elle le nom.
2.
Le masque et les gestes barrières en ont rajouté dans cette représentation de l’autre comme un ennemi potentiel, puisque cela induisait que le virus était finalement moins un problème que l’autre lui-même, ce qui revenait sûrement à penser, que cette dame lors de la conférence n’avait pas tort de dire que « l’autre était un souci ». Mais si le vrai souci c’est l’autre, n’est-ce pas le réduire à un objet menaçant, qui empêche de le penser dans sa dimension transcendante ?
Est-il tenable de ne penser l’autre qu’à travers la défiance ?
Dans l’amitié ou l’amour par exemple, on ouvre toujours son monde à l’autre et inversement. Si chacun conserve son monde, on apprend à voir le monde de l’autre avec ses yeux, on essaye de se mettre à sa place, on se place dans une recherche d’harmonisation, de mise en commun. L’amour ou l’amitié n’a pas besoin d’être réciproque. Si l’on veut combler un manque grâce à un partenaire, alors on est du côté du désir platonicien. Si l’amour n’est pas réciproque on est frustré. Mais si l’on ne cherche pas à satisfaire son désir, et que la seule idée que la personne que l’on aime existe nous met en joie, alors on est du côté de Spinoza, et l’on est satisfait. On voit donc que l’autre n’est jamais un souci, si l’on veut son bien, si on l’aime de manière désintéressée.
C’est peut-être dans ces termes que nous devons penser le « penser-à-l’autre ».
Ce terme, je le tiens d’Emmanuel Lévinas. Pourtant, j’ai observé qu’avec le virus, les gestes barrières et le masque, notre relation à l’autre s’est progressivement mise à changer ; la distanciation physique a accru l’agressivité et la défiance.
3.
Pourtant, en observant les gestes barrières demandés, ne nous inscrivons-nous pas dans une politique du care, ce qui implique qu’une relation étroite à l’autre demeure, mais sous la forme de la prévention, du soin et de la bienveillance. L’éthique du care, en voulant valoriser les qualités d’attention à autrui et les activités de souci des autres, cache peut-être aussi une autre réalité derrière ces règles hygiénistes et qui se résume en une phrase : l’autre (mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ma tante, mon épouse, mon époux, mon fils, ma fille, mon voisin, etc.) est un danger pour ma santé et ma vie et je suis un danger pour la sienne. Si le masque aura été l’objet symbolique destiné à me le rappeler à chaque instant, cette rencontre produit une modification essentielle qui peut être tout à fait délétère.
Car voilà que je deviens obsédé par l’autre.
Or cela ramène la rencontre à l’origine même du mot, qui était « l’encontre », et qui nous vient du bas latin incontra, ou du latin classique, contra, et qui évoque l’idée d’une confrontation. Une rencontre commencerait donc par être contre soi. La rencontre irait d’abord à l’encontre de ce que je suis, me modifierait, me remettrait en cause sur un plan existentiel. Lorsque je découvre autrui, lorsque l’autre m’apparait je vis un choc, un moment de grande modification.
Mais qui est cet autre dont on parle ? Comment définir l’autre, autrui ? Lévinas nous dit qu’« autrui en tant qu’autrui, n’est pas seulement mon alter-ego. Il est ce que je ne suis pas ». Autrui est donc celui qui n’est pas moi, celui que je ne suis pas. Mais en même temps, il est très proche de moi, puisqu’il appartient à la condition humaine. Donc, semblable et différent, proche et distant, autrui est aussi celui dont je ne peux me passer et celui qui parfois m’insupporte, ce que Kant décrivait parfaitement avec le concept d’insociable sociabilité, qui tiraille l’homme entre deux choses antagonistes : la nécessité de s’associer à d’autres hommes, et donc de participer à une vie collective, et le désir de rechercher à satisfaire son intérêt personnel, donc de vivre de façon individualiste. Mais autrui est surtout celui que j’ai le devoir de reconnaitre comme sujet, sans quoi je ne saurais moi-même me reconnaître comme sujet. Comment puis-je cependant le connaitre et le reconnaître ? Et surtout, comment puis-je m’entendre avec autrui ? Surtout si entre autrui et moi il n’y a que de la défiance ?
4.
Si donc la crise du Covid a présenté autrui comme une menace, qu’il nous a inspiré de la défiance à son égard, cette définition d’autrui n’est pas non plus étrangère à la philosophie. Cette définition n’a même rien d’étrange, on l’a vu avec Kant plus haut, et elle me fait penser à la conception pessimiste de l’homme du philosophe Hobbes. Pour établir son contrat social, Hobbes, adhère à une conception rigoureusement mécaniste de l'univers : l'homme est défini par le désir, la volonté de sauver sa vie et de jouir des plaisirs ; sa conduite est commandée par l'intérêt. Une telle conception exclut la question du régime le meilleur, à moins que l'on ne commence par déterminer le but que vise, avant tout autre, l'homme soumis à un mécanisme strict. Selon Hobbes, un tel but existe, simple, prosaïque, qui est de survivre. Les hommes étant le jouet de leurs passions sont ennemis les uns des autres, quand ils n'obéissent pas à une loi commune. D'où le problème central de Hobbes : que doit être le régime politique pour assurer la paix entre les hommes ? Voilà que nous retrouvons la question du masque, des gestes barrières, du confinement, de la défiance que le virus, le bacille inspire en nous, dès qu’un autre s’approche de nous, y compris un membre de notre propre famille. Nous sommes au XVIIe siècle, son maître ouvrage, Léviathan, date de 1651 en anglais (1688 en latin).
Lorsque Hobbes décrit les hommes à l’état de nature, dans leurs relations interhumaines en l’absence d’institutions politiques et se formule ainsi : à l’état de nature « l’homme est un loup pour l’homme », phrase célèbre qui s’inspire de Plaute « homo homini lupus est », et qui invite à considérer le naturelle des hommes comme belliqueux, puisque, chacun poursuivant sans cesse la réalisation de son plus grand profit entretient de ce fait avec tous les autres de purs rapports de « forces » ou de « puissances ». En conséquence, on trouve un « état de guerre » permanent, dans lequel chacun conserve sa puissance d’agir mais est aussi menacé de périr. À l’état de nature les hommes possèdent tous un droit illimité sur toutes choses et en ce sens, ne cessent de s’opposer pour la possession des biens. Si les hommes ne s’entendent pas, c’est parce qu’ils sont égoïstes et qu’ils nourrissent à l’égard de leurs congénères que violence et envie.
C’est donc à travers le contrat social, et un État fort, presque despotique, que les hommes se rencontrent, surtout parce qu’ils souhaitent sauver leur vie et leurs biens. Ils n’ont aucun autre intérêt à entrer en contact, et d’ailleurs là encore la rencontre ressemble plutôt à une manière d’aller à l’encontre de l’autre. Nous voyons alors, la pertinence du substantif français « rencontre », qui nous vient du bas latin incontra, auquel a été ajouté le préfixe re- qui est associé à la répétition – comme le mot allemand Wiederholung, formé à partir du préfixe de répétition wieder. Si on trouve le mot français « rencontre » pour la première fois au XIIe siècle, pour désigner le coup de dés qui décidait du combat entre deux seigneurs ou deux troupes, au XVIe siècle le sens s’élargit et c’est donc ici, une rencontre par nécessité et coïncidence. Les hommes n’y tiennent pas. Ils se méfient de leurs congénères. Mais c’est tout de même préférable. Les hommes savent que sans le contrat social de Hobbes, ils ne survivront pas longtemps au hasard d’une mauvaise rencontre. Ici donc, la rencontre s’apaise, se laisse circonscrire par l’usage de la raison, et une forme de sagesse de la part des hommes qui préfèrent laisser leur liberté absolue à la porte de l’État pour obtenir en contrepartie l’assurance de la sécurité de leur personne et de leurs biens. Si donc la coïncidence – donc le hasard – est ici liée à la rencontre, on voit que la nécessité nous fait revenir à la racine même du mot rencontre. Il n’y a pas de rencontre sans cette contradiction curieuse.

Conférence du 24 février 2022 à Spa© Jenny Kiss
5.
Mais si l’homme est un loup pour l’homme pour Hobbes, et que Spinoza ne le dément pas, ce dernier ajoute finement que l’homme est aussi un Dieu pour l’homme. Voyons ce point.
Pour ce faire, je vais reprendre cette phrase à mon compte, sans faire état du contexte dans lequel Spinoza la prononce. Pour éclairer cette idée, j’aimerais utiliser le livre de Fabienne Martin-Juchat, intitulé L’Aventure du corps. La communication corporelle, une voie vers l’émancipation (Presses universitaires de Grenoble, 2020) dans lequel elle développe une approche anthropologique de la communication corporelle, disant que « le manque de contact corporel peut provoquer une montée d’angoisse », je la cite.
Pour ce professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université Grenoble Alpes, arrêter de se toucher pour se protéger, à l’heure des privations de bises, d’embrassades et de câlins, cela manque ce qu’il y a d’essentiel dans le toucher. Elle rappelle l’aspect vital de ce sens. « Nous sommes des êtres de toucher. Sans contact physique, un bébé dépérit », déclare-t-elle au journal Le Monde. Reprenant la distinction conceptuelle de Merleau-Ponty « touchant/touché », Fabienne Martin-Juchat montre que c’est par le toucher que l’on rentre en communication avec l’autre et avec soi-même. Le toucher nous plonge dans un univers sémiotique très riche qui repose sur la complexité à qualifier des sensations en lien avec la texture, la température, la tonicité, le taux d’humidité de la peau, etc. Ce mode de communication nous fait accéder aux émotions, les nôtres et celles d’autrui. Et c’est précisément le socle de l’empathie.
Aussi, si chaque civilisation et chaque culture a sa conception personnelle du toucher, la France a choisi la bise. Fabienne Martin-Juchat nous rappelle aussi que la bise s’est développée après la seconde guerre mondiale, grâce aux avancées de la médecine moderne, qui a fait reculer les risques sanitaires. La baisse de la crainte des maladies, associée à une culture post-Mai 68 a largement favorisé l’expression corporelle, et nous a permis d’expérimenter toute une richesse d’expériences sensorielles. Avant cela, toucher l’autre était un acte réprimé en écho à une société aux mœurs fortement prescriptives.
En prohibant le toucher et la bise, nous avons soudain réalisé ce que nous avions perdu grâce aux avancées de la technique et de la médecine.
Or, ce que nous avons surtout perdu avec la société de contrôle sanitaire, c’est précisément la spontanéité, comme nous le rappelle l’auteure. Pourquoi ? Parce que l’expérience du toucher implique une forme d’abandon et de surprise qui s’inscrivent en opposition avec la société de contrôle qui s’est accentuée avec la crise sanitaire. Si donc la rencontre relève du hasard, elle relève aussi de la spontanéité. Et, tandis que l’épidémie a renforcé un rapport au monde basé sur la normalisation, l’utilité, la planification, le rationnel, la rencontre est progressivement devenue impossible, puisque tous nos gestes sont désormais calculés, pour ne pas attraper le virus, y compris l’espace que nous laissons entre nous et l’autre.
Quelles sont les conséquences de tout cela ? Si l’on se fie à la réponse de Fabienne Martin-Juchat, on peut d’ores et déjà avancer qu’en l’absence de toucher on peut déprimer car, nous dit-elle, le toucher est lié à la vie : il donne un sens à l’existence, le manque de contact corporel et son contrôle peuvent provoquer une montée d’angoisse et une surfatigue. L’autre, dans cette rencontre par le toucher, me prévient de l’anxiété, de l’angoisse de la solitude, me régénère. Si l’on y prête un peu attention, on peut alors voir poindre une tristesse de vivre dans une société sans contact, surtout lorsqu’on ne nous présente l’autre que sous la forme de la menace, du risque de nous rendre malade. À la place de la liberté et de l’émancipation par le toucher dans la rencontre, on referme l’homme sur lui-même, on l’isole, et on le tue s’il ne peut rentrer en contact avec l’autre.
Si on peut donc dire que l’homme est un Dieu pour l’homme, il l’est très certainement dans sa dimension corporel et sensuelle. Et le réduire à une menace, c’est précisément le confondre avec le virus, le réduire à n’être qu’un agent pathogène, un transmetteur de maladie et de mort. Mais il n’est pas non plus que cela, c’est-à-dire une dimension sensuelle et corporelle. La reconnaissance de l’autre par moi et de moi par l’autre est ce qui nous construit tous deux comme conscience. Cette réciprocité dans la reconnaissance est ce qui établit l’intersubjectivité. La reconnaissance, du fait que nous soyons deux sujets, deux consciences qui se disent dans le monde à partir d’une reconnaissance à la fois conflictuelle et nécessaire, est ce qui permet de dire « je », et de savoir qui l’on est.
6.
Penser l’intersubjectivité, la reconnaissance mutuelle et la rencontre au vingt-et-unième siècle, semble impossible sans prendre en compte une révolution technologique qui est aux portes de ce siècle : le métavers. Désormais, vous savez que ces mondes à part entière, où il y a des gens représentés par des avatars, il y a des bâtiments, des routes et chemins, des forêts, des rivières, des plages, où tout y est virtuel parce que tout cela n’est réel que dans sa version numérique dans laquelle on s'immerge par avatar interposé, et persistants parce qu'ils continuent de fonctionner et d'évoluer lorsque l'on en sort, va révolutionner notre manière d’interagir et de se représenter soi, et de se représenter l’autre.
Le « Métaverse » est un mélange habile du mot grec méta qui signifie « au-delà », et de verse qui est une référence au mot anglais « universe ». Littéralement, un univers au-delà du prisme de la réalité.
Dans le métavers, l’individu pourra donc entrer dans ce dit univers avec un casque de réalité virtuelle et évoluer dans un monde fictif où il va rencontrer des « amis » eux aussi grimés en avatars et interagir avec eux. Plus ou moins ce qu’on peut faire dans la réalité, mais la différence est qu’il s’agira d’un univers fantasmé qui ne reprendra pas les codes du réel, puisque là-bas, dans le métavers, tout sera possible.
On peut aussi imaginer que dans ce métavers les personnages n’auront pas de sexe spécifiquement binaire, ce qui permettra d’échapper à la dure réalité biologique ; on peut tout imaginer dans ce monde virtuel qui n’a plus rien à voir avec le monde réel. Oui, mais peut-on y imaginer encore la rencontre ? Et si oui, où se nichera-t-elle ? Comment est-ce que la rencontre sera encore possible, puisque le toucher, l’autre, son corps, son visage, ses mouvements, rien de tout cela ne sera réel ?
Depuis déjà vingt ans, avec l’arrivée d’Internet et des réseaux sociaux, nous assistons déjà à un recul des relations humaines, même si nous entretenons l’illusion de nous connecter aux autres, via nos smartphones et ordinateurs. Les réseaux sociaux nous ont révélé nos plus bas instincts : l’orgueil via les images, la paresse de ne rien faire devant ses écrans, ou encore l’envie face à la vie des autres qui est un miroir nous renvoyant à notre propre médiocrité. Nous sommes réduits devant nos écrans à n’être plus qu’un ego, un ego contre tous les autres. Face à ce « tout-à-l’ego », le métavers ne va rien arranger, et, même si nous aurons l’illusion d’échapper à notre monde qui n’a rien de radieux, même si nous aurons l’illusion de vivre réellement avec l’autre, dans cet espace virtuel où le mur du réel n’existera plus, qu’en sera-t-il véritablement ? L’autre est celui qui me limite et me stimule. En face de ce « soi-même comme un autre », je me vois forcé de sortir de mon égocentrisme. Cette limite à l’expression de mon moi n’est pas seulement privative, elle est aussi ce qui me permet de me séparer de l’indifférence du « on » et de reconnaitre l’autre comme l’identité d’un « tu ». Dans cette reconnaissance dont je jouis par l’autre et inversement, nous avons enfin le sentiment d’appartenir à une seule et même condition humaine.
Qu’en sera-t-il du métavers ?
Prenons par exemple le marché du sexe : il faut rappeler que selon un sondage récent presque 48% des hommes sont prêts à avoir des relations sexuelles avec un robot qui pourra prendre les traits d’une véritable femme, et selon le même sondage 43% pourraient même tomber amoureux (sondage mené par Tidio). Si un échange sexuel est si facile dans le métavers, ou avec un bot, et qu’il nous dispense de nous confronter au désir et à la liberté de l’autre, pourquoi continuer de rechercher un véritable partenaire ? D’autant qu’il sera possible de choisir des skins qui pourront représenter des fantasmes ultimes pour certains hommes, et les femmes de leur côté ne seront évidemment pas en reste.
Le rencontre devient désormais virtuelle, factice, puisque qu’elle nie l’autre au profit de soi, et rien que de soi. On privilégie ses désirs et sa liberté en niant les désirs et la liberté de l’autre. Pourtant, si je peux dire qu’autrui est mon prochain, il n’est pas seulement cela : il est aussi mon lointain. Il appartient peut-être à une culture très différentes de la mienne, il est doté d’une éducation et de codes sociaux qui n’ont rien à voir avec les miens. Si je ne me confronte pas à autrui dans un échange et des rapports, parfois conflictuelles, je manque ce qu’autrui pourra m’enseigner et me transmettre, et inversement, qui est une autre manière d’habiter le monde, et de le penser. C’est par autrui, si loin et si proche, que je m’humanise, comme le dit d’ailleurs Hegel, je m’humanise quand je le reconnais et qu’il me reconnait à son tour.
Ce que l’on peut alors craindre avec le métaverse en somme, c’est qu’il termine de parachever les dégâts causés par les réseaux sociaux, en rendant des relations solitaires avec la machine plus vraies que nature. Non seulement il sera de plus en plus difficile de démêler la réalité du virtuel, mais cela ouvrira le champ des possibles à des nouvelles pathologies, voire même peut-être à la possible survenance d’une ultra-solitude, dans laquelle on ne trouvera plus de voie pour aller vers l’autre. C’est d’ailleurs ce que montrent nos sociétés modernes dans lesquelles règnent une affreuse solitude. Nous ne manquons d’ailleurs pas d’arguments scientifiques pour montrer que l’isolement et la solitude sont les acteurs principaux de la souffrance psychologique de nombreuses personnes et d’apparition de maladies psychiatriques, dont la dépression. L’autre, sous la forme de la menace ou de l’allié, demeure donc essentiel dans mon contact avec moi-même et avec une bonne santé. Hegel dit à ce propos que « la conscience générale de soi est l’affirmative reconnaissance de soi-même dans l’autre moi ». Je ne suis en bonne santé qu’à condition d’être en contact avec l’autre et d’être reconnu par lui.
7.
Les distances entre chacun deviennent de plus en plus grandes. Que ce soit par le réseau, où l’on parle à des inconnus sans visage, dans la rue, où l’on parle à des masques, au moins en temps de pandémie, et si cette habitude s’installe dans la durée, à qui ou quoi parlera-t-on bientôt ? À des masques ? À des avatars ? Comment donc repenser notre rapport à l’autre malgré la distance ?
On peut répondre en utilisant quelques figures philosophiques : celle du maître et du serviteur chez Hegel, et celle du désir mimétique dans la philosophie de René Girard.
Pour Hegel, c’est à travers le conflit avec autrui que l’on peut passer de la simple conscience à la conscience de soi, c’est-à-dire de l’immédiat au réflexif.
Si les deux consciences entrent en conflit, c’est toujours pour un même objet du désir, car ce qu’on désire, ce n’est pas tant l’objet du désir que le désir de l’autre, comme l’enfant désirant jouer avec la petite voiture de police avec laquelle joue son camarade pour la seule raison qu’un autre enfant s’y intéresse. Aussi, les parents vont très vite offrir le même jouet au second enfant pour éviter qu’ils ne se chamaillent puis ne se fassent mal. En termes hégéliens, on peut dire là que les deux enfants sont deux consciences entrées dans une lutte à mort.
Cette lutte à mort vise l’asservissement de la conscience de l’autre qui, s’avouant vaincu pour avoir la vie sauve, est forcé de reconnaître l’autre comme maître et lui-même comme esclave.
On appelle cette dialectique la lutte à mort pour la reconnaissance.
C’est donc dans ce texte célèbre de la Phénoménologie de l’esprit, appelé « la dialectique du maître et du serviteur », que l’on trouve l’idée suivante : s’exprimer et exprimer son désir, c’est toujours prendre le risque d’entrer en conflit avec les autres et leurs désirs, mais c’est surtout un moyen de se sentir reconnu par l’autre et c’est la seule possibilité de prendre conscience de soi. Puisque, dans la philosophie de Hegel, le premier moment de cette reconnaissance de l’un par l’autre prend racine dans une lutte entre deux consciences qui s’affirment d’abord par une négation réciproque : c’est le théâtre d’une lutte pour la reconnaissance afin de sortir de sa seule subjectivité, qui est la seule certitude d’elle-même. Chaque conscience veut que l’autre la reconnaisse afin d’avoir la preuve objective de son existence, puisque je ne peux être reconnu comme conscience que par une autre conscience. Et, de la même façon, la conscience d’autrui ne peut se reconnaitre comme conscience de soi que parce que ma conscience la reconnait comme telle. Pensons seulement à quel point nous recherchons, à travers nos comportements en public ou sur les réseaux sociaux, la reconnaissance des autres, des parents, des amis, en affirmant nos goûts, nos désirs, ce que nous aimons ou n’aimons pas. Pourtant, nous ne reconnaîtrons nous-mêmes que ce qui a été validé par les autres, par le regard qu’ils auront porté sur ces choses. Ce qui nous confortera dans cette reconnaissance de soi sera les prix d’excellence, les félicitations, les nombres de vues réalisés sur Internet, le nombre de « j’aime » sur Instagram ou Twitter accordés à nos posts, ou peut-être demain ce que l’on portera ou les objets que nous obtiendrons dans le métavers.
Notre relation à l’autre ne peut donc être pensée qu’à travers la notion du désir et de cet obscur objet du désir.
Si la lutte des consciences n’a pas été abolie par les réseaux sociaux, bien au contraire, elle ne sera peut-être pas finie dans le métavers, mais sera simplement transportée ailleurs.
Car notre relation à l’autre homme passe essentiellement par le désir. Et, c’est d’ailleurs, en relisant les grands romanciers modernes, que René Girard, mort en 2015, montre que le désir est avant tout mimétique. Voilà probablement l’apport révolutionnaire de Girard. L’individu ne sachant que désirer par lui-même, se donne toujours des modèles et calque son désir sur les leurs. C’est ce que Girard appelle le grand « mensonge romantique », consistant à laisser croire que les individus désireraient par eux-mêmes, en vertu de leur intériorité profonde. C’est à partir de grandes œuvres écrites par Cervantès, Flaubert, Stendhal, Proust ou encore Dostoïevski, que Girard met à jour le désir mimétique, en s’attachant à en révéler la « vérité romanesque », qui consiste à dire que, tout désir est donc en réalité mimétique. Autrement dit, nous passons notre temps à imiter autrui, même si, en général, nous refusons de le reconnaître, car l’imitation est souvent perçue comme une faiblesse dans la société moderne.
Ainsi, nous pouvons suivre un modèle imaginaire, comme dans le cas de Don Quichotte ou de Mme Bovary, mais nous aimons aussi suivre un modèle concret et plus proche de nous. Dernier point important, qui rappelle Hegel, c’est que l’imitation peut aussi se transformer en rivalité, et devenir source de violence.
N’est-ce d’ailleurs pas le défaut d’une âme jeune, d’abuser grandement de cette faculté de dire « je » dans la relation à l’autre, et d’ainsi attiser la violence et la rivalité ? Pourtant, lorsque nous disons sans cesse moi je... moi je... nous oublions avec plaisir qu’autrui n’est pas une chose en soi, et que nous ne pouvons pas l’instrumentaliser à loisir ni l’utiliser comme une simple chose qu’on prend pour se sentir mieux ou se valoriser socialement. Est-ce qu’on ne montre pas par cette expression typiquement humaine de notre subjectivité sous son plus mauvais jour, ce qu’il y a en nous soudainement de plus inhumain ?
On peut ainsi conclure que si l’homme peut accéder à la conscience de soi par l’expression de sa subjectivité, il ne doit pas le faire en revanche au détriment d’autrui. Car oublier l’autre dans la relation c’est oublier que c’est grâce à l’attention que l’autre nous porte que l’on que l’on accède à la conscience morale.
8.
L’autre est donc moins un adversaire, même s’il est, qu’un allié qui me révèle à moi-même ce que je suis. Je pense au roman d’André Breton, L’Amour fou, et cette phrase : « C’est vraiment comme si je m’étais perdu et qu’on vînt tout à coup me donner de mes nouvelles. » Pourquoi ? Parce qu’on y trouve à la fois l’ouverture vers un monde nouveau, mais aussi les retrouvailles avec soi. Dans la rencontre, l’autre peut être une menace, un danger pour moi, cela va sans dire, il peut me perdre ou me nuire, mais il peut aussi me révéler à moi-même, me révéler cette part la plus intime et la plus étrange, voire étrangère. Je me pense ainsi. Je me crois ainsi. Je m’imagine ainsi. Soudain, l’autre apparaît et me dit, tu croyais être ceci, mais tu es aussi cela. L’autre est donc le révélateur d’un inconnu en moi.
C’est ainsi que l’on peut interpréter le rôle du regard dans la philosophie de Sartre. Vous connaissez sûrement cette phrase si mal comprise de Sartre, extraite de son Huis-clos : « L’enfer, c’est les autres. » Ce qu’il veut dire, c’est que la honte me permet de prendre conscience de moi-même. Imaginez que j’épie quelqu’un par le trou d’une serrure. Me voilà absorbé par mon activité. Que suis-je ? Une conscience en action. Une conscience qui domine le corps-objet (puisque je ne me doute pas que celui-ci soit une conscience) qui s’affaire de l’autre côté. C’est alors que quelqu’un surgit. Son regard se pose sur moi. Je le sens. Soudain, j’ai honte. J’ai honte parce que je suis pris. J’ai honte parce que désormais c’est moi la chose, l’objet regardé. Je réalise que je ne suis plus le maître. Si j’ai conscience de l’existence d’une autre conscience, je comprends que je ne découvre pas autrui en le regardant (auquel cas on le chosifie, et sa conscience ne se manifeste pas) mais en me sentant regardé (chosifié) par lui. Lorsque je regarde autrui, que se passe-t-il ? Je ne vois pas son regard. Je vois ses globes oculaires, et ce sont des choses. Mais je ne peux percevoir son regard comme regard actif d’une conscience qu’au moment où je me sens regardé, pris comme une chose, sous ce projecteur, bref au moment où je ne le regarde plus, même si je le vois. Le regard d’autrui me dépossède de ma liberté et me fige dans une identité. Ici, l’identité du voyeur, ou du mari jaloux. J’aurais beau m’insurger, je ne suis que ce que je fais. Et le regard me révèle à mes actions.
9.
Ce qui devient intéressant c’est de comprendre que la rencontre représente à la fois une trouvaille et une retrouvaille. On peut penser à la figure du joueur de Dostoïevski, qui joue moins pour gagner que pour se rencontrer en faisant l’épreuve de ses limites. On peut penser à la figure de Don Juan qui cherche désespérément une rencontre et à remplir le manque à travers son catalogue de conquêtes.
Or, c’est probablement ce manque qu’il s’agit de questionner. Quel est donc ce manque que je cherche à combler à travers la rencontre ?
Dans son texte sur l’inquiétante étrangeté, Freud présente l’individu humain dans un premier temps sous les traits d’Œdipe, amoureux d’un de ses parents, et jaloux de l’autre, effrayé par celui-ci (ce qui représente l’angoisse de castration). Puis, il prend les traits de Narcisse, épris de son propre reflet, désorienté alors par la scission de son Moi, partagé entre la personne réelle et l’image admirée. Finalement il devient Ulysse, menacé et attiré par le retour au pays natal (heimat), au foyer, où Pénélope, la fidèle, tisse sans trêve le linceul de son beau-père, dans un geste qui exprime à la fois l’amour et la mort, défait la nuit ce qu’elle a fabriqué le jour de façon étrangement inquiétante, unheimlich. On peut décrire « l’inquiétante étrangeté » comme la sensation que l’on peut ressentir face à un objet, une chose du quotidien qui nous mettrait mal à l’aise sans que l’on sache vraiment pourquoi. C’est par exemple le cas pour les poupées de cire ou les automates, et d’une manière plus générale tout ce dont on ne sait pas si c’est vivant ou mort.
L’autre pourrait-il être comme ces poupées de cire ou ces automates, ce qui m’effraye dans sa terrible étrangeté ? Pour éviter de rentrer donc en conflit avec ce que l’autre est et qui n’est pas moi, que je refuse de reconnaître dans mon pré carré, nous avons un outil, celui de fraternité. Puisque la fraternité sera la notion du XXIème siècle selon certains, encore faut-il comprendre en quoi justement la rencontre serait ce moyen de trouvaille et de retrouvaille à partir de l’accueil de l’autre, du frère, de celui qui n’est pas moi, qui est différent, non totalement différent, mais disons dans son étrange banalité. La fraternité peut être entendue comme l’amitié fraternelle, ou, au sens populaire du terme, une expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie (frères et sœurs). On peut dire aussi que la fraternité désigne un lien de solidarité et d’amitié entre des personnes d’un groupe, telle la fraternité au sein d'une association qui unit ceux qui luttent pour la même cause, ou la fraternité d’armes qui unit des combattants. Mais la fraternité, c’est aussi, et surtout, faire l’épreuve du frère, donc faire l’épreuve de l’autre homme, celui qui n’est pas moi, celui qui est différent de moi, qui ne partage pas mes valeurs ou mon monde, mais que j’accueille malgré tout parce qu’il est mon alter ego.
10.
Dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme, la fraternité renvoie à un état d’esprit essentiel qui rassemble les hommes par-delà leurs différences et transcende toutes les communautés particulières. « Qu’as-tu fait de ton frère ? » est la question que Dieu pose en condamnant les rivalités fratricides qui menacent tout lien fraternel. La jalousie contamine les fraternités, si par exemple on s’inquiète d’être moins aimé que son frère, moins reconnu, comme Caïn vis-à-vis d’Abel. « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? », demande Jésus dans l’idée de débarrasser la fraternité du carcan des clans.
Dans son roman Les Frères Karamazov, l’écrivain russe du XIXème siècle montre que la fraternité, comme la charité, n’est pas inscrite dans la nature de l’homme, et qu’il n’y a guère de fraternité que s’il y a l’aveu de sa faiblesse. D’abord Dimitri, Ivan et Alexis refusent de jouer de la musique pour les autres. Mais durant une nuit de Noël, ils vont changer d’avis. Et leur musique inspirée des blessures, des humiliations et des revers de leur vie, permettra à chacun de communier dans un grand moment de fraternité. C’est ainsi que se dessinera l’image de la Trinité.
La fraternité dont on parle ici, n’est donc pas une fraternité dans laquelle on trouve refuge, une fraternité fusionnelle et dans l’entre-soi. C’est plutôt une fraternité qui accueillent la différence, celle qui affaiblit, celle qui humilie, celle qui heurte et qui blesse. La fraternité n’est donc pas un confort, c’est une expérience troublante.
11.
La fraternité n’est donc pas seulement un concept. C’est aussi, et surtout, une épreuve de vie, une expérience à faire. Dans le même domaine, on peut donner une réponse à notre problème, en faisant un tour par la philosophie de Levinas, qui fait de l’éthique une expérience morale et humaine, portant sur la relation du sujet à autrui. Et c’est précisément à travers le visage que l’on parviendra à renouveler la pensée de l’intersubjectivité de manière radicale.
Quand on pense au visage, on constate qu’il parle. Le visage me parle. Il ne parle pas à tous, le visage visible est une adresse à moi, une adresse encombrante parfois, mais une adresse dont je ne peux m’exempter. C’est ce que Levinas nomme la responsabilité-pour-autrui. Puisque dans la rencontre ce que je recherche est bien ce qui me manque, le visage est sûrement ce que je peux atteindre, puisqu’il est à la fois présent, bien réel, inscrit dans le monde, tout comme moi. Lorsque je me porte vers Autrui je réalise que son désir est hors d’atteinte, que je n’ai fait que le rêver et le jalouser. L’autre est cet inconnu que je cherche infiniment à connaître pour le comprendre, mais pour aussi le posséder et le prendre. Pour le posséder, je m’approprie son désir, nous dit René Girard. Je procède alors à une réduction.
Au désir narcissique, qui est omniprésent dans la société, ce désir de Narcisse amoureux de son reflet, Levinas oppose un désir que l’Autre peut inscrire en moi, et qui est alors l’occasion d’une déprise, un moment où je peux m’échapper, où je peux me défaire de ce Moi tyrannique. Dans cette rencontre avec l’Autre, grâce au visage, je ne peux plus faire comme si ce monde ne portait que Moi, comme si je n’avais qu’à faire avec moi.
L’Autre est ce moment où je ne fais plus attention à moi, ou je ne me préoccupe plus de moi. Il est ce moment où je ne suis plus dans l’identification au moi, où je me préoccupe de ce qui est autre que moi, ce qui est différent de moi et que je ne peux identifier.
C’est le moment où je recherche une trace en l’autre, un moment unique où je vais me refuser à ramener l’autre à moi. L’altérité devient alors le lieu de l’inconnu, le lieu où j’accepte de lâcher avec le connu, avec l’identification, pour aller y saisir une trace, une identification autre, avec toute la difficulté que cela demande d’aller vers l’Autre.
Voilà pourquoi, en appelant « infini » cette trace que je trouve dans le visage de l’autre, je vois ce qui me transporte au-delà de lui-même, dans cet infini que je ne peux trouver en moi-même. Levinas propose une phénoménologie du visage d’autrui, qui est d’abord un composé d’yeux, bouche, nez, etc. Sa conception d’autrui se présente sous la forme d’une responsabilité infinie, du devoir, et elle est à l’opposé de celle de Sartre, qui pensait que les regards s’affrontaient dans une lutte pour réduire l’autre à l’état d’objet. On va bien plus loin avec Levinas, puisqu’en ouvrant sur l’infini, le visage est ce qui peut seul m’élever à la condition de sujet : « Le visage s’impose à moi sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l’oublier, je veux dire sans que je puisse cesser d’être responsable de sa misère » (Humanisme de l’autre homme, 1972).
Considérons donc le visage comme un appel. C’est par le visage que l’autre s’invite dans mon existence, qu’il y fait effraction, que la rencontre est possible, même si, de cette rencontre, je ne peux que m’en sentir l’otage, parce que le visage est ce qui témoigne de la fragilité de l’homme ; il m’appelle, me commande, m’oblige ; m’oblige à être responsable de lui.
Levinas décrit le visage comme une misère, une vulnérabilité, un dénuement qui, en soi, sans adjonction de paroles explicites, supplie le sujet.
C’est donc dans le visage que l’infini fait trace inoubliable, au moment où il n’est plus ce masque informatif, mais qu’il est nu, misérable et exposé. Lorsque je dépouille le visage d’autrui de tout ce qui le masque, lorsque je l’affronte à nu, dans cette nudité fragile, je suis interpelé par l’Autre, remis en cause, et cela me permet de m’évader de moi, de m’arracher à l’engluement du moi, un moi replié sur soi, autocentré, sourd à l’Autre, aveugle.
Par la responsabilité, ce visage qui m’incombe semble être une assujétion à l’Autre. Pourtant, c’est dans ce Face à Face à l’Autre, c’est dans cette responsabilité de mes frères, pensons à Dieu dans la Bible qui demande à Caïn « Où est ton frère ? », que je deviens sujet-humain. Caïn répond à Dieu : « Suis-je responsable de mon frère ? »
Oui, lui répond Dieu. C’est donc par cette responsabilité qui nous vient de notre for intérieur, que nous renouons avec la fraternité. Et c’est dans la fraternité que l’Autre me vient, rencontré en son visage.
Spa, jeudi 24 février 2022

Conférence du 24 février 2022 à Spa© Jenny Kiss
Commentaires
J’ai beaucoup aimé votre article et je me souviens encore très précisément de votre livre Seuls Éloge de la rencontre qui contient des pépites qui m’ont profondément aidé.
D’autre part, j’ai publié mon premier livre ( peut-être le vôtre a-t-il été celui qui m’a « autorisé » à le faire) qui s’intitule Les Grandes Rencontres. J’aimerais vous l’offrir et savoir ce que vous en pensez. N’hésitez pas à me contacter.
À bientôt.
Les rencontres sont toutes enrichissantes. Si l’on apprend sur l’autre, on apprend forcément sur soi. Que ce soit à travers le sport, en affaires, en politique, au détour d’une rue… la vraie richesse n’est-elle pas la découverte ? Je me souviens d’une très belle rencontre au Petit Saint-Benoît un mardi soir. C’était un 15 février. Et j’en suis reparti enrichi de vos idées et de vos paroles. Merci Monsieur Alpozzo. Et merci à Guilaine d’avoir « provoqué » cette rencontre.
Passionnant
Très beau.