Entretien avec Laurent Sedel « Je ne me sens juif que face à un antisémite »

Le docteur Laurent Sedel (né sous le nom de Laurent Geoffroy), utilise ce nom pour la première fois pour écrire son histoire dans ce livre), intitulé Petite histoire d’un juif français, et sous-titré « Résurrections » (paru aux éditions de L’Harmattan en 2022). Chirurgien orthopédique tombé gravement malade, et ayant subi une greffe de foie, le voilà dans la peau d’un patient. Cette résurrection, tel qu’il l’appelle, et qui peut s’entendre comme une guérison inattendue, ou comme le retour de la mort à la vie dans un contexte plus mystique, nous fait irrémédiablement penser à la résurrection du Christ. Juif de naissance, Laurent Sedel prend alors la plume sous son nom d’origine, né d’une mère nommée Sarah, qui parvient à miraculeusement échapper aux griffes des Nazis, et accouche d’un fils né sous X, appelé Laurent Geoffroy, et non Sedel. Nous sommes alors en 1943. C’est l’attachée de presse de Laurent Sedel qui m’a contacté, pour m’envoyer son livre et le rencontrer. Or, si j’ai accepté, c’est précisément parce que le médecin et écrivain Laurent Sedel/Geoffroy, tel docteur Jekyll et Mister Hyde, est plus qu’intéressant, il est énigmatique et iconoclaste. Nourrissant à la fois l’ambiguïté et le mystère, condamnant l’antisémitisme d’un Soral ou d’un Dieudonné, mais s’attaquant au détournement historique opéré par les grandes figures de la Shoah, Claude Lanzmann et Élie Wiesel, il ne fait pas toujours bonne presse dans la communauté juive, et on peut le comprendre. Censuré pour un article sur Sarah Halimi, Sedel, par la bouche de Geoffroy, accuse Lanzmann et Wiesel de défendre le repli sur soi et le communautarisme. Cet entretien est paru dans le site du mensuel Entreprendre. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
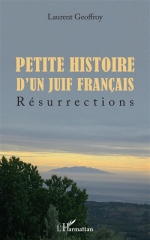 Marc Alpozzo : Bonjour Laurent Sedel, et merci de répondre à mes questions. Je ne sais si je dois vous appeler Laurent Sedel ou Laurent Geoffroy. Me permettrez-vous de vous appeler alors tout simplement Laurent ? Tout d’abord, pourquoi avoir pris votre premier nom pour écrire ce récit de vie ? Qu’est-ce qui distingue Laurent Geoffroy de Laurent Sedel ?
Marc Alpozzo : Bonjour Laurent Sedel, et merci de répondre à mes questions. Je ne sais si je dois vous appeler Laurent Sedel ou Laurent Geoffroy. Me permettrez-vous de vous appeler alors tout simplement Laurent ? Tout d’abord, pourquoi avoir pris votre premier nom pour écrire ce récit de vie ? Qu’est-ce qui distingue Laurent Geoffroy de Laurent Sedel ?
Laurent Sedel : Je suis bizarrement les deux, mais pas schizophrène. J’ai réalisé il y a peu la violence incroyable qu’il y a d’imposer à une mère que son fils naisse sous X. C’est la sage-femme qui m’a mis au monde qui l’a fait, prenant tous les risques et au passage me donnant peut-être son nom : Geoffroy, j’aime y croire parfois. Signer ainsi, c’est un clin d’œil, c’est aussi résumer en un mot beaucoup de choses que je développe : l’aide des sans grades, la criminalité de Pétain, Vichy et le gouvernement français de l’époque qui allait déjà au-delà de ce que les allemands avaient réclamé. Signer Laurent Geoffroy, c’est aussi prendre un nom de plume, puisque sous mon nom de Sedel j’ai signé de nombreux articles, livres. En écrivant ainsi cette histoire, je sors de mon domaine de confort comme on dit maintenant.
M. A. : Vous racontez que vous n’avez appris votre judaïté qu’à l’âge de 12 ans. Vous avez été un bébé caché, né en 1943, et déclaré de père « inconnu », alors que la France était sous l’occupation nazie, et que votre mère Sarah était recherchée par la Gestapo et les milices ou polices de Pétain, votre père René déporté au camp d’Auschwitz. Votre vrai nom n’ayant été reconnu par jugement du tribunal qu’en 1948 après le retour des camps de votre père, vous avez été par la suite le chef du service d’orthopédie à l’hôpital Lariboisière à Paris, médecin, comme le veut la tradition, de père en fils. Vous parlez dans votre livre de « Résurrection », alors même que ce terme est plutôt connoté, puisqu’on parle de la résurrection du Christ. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas parler plutôt de renaissance ?
L. S. : Résurrection est sans doute grandiloquent, mais il s’applique si bien à mon état de greffé du foie quand la mort, sans la greffe était inévitable. Cela me permet de rapprocher mon histoire de celle de mon père au retour des camps, véritable résurrection aussi. C’est bien sur la sienne que j’ai souhaité écrire, en n’oubliant pas celle de ma mère, qui a fait un séjour à Drancy avec sa mère dans l’année 1942. C’est mon père qui les en a fait sortir : incroyable, impossible disent les historiens de l’époque, mais vrai. Pour l’incroyant que je suis, ce terme, résurrection, emprunté au discours catholique est détourné vers une utilisation laïque. Dans les histoires que je raconte dans ce livre, ce sont des humains qui nous ramènent à la vie, qu’ils soient chirurgien, sage-femme, maire d’un village de banlieue, femme de ménage, gendarme etc…Ce sont ces petites gens qui dans des circonstances exceptionnelles peuvent devenir Dieu.
M. A. : Vous êtes donc français de naissance et d’études, laïc et grand admirateur des Lumières. Votre récit est paru chez L’Harmattan, ne le prenez évidemment pas pour un reproche, car c’est une maison d’édition dont le catalogue n’a pas à rougir face aux grandes maisons d’édition, mais il est vrai que la qualité de votre texte aurait dû vous conduire à être, disons, mieux publié, ou publié dans une des prestigieuses maisons d’édition du cercle germanopratin. Vous m’avez confié durant notre déjeuner, que les éditeurs ont hésité à publier votre texte, car il en résulte, dans vos positions plus qu’iconoclastes, une forme d’ambiguïté permanente, ainsi que des déclarations choquantes pour une partie de la communauté juive, à la fois difficile à définir et à défendre face à un éditeur. Dans ce récit, vous vous attaquez à deux figures majeures de la Shoah, Claude Lanzmann et Élie Wiesel. Vous accusez Claude Lanzmann de se poser en « gourou », en l’accusant clairement de se rendre coupable de « détournement historique », je vous cite, puisqu’il accuse de manière non légitime, l’ensemble des Polonais, dites-vous, peuple martyrisé par Hitler, d’antisémitisme. Vous l’accusez aussi de parler à la place des « vrais déportés ». Vous comprendrez que certains lecteurs de cet entretien risquent de se sentir choqués, voire offusqués. Pouvez-vous éclairer votre position, afin qu’on la comprenne précisément ?
L. S. : Merci de vos commentaires. L’Harmattan m’a permis de voir ce livre publié, de le voir ainsi lu par mes proches, mes amis. Pour les autres, que je regrette d’avoir parfois offusqué, je m’explique : Cette histoire de la solution finale je la connais depuis mon enfance. J’ai appris que j’étais juif à l’âge de 12 ans. Un de mes meilleurs amis l’a su seulement à 32 ans. Nous étions des Juifs cachés par mesure de protection, si cela recommençait, la vie sauve allait à ceux qui ne s’étaient pas déclarés comme juifs, qui s’étaient bien cachés, mieux cachés que mes parents en tout cas. Quand j’avais 15 ans, mon père me faisait lire les épreuves de son livre qu’il publiera pour la première fois en 1959 et qui ne trouvera pas de lecteurs. Juif pour moi à l’époque ne signifiait pas grand-chose, nous n’allions pas à la synagogue, mes grands-parents non plus. Je n’étais élevé dans aucune religion, allait au lycée Hoche de Versailles où nos professeurs nous enseignaient les Lumières, la Révolution française, Jules Ferry. Claude Lanzmann dont je respecte le travail c’est une autre époque, 30 ans après les faits. Il invente le terme Shoah, utilise des fonds israéliens pour faire son film (ce qu’il raconte dans Le lièvre de Patagonie) et devient une sorte de référence à une histoire qu’il n’a pas vécue. Attirant à lui les lumières alors que les vrais acteurs/victimes sont vieux et surtout n’ont pas cette capacité à se faire entendre lorsqu’on est, comme lui, membre à part entière du cercle germanopratin. Pour Elie Wiesel, c’est autre chose. Il a eu cette expérience terrible des camps. Mais pourquoi faire de cette expérience un Holocauste, comme l’appelle régulièrement les américains du nord. Un crime voulu par Dieu ? C’est ce détournement du crime vers un sacrifice voulu par Dieu qui me choque. Derrière ce détournement des mots : Shoah, Holocauste, on perçoit l’utilitarisme : ramener des fidèles dans le giron communautaire, et aussi permettre à Israël de rappeler les origines de sa création. Il y a ainsi une véritable instrumentalisation de la mémoire, alors que l’histoire devrait se cantonner aux faits suffisamment horribles en soit et qui méritent mieux que cet utilitarisme.
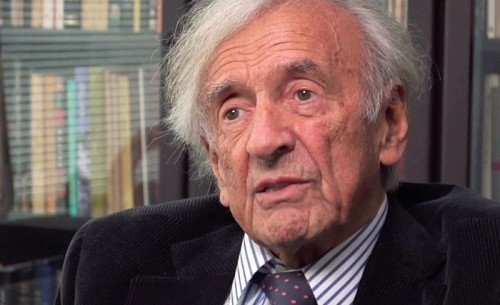
Elie Weisel (1928-2016)
M. A. : Vous dérangez dans la communauté juive. Puis-je le dire ainsi ? D’ailleurs, vous deviez participer à un ouvrage collectif, qui paraîtra en décembre (éditions David Reinharc), et dans lequel votre texte a été censuré, parce que vous refusez de voir de l'antisémitisme partout. Pour vous, le meurtrier de Sarah Halimi est avant tout un détraqué. Je me suis procuré votre texte auprès de votre attachée de presse, et j’en cite un passage, si vous me le permettez : « Pour moi l’injustice, l’appréciation erronée ou tendancieuse voire communautaire de la culpabilité peut être une façon de féconder la bête. Nous avons la chance de vivre dans un pays tolérant qui a aboli la peine de mort, dans lequel les juges restent indépendants des pouvoirs. Faisons tout pour conserver ces exigences, sinon nous ouvrons la porte aux extrêmes qui sauraient bien vite balayer tout cela. » Votre question, votre obsession même, c’est la question de Berthold Brecht, que vous citez dans votre texte : qui féconde la bête ? Pouvez-vous nous éclairer sur cette position ?
L. S. : J’ai été étonné et déçu par ce rejet de mon texte par la communauté juive bien-pensante. Je suis français avant tout. Ayant connu mon appartenance à la « race » juive à l’âge de 12 ans, j’ai parfois l’impression d’être comme un agent infiltré chez les autres. Je perçois très bien comment les postures de certains de la communauté juive peuvent être mal comprises d’un français lambda. Mais comme je suis aussi très concerné par l’antisémitisme et les façons de le combattre, je suis souvent en désaccord avec certains communautaires qui qualifient aisément certains comportements d’antisémites. Il faut être vigilant bien sûr, mais pas paranoïaque. Je viens de lire l’excellente bande dessinée de Johan Sfar : la Synagogue. J’ai adoré sa description du Nice de son enfance. C’était le retour des pieds noirs, quelques années après la deuxième guerre mondiale. Il décrit la hantise de la communauté juive de la ville d’être attaquée par des fachos. Lui-même se met en scène comme gardien de la synagogue ; c’est à la foi drôle et triste. C’est surtout une remarquable image de cette hantise de l’antisémitisme dans un pays apaisé. Il n’y a plus d’antisémitisme d’État, celui qui a abouti à la solution finale. Il est vrai que durant ces quelques dizaines d’années ce sont produit des actes antisémites violents, le restaurant Goldenberg, la rue Copernic, et plus près de nous, Mohamed Merah, le Bataclan ou le magasin Casher. Il est vrai aussi qu’il persiste un fond antisémite à la française, ce fond qui pourrait se réveiller à l’occasion de grandes crises sociales, économiques, où le juif redeviendrait le bouc émissaire. C’est parce que je reste conscient de cela que je propose d’éviter de s’insurger en permanence ou de décrire comme antisémite un acte criminel horrible comme le meurtre de Sara Halimi et savoir reconnaitre un fou.
M. A. : Je me souviens d’une époque, en 2005, où des figures représentant la communauté noire et africaine, notamment l’humoriste controversé Dieudonné, accusaient les Juifs de refuser le statut de « martyrs » aux victimes de l’esclavage, et de hiérarchiser les souffrances. Il me semble, sans être un spécialiste de des spectacles de Dieudonné, qu’une grande partie de ses sketchs sont dédiés à cette dénonciation. Vous reprenez cette polémique, consciemment ou inconsciemment, autour de la traite négrière, pour accuser ceux qui refusent de voir cette douleur, et de faire le jeu de l’« antisémitisme » français. Vous dites aussi, ce avec quoi je ne suis pas d’accord, mais c’est votre droit de le dire il me semble, que l’on devrait cesser avec le « devoir de mémoire », car cela encourage la persécution des Juifs. Vous allez encore plus loin, me semble-t-il, en disant que les terroristes du Bataclan, sont d’une certaine manière le fruit d’une « société excluante ». Est-ce que l’on peut vraiment tenir ce genre de discours aujourd’hui, surtout lorsqu’on sait combien la communauté juive est soumise aux persécutions, que l’antisémitisme dans certains endroits de la société française est plutôt bon teint, que dans certaines classes de l’école de la République on remet en cause la Shoah, que le négationnisme antisémite ne s’est jamais aussi bien porté ?
L. S. : La mémoire des historiens, oui bien entendu. La mise en scène répétée de la mémoire des victimes peut conduire aux oppositions de ces mémoires : qui a le plus souffert ? Un Dieudonné est l’exemple même de cette jalousie : pourquoi faire autant cas du drame subi par les juifs quand on a oublié le drame de l’esclavage ? D’autres mémoires se télescopent : les Arméniens, les Tutsis au Rwanda, les LGBT avant et maintenant dans beaucoup de pays. Je suis d’accord sur le fait que l’extermination industrielle des juifs par Hitler avec ce coté froid et systématique est insupportable. Mais maintenant à plus de 70 ans des faits, ne serait-ce pas le moment de prôner une sorte de collectif des mémoires pour éviter de mettre en conflit ceux qui ne se sentent pas concernés ou qui à travers leur histoire propre ne s’y retrouvent pas. Une laïcité active, à laquelle j’adhère, ne peut fonctionner qu’avec un certain respect des mémoires
de chacun. La communauté juive est soumise à quelques persécutions, parfois à la hauteur de leur visibilité, des excès autoritaires de la politique Israélienne dans les territoires occupés. Je suis un homme âgé et n’ai jamais subi, ni été le témoin d’un acte antisémite. C’est aussi cela que j’ai voulu raconter. Je ne m’exprime pas sur le négationnisme tellement ridicule pour moi dont le père a été le témoin direct des chambres à gaz. C’est un peu comme les platistes qui croient que la terre est plate, ou comme Zemmour qui dit que Pétain a sauvé des juifs : remarquable intuition politique puisqu’il existe beaucoup de français qui s’imaginent que leur père ou grand père a participé à la solution finale, et qui les voient ainsi en quelque sorte réhabilités par Zemmour.

Claude Lanzmann (1925-2018)
M. A. : Vous consacré un grand nombre de pages au père et au fils, René et Georges, juifs sûrement malgré eux, médecins dévoués, mais aussi otages d’une religion « qui n’est pas une race », dites-vous, religion à la fois non choisie, mais qu’ils n’auront pas toujours suivie. On sent dans ce récit, que vous réglez justement vos comptes, me semble-t-il, avec votre judéité, comme si cela avait été un poids, le poids d’une vie, et que vous lui en vouliez un peu, n’est-ce pas ainsi qu’il faut aussi lire vos attaques contre une communauté qui ne sait se défaire de sa mémoire historique, qui pèse, qui la pèse, et qui nous pèse, selon vous ?
L. S. : Je ne me sens juif que face à un antisémite, comme l’a si bien écrit Jean Paul Sartre dans Réflexions sur la question juive. Cela m’est si rarement arrivé. Par contre, combien de fois par le passé et maintenant les propos anti arabes, antimusulmans ont droit de cité. C’est inadmissible. Je n’ai aucun compte à rendre comme vous le soupçonnez. C’est simplement le sentiment d’être concerné parce que juif par l’avenir de ce peuple dont je fais partie malgré tout mais pas malgré moi. Je souhaiterai vivement le protéger contre ses excès, l’amener à une vision plus réaliste de cette communauté au sein de la France, à côté des autres communautés dans une laïcité qui fait l’originalité de notre pays et sa force. Je ne suis pas dupe, je ne crois pas à la force des lois contre le racisme et l’antisémitisme ; je crois à la force d’une réflexion commune pour endiguer ces dérives. Et puis comme fils de déporté, j’ai le sentiment d’avoir une certaine légitimité à m’exprimer sur ces sujets dont je comprends parfaitement la difficulté.

Le docteur Laurent Sedel
En couverture : © Werner Otto - Olocausto