Diagnostic d’une crise du sens (Jean-François Mattéi)

La notion de « crise » semble aujourd’hui à la mode. Les formules telles que « crise de l’art », « crise du roman », « crise de société » sont légion. Pas une science, une discipline, une société qui n’ait eu sa crise… Sclérose, immobilisme, moment inéluctable de l’échec d’un système, la notion de « crise » stigmatise ce moment où l’on passe d’un état normal des choses à un moment où l’évolution n’est plus possible. Formule en référence à un état passé idéal, et un état présent dont le sens compris à partir de cet idéal aurait dégénéré… Cette recension est parue dans le numéro 5, du Magazine des livres, en juillet 2007. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
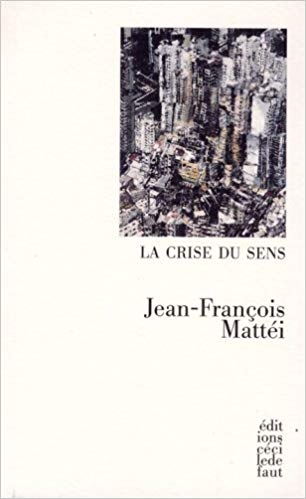 « La notion de crise implique une structure de discontinuité qui élève un événement historique au rang de moment inquiétant qui affecte le développement d’un processus humain au point d’en altérer le sens, c’est-à-dire la direction et la signification. »[1] Dans l’histoire et sa progression, la crise correspondrait ainsi à un moment de bégaiement, un chaos, une rupture dans la progression. En fait, rien de plus problématique que la notion de « crise ». Car qui, depuis Kant, Hegel ou Marx, pourrait encore croire qu’il y a une disjonction exclusive entre « crise » et « progrès » ? Toute la philosophie moderne a porté et pensé la crise comme un progrès dans l’Histoire, dans laquelle, du mal, on a vu sortir un bien. Penser la crise en adéquation avec le progrès, c’était alors prêter à la contradiction une certaine fécondité. Dans toutes les théories de l’histoire qui identifient un moteur inhérent à celle-ci, moteur comme devenir en tant qu’auto-déploiement, le mal et la violence font partie intégrante de l’histoire et de son progrès. Chaque société étant grosse d’une société nouvelle, Marx à la suite de Hegel nous enseignait que l’histoire n’en accouchait pas sans douleur. La violence devenue ainsi la sage-femme de l’histoire font des notions de « crise » et de « progrès » des notions inconciliables.
« La notion de crise implique une structure de discontinuité qui élève un événement historique au rang de moment inquiétant qui affecte le développement d’un processus humain au point d’en altérer le sens, c’est-à-dire la direction et la signification. »[1] Dans l’histoire et sa progression, la crise correspondrait ainsi à un moment de bégaiement, un chaos, une rupture dans la progression. En fait, rien de plus problématique que la notion de « crise ». Car qui, depuis Kant, Hegel ou Marx, pourrait encore croire qu’il y a une disjonction exclusive entre « crise » et « progrès » ? Toute la philosophie moderne a porté et pensé la crise comme un progrès dans l’Histoire, dans laquelle, du mal, on a vu sortir un bien. Penser la crise en adéquation avec le progrès, c’était alors prêter à la contradiction une certaine fécondité. Dans toutes les théories de l’histoire qui identifient un moteur inhérent à celle-ci, moteur comme devenir en tant qu’auto-déploiement, le mal et la violence font partie intégrante de l’histoire et de son progrès. Chaque société étant grosse d’une société nouvelle, Marx à la suite de Hegel nous enseignait que l’histoire n’en accouchait pas sans douleur. La violence devenue ainsi la sage-femme de l’histoire font des notions de « crise » et de « progrès » des notions inconciliables.
Cette définition du sens de l’histoire et de sa progression tient tant que l’on attribue aux évènements historiques une intelligibilité toute particulière qui trouverait son éclairage dans la fin de l’histoire et son épanouissement final. La crise (ou les crises) trouve un sens au moment où l’histoire parvient à son terme. Tout l’effort de Hegel d’ailleurs consistait à penser la raison dans l’histoire ou, pour être plus précis, la raison et l’histoire, comme deux notions inséparables. La postmodernité vient toutefois faire trembler les fondements de la théodicée ou de la fin de l’histoire comme idée régulatrice. « Il n’y a plus d’Esprit du monde, ni d’histoire pour nous conduire devant son tribunal. Autrement dit, il n’y a plus de sens du monde », écrit Jean-Luc Nancy[2]. Et Jean-François Mattéi de commenter : « Il faut renoncer, non seulement au sens, mais à la demande de sens, voire au « renoncement » lui-même qui garderait la nostalgie du sens. […] Les hommes sont (aujourd’hui) livrés à un présent éternel qui ne débouche sur rien. Il reste à vivre dans ce monde désenchanté, privé de Dieu, de transcendance ou d’histoire, privé aussi de justice, sans chercher à le réenchanter pour ne pas succomber aux pièges d’un sens aboli. »[3]

New York, 11 septembre 2001
Si jusqu’ici l’articulation entre « crise » et « progrès » se pensait aisément, la postmodernité est venue tout bouleverser : la crise de la science avec l’établissement dont il n’existait aucune source ultime de la connaissance ; crise la philosophie avec ses chemins qui ne mènent nulle part, et la fin de la métaphysique ; crise des religions monothéistes, de l’art, de l’économie, crise de la culture[4], tout converge vers un malaise de la modernité voire un effondrement.
À quoi ce malaise tient-il ? D’abord à la perte de la transcendance. Désormais, l’homme postmoderne ne peut aspirer à aucun espoir de grandeur. Perdu dans un monde livré à la barbarie, l’homme est « un être rivé à lui-même, sans ouverture sur autre chose que sa propre impuissance »[5]. Replié sur lui-même et sa subjectivité impossible, cet homme ne peut plus fonder son moi sur personne d’autre, - et certainement pas Dieu, ayant déserté la scène, - que lui-même. La récusation de l’immanence, la fin de la métaphysique, l’antiplatonisme des Modernes, font de cet homme livré à lui-même, un être qui, dans son ouverture vers autrui, est réduit à la « seule visée de la communication »[6] ; et même si, à proprement parler, nous pouvons croire en une éthique de la communication, celle-ci semble courir le risque d’ouvrir « sur rien d’autre que sa propre clôture »[7].

Maurizio Cattelan, La Nona Ora polyester, cheveux naturels,
accessoires, pierre, moquette. 1999
Autre écueil : le relativisme postmoderne. La postmodernité est problématique en ce sens que « pour se distinguer d’une modernité tributaire de l’exigence de stabilité dans son projet de tirer par la raison l’éternel du transitoire, la postmodernité s’est installée dans la faille du transitoire sans souci de ce vers quoi elle transit, entre la rive abolie de la modernité et la rive absente d’un futur sans avenir.[8] » Temporalités foudroyées, mémoire n’ayant plus la moindre dimension, pour l’homme postmoderne le tri s’avère à présent impossible, réduisant ainsi son époque au mode de la répétition ou de la dérision. Incapable de penser autre époque que la sienne, l’homme postmoderne est gagné par une pensée faible, molle, dont la déroute n’est dû qu’au déclin ou au renoncement. Exaltant un relativisme généralisé « d’une culture qui a rompu avec ses propres racines »[9], la rationalité a quitté toute critique pour en vider son oraison de tout sens, le logos désertant ainsi les territoires de la transcendance. Fin de cette critique « en tant que production de la transcendance »[10], cherchant par de multiples outils méthodologiques à dépasser les limites géographiques, linguistiques et culturelles qui limitent inévitablement la critique pour la réduire à une critique ethnocentriste. L’époque moderne, de par la brouille de toutes les frontières, n’est capable de rien d’autre que de produire un dernier credo, le plus vil d’entre eux, celui qui chante que « tout est égal, que tout se vaut et que rien ne saurait l’emporter sur rien »[11].
La postmodernité n’étant alors qu’« une méditation sur les ruines de ses propres illusions »[12] est une pensée en ruine ou une pensée des ruines. Éclatement des pratiques, déclin des religions, effondrement des idéologies, bienvenue dans l’univers technologique, de l’essor de la science, l’industrie et l’économie avec ses impératifs en matière de transformation du monde, et d’émiettement du travail et de la morale auquel elle procède en vue de sa propre survie. « La parcellisation des conduites morales a accompagné la parcellisation des tâches économiques »[13]. Avec le piétinement de toutes les valeurs, leur nivellement, apparaît un mouvement d’unification des comportements humains qui fera dire à Nietzsche décrivant cela comme un nihilisme passif qu’aux yeux du dernier homme « tout se vaut »[14]. Soit. Jugeons alors d’un des effets les plus pervers, celui de l’éthique qui, devenue terre de désolation, peine à retrouver la moindre hauteur, la moindre transcendance, et, ce, malgré les efforts de penseurs tels Lévinas, Habermas, ou Jonas qui dessine une belle et prometteuse éthique de la responsabilité. Certes, les paradigmes sont perdus, et « dans la mer de la complexité moderne, après le désenchantement du monde qui nous a privés des compas, des instruments, des routes et des valeurs utilisables, depuis qu’il n’y a plus de havre ou de fin à atteindre, il faut naviguer à vue »[15]. Mort de Dieu, et, avec elle, mort de l’homme dans son horizon indépassable, le constat nécrologique d’une disparition définitive de tout à-venir, semble s’enraciner.

Nieztche toujours badass !
« L’étendue de la crise atteint l’idée de vérité, dans sa nécessité théorique, et, par contrecoup, l’idée d’une existence humaine douée de sens, dans son exigence pratique, parce qu’il n’y a plus lieu d’imposer une direction à une humanité éclatée en communautés irréductibles »[16], écrit Jean-François Mattéi dénonçant le flamboyant nihilisme annoncé par Nietzsche et duquel il nous est encore difficile de nous extraire. Nihilisme athée, nihilisme du dernier homme, celui de l’« à quoi bon », ce fameux démon de notre cœur selon Georges Bernanos. Crise du sens ou crise de l’épuisement du sens, les renoncements du dernier homme vont soudainement bon train : « A quoi bon enfanter pour les unes, à quoi bon aller à l’école pour certains, à quoi bon vivre pour d’autres ? »[17] La crise est décidément diagnostiquée. Mais peut-on seulement la penser ? Peut-on lui apporter des remèdes ou simplement la subir ? Voilà donc l’objet de toute la question… Dessinant un brillant panorama des trois nihilismes qui attendaient l’humanité à la mort de Dieu, Nietzsche avait également imaginé une sortie, un au-delà du nihilisme. La philosophie non encore éteinte nous propose quelques outils pour faire front à la crise… parmi ceux-ci, un outil essentiel : l’éducation. Car, par l’éducation, l’issue de la crise du sens est possible. L’éducation par sa double fonction, celle de former un homme et de façonner un citoyen, permet surtout de penser ce qui nous menace de comprendre l’histoire. Et par là, « à défaut de changer le monde ou de le transformer, elle nous permet, c’est là le bien commun auquel nous pouvons prétendre, de l’habiter et de le penser. »[18] Bien belle sortie signée Jean-François Mattéi et judicieusement inspirée de Hölderlin.

Avec Jean-François Mattéi, à RCF-Nice,
pour une émission sur la crise du sens (2008)
(Texte établi à partir de La crise du Sens, Cecile Defaut, 2006.)
 (Chronique parue dans le Magazine des livres, n°5, juil-août 2007.)
(Chronique parue dans le Magazine des livres, n°5, juil-août 2007.)
En couverture : réalisation/hommage au 11 septembre (Dorian Gréau/Alain Le Quernec)
[1] Jean-François Mattei, La crise du sens, Nantes, Editions Cécile Defaut, 2006, p. 9.
[2] Le sens du monde, Paris, Galilée, 1993, p.13. Cité par Jean-François Mattéi.
[3] Jean-François Mattéi, Op. cit., p. 10.
[4] Qui ne doit pas être analysée comme une « désintégration » de la culture mais un « pourrissement ». Voir Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p.266. Cité par Jean-François Mattéi, Op ; cit., p. 20.
[5] Jean-François Mattéi, Op. cit., p. 24.
[6] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.40.
[7] Jean-François Mattéi, Op. cit., p. 41.
[8] Jean-François Mattéi, Op. cit., p. 60.
[9] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.67.
[10] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.69.
[11] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.70.
[12] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.72.
[13] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.77.
[14] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.79.
[15] F. Volpi, cité par Jean-François Mattéi, Op. cit., p.98 ;
[16] Jean-François Mattéi, Op. cit., p. 105.
[17] Jean-François Mattéi, Op. cit., p.107.
[18] Jean-François Mattéi, Op. cit., p. 117.
Commentaires
Félicitations Marc !! beau blog et beau travail ! J'ai pris les titres de tes travaux et je vais commander ça. Bravo pour ton parcours et au plaisir de te revoir.
Arno (Rosset)