Doit-on s'inquiéter des progrès de la civilisation ?

On note désormais une inquiétude nouvelle face aux progrès de la civilisation, même si certains s’alarment depuis au moins 50 ans. Ceci dit, la prise de conscience réelle est récente, et s’accélère depuis ces deux dernières décennies, faisant suite à une première dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette tribune est parue dans le site du mensuel Entreprendre. Elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
De nombreuses craintes aujourd’hui existent face à l’épuisement des ressources naturelles, du danger des avancées technologiques, notamment par l’usage de l’énergie nucléaire, qui fait courir un risque nouveau à l’ensemble de l’humanité : celui de sa propre disparition (qui a commencé avec les camps de concentration et les deux bombes atomiques en 1945), puis a continué avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en 1986, hantant encore les esprits, celui de Fukushima, le vendredi 11 mars 2011. Inutile de rajouter que le progrès humain peut légitimement inquiéter. Cette tribune fait d’ailleurs suite à une autre que j’ai publiée dans ces pages[1].

Un parc d’attractions abandonné dans la zone d’exclusion de
Tchernobyl, le 15 avril 2021. PHOTO / STRINGER / SPUTNIK VIA AFP
Avant la politique, la littérature s’était déjà emparée de cette inquiétude à travers la dystopie, qui rend visibles et sensibles les dangers encourus par l’humanité. Elle a créé des mondes, certes imaginaires, mais possibles, en déployant dans l’avenir les potentialités du présent. Prenez par exemple, l’écrivain français Antoine Volodine : il imagine l’existence de survivants à une catastrophe nucléaire (Terminus radieux, Seuil, 2014). Dans une bande-dessinée, c'est David Ratte qui imagine un héros ordinaire, Sam, personnage principal de l’histoire, aux préoccupations banales de Monsieur-tout-le-monde, sauf, qu’à l’image de tous ses congénères, il doit en permanence (même au lit !) porter un masque à gaz (Planet toxic, paru en 2006). Bien sûr, cela nous rappelle quelque chose !

Extrait de Toxic Planet, l’Intégrale, par David Ratte, Éditions Paquet, 2012
Ce héros sans visage, dont on suit les états d’âme, et la vie au quotidien, vit dans un futur qui, chaque jour, peut sembler de plus en plus proche, et même un peu trop proche... Un futur dans lequel l’air est devenu irrespirable, où les dernières espèces ont totalement disparu. On y voit une planète gangrénée par une pollution omniprésente ; le réchauffement climatique et les déchets toxiques saturent le paysage. Bref, un panorama apocalyptique si proche de nous qu’il en devient effrayant. Pourtant, Sam, et Daphné sa compagne, ainsi que ses amis et ses collègues, vivent dans ce monde pétri d’une parfaite insouciance, au point que cela nous désarme, nous lecteurs (« C’est comme ça et puis c’est tout ! Et puis d’abord, qu’est-ce qu’on y peut ? »). Quelle bande de sages que ces personnages proches des stoïciens, vivant dans un endroit où la production industrielle sans limite associée au pillage éhonté de la planète (du moins ce qu’il en reste) se poursuit inexorablement ! (Cela me rappelle les jeunes générations d’aujourd’hui et leur fatalisme de circonstance : « On verra bien ! », « Avec un peu de chance... », etc.) On y croise également une police chargée de traquer les derniers militants écologistes, un président nerveux et de petite taille au discours cynique et démago et aux visions écologiques et humanitaires ultralibérales ; un tiers monde méprisé et manipulé par les « grandes puissances » usant d’armes de destruction massive bien dérisoires ; des villes où « malbouffe » et « surconsommation » règnent sans partage. Bref, une critique cachée du néolibéralisme et une mise en garde explicite de ses dégâts sur la planète et l’humanité. Nourrie de références à une actualité récente et de faits de société qui remplissent les colonnes de nos journaux, l’intégrale de cette série publiée en 2006, vient nous rappeler avec une certaine cruauté, nos échecs et notre immobilisme coupables dans la réalisation d’un véritable développement durable.
Dans son roman Terminus radieux, paru en 2014 (cité plus haut), l’auteur français Antoine Volodine (né en 1950), met en scène une histoire qui se déroule après une catastrophe en Sibérie, alors qu’une série d’accidents nucléaires ont eu lieu. Malgré les catastrophes, des personnages, même irradiés, tentent de perpétuer l’utopie d’une communauté égalitaire.
Nous voyons là comment les écrivains et la littérature se sont emparés de la question métaphysique et morale de l’évolution technique depuis déjà plusieurs décennies, comment ils nous donnent à réfléchir à partir de ces expériences de pensée, mais aussi par quels moyens ils cherchent à nous conduire à une méditation profonde sur nos actions et responsabilités au présent. Il ne s’agirait donc plus de penser notre monde actuel en termes défaitistes ou fatalistes, mais de se réapproprier un avenir dont on doit rester les maîtres.
En 1972, Le troupeau aveugle de John Brunner, difficile à classer entre anticipation ou dystopie, annonçait déjà des faits étranges et d'actualité, au point de nourrir le débat contemporain. Dans ce roman de SF, notre Terre est devenue une sphère stérile. L'atmosphère est tellement polluée que le port du masque à gaz est obligatoire. Par les possesseurs de tout-terrain des villes et les utilisateurs du diesel, un épais nuage couvre l'ensemble du globe terrestre. L'utilisation de produits chimiques illégaux ont rendu les parasites résistants. Les insectes pollinisateurs sont vendus dans le commerce car devenus rares à l'état sauvage. Inutile de souligner qu’entre fable écologique et dystopie racontant les désastres d’un monde parti trop loin dans le progrès technologique, ce roman fait frémir. L'action se déroule sur une année complète. Chaque découpage compose un mois, mais le plus étonnant reste sa structure narrative : en fil rouge, nous suivons des personnages et une histoire. Parmi eux, Austin Train devenu l'icône d'une lutte contre ces industriels, de l'autre, le milliardaire Jacob Bamberl, aux méthodes douteuses. Des articles, des publicités et autres textes viennent entrecouper le récit.

Couverture des deux tomes du roman de John Brunner,
paru en 1972, et repris dans la collection J’ai lu
Comment ne pas déduire de cette somme de romans écrits sous la forme de mise en garde, que l’écologie punitive est en grande partie nait de toutes ces peurs millénaristes ? L’homme est un technicien par nature, un homo faber, dit Bergson. C’est aussi un « homme qui sait », homo sapiens. Il est donc d’abord un être qui œuvre, qui fabrique, qui construit, qui ajuste, etc. La technique n’est cependant plus aujourd’hui, cette méditation par laquelle l’homme s’adapte au monde pour en tirer sa subsistance, voire son confort par l’action de son corps, de ses mains, de ses outils. Favorisant un phénomène d’insulation (terme que je reprends au philosophe allemand Peter Sloterdijk) c’est-à-dire un phénomène de mise à distance de l’adversité de la nature, nos outils ont fini par substituer à notre environnement naturel un univers technique, presqu’intégralement artificialisé. L’homme nait à l’hôpital entouré de machines et meurt bien souvent dans le même endroit, perfusé, médicalisé. Dans l’intervalle, notre existence se déploie à l’ombre omniprésente de créations techniques pouvant faire l’objet d’interminables inventaires comme la voiture, le téléphone portable, la machine à laver le linge, la télévision, l’ordinateur, etc. Dans son roman, Du côté des Guermantes, Marcel Proust fait séjourner son narrateur à Doncières. Celui-ci se prépare à aller au bureau de poste, à une heure fixée à l’avance, afin de pouvoir parler au téléphone avec sa grand-mère. Il raconte alors, le miracle du téléphone, qui nous paraît à nous si naturel et banal aujourd’hui. La technique est la manifestation de la puissance de l’homme sur la nature. Son intelligence, dans sa manifestation originelle, est en effet fabricatrice, comme le montre Bergson, et elle permet aux hommes d’atteindre l’idéal posé par Descartes, dans son Discours de la méthode : se rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Nous avons tellement suivi l’injonction cartésienne, qu’au XXe siècle, la nature se trouve provoquée et domestiquée toujours plus largement : le développement technique nous met face à de nouvelles difficultés, telles que la surexploitation des ressources naturelles et les urgences climatiques notamment, au point d’échapper au moins en partie, au ressort des êtres humains. L’humanité joue peut-être les apprentis-sorciers, elle l’a déjà fait et elle le refera. Sera-t-elle dépassée par ses propres créations ?
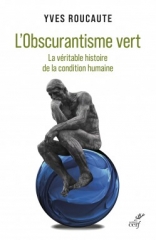 Désormais, on vit un moment de soupçon vis-à-vis la technique. On se demande si cette dernière n’a pas asservi l’homme, l’ayant mis sous tutelle : on voit l’homme devenir peu à peu l’assistant d’une machine, qui se substitue à lui dans un grand nombre de tâches au quotidien, on constate des effets délétères de la technologie sur notre planète : réchauffements, glaciations, séismes, volcans, tsunamis, cyclones, inondations, etc. L’enfer s’ouvre sous nos pieds, et on ne compte plus les mesures politiques et légales censées freiner le désastre. L’urgence devient désormais de « sauver la planète ». Mais ne serait-ce pas plus juste de dire : « sauver l’homme d’une planète qui se venge de lui » ? Car on accuse l’humanité d’être le responsable du réchauffement de la planète. On accuse l’homme de tous les maux, le forçant à délaisser sa voiture pour marcher à pieds, ou se déplacer à vélo. Bientôt à cheval ? On culpabilise les voyages en avion. On culpabilise les consommateurs. La culpabilisation étant devenue un moyen commode d’assurer la transition écologique voulue par les grandes firmes. Dans un essai bien documenté, Yves Roucaute montre que le réchauffement climatique est une galéjade, avant l’humanité les températures étaient beaucoup plus élevées que les 15° que l’on connait habituellement. « Les dinosaures broutaient au Groenland par une température de 29°C », déclare-t-il dans le Figaro[2]. Il rajoute que « depuis 2,8 millions d’années, les humains ont subi 17 glaciations, entrecoupées de périodes plus chaudes qu’aujourd’hui. Avant la dernière glaciation, les hippopotames se baignaient dans la Tamise. Le seul réchauffement d’il y a 4200 ans détruisit nombre de civilisations, celui de 950 permit aux Vikings de créer deux colonies au Groenland. Les variations climatiques sont la règle, l’humanité tente de survivre. »[3]
Désormais, on vit un moment de soupçon vis-à-vis la technique. On se demande si cette dernière n’a pas asservi l’homme, l’ayant mis sous tutelle : on voit l’homme devenir peu à peu l’assistant d’une machine, qui se substitue à lui dans un grand nombre de tâches au quotidien, on constate des effets délétères de la technologie sur notre planète : réchauffements, glaciations, séismes, volcans, tsunamis, cyclones, inondations, etc. L’enfer s’ouvre sous nos pieds, et on ne compte plus les mesures politiques et légales censées freiner le désastre. L’urgence devient désormais de « sauver la planète ». Mais ne serait-ce pas plus juste de dire : « sauver l’homme d’une planète qui se venge de lui » ? Car on accuse l’humanité d’être le responsable du réchauffement de la planète. On accuse l’homme de tous les maux, le forçant à délaisser sa voiture pour marcher à pieds, ou se déplacer à vélo. Bientôt à cheval ? On culpabilise les voyages en avion. On culpabilise les consommateurs. La culpabilisation étant devenue un moyen commode d’assurer la transition écologique voulue par les grandes firmes. Dans un essai bien documenté, Yves Roucaute montre que le réchauffement climatique est une galéjade, avant l’humanité les températures étaient beaucoup plus élevées que les 15° que l’on connait habituellement. « Les dinosaures broutaient au Groenland par une température de 29°C », déclare-t-il dans le Figaro[2]. Il rajoute que « depuis 2,8 millions d’années, les humains ont subi 17 glaciations, entrecoupées de périodes plus chaudes qu’aujourd’hui. Avant la dernière glaciation, les hippopotames se baignaient dans la Tamise. Le seul réchauffement d’il y a 4200 ans détruisit nombre de civilisations, celui de 950 permit aux Vikings de créer deux colonies au Groenland. Les variations climatiques sont la règle, l’humanité tente de survivre. »[3]
Or, plutôt que de prôner une sorte d’écologie punitive ajoutée à une culpabilisation systématique, ne pouvons-nous par chercher à savoir si certaines ressources propres à l’homme pourraient nous permettre de nous réapproprier notre puissance technique ? Certes, limiter le pouvoir de cette dernière se présente comme un défi. Mais les études du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), que l’on consulte comme autrefois les hommes consultaient les textes sacrés ou les oracles, sont-ils si fiables qu’on le prétend dans la presse ? Yves Roucaute nous dit encore que, depuis 1988, ce groupe d’experts « s’est mis sur le marché de l’« apocalypse now ». Son directeur, Hoesung Lee, après des études littéraires, a commis une thèse en économie sur le réchauffement où ses prévisions se sont révélées fausses ». La guerre en Ukraine a bien montré que les pyromanes ayant inspiré la mise en dépendance envers la Russie, convaincant tout le monde d’abandonner le charbon et le nucléaire, ont eu là tout faux une fois de plus. Si l’on suit les thèses du philosophe Hans Jonas, il nous faudrait pourtant limiter le pouvoir de la technique, en appelant à une responsabilité collective. Tenant de « l’apocalypse now », ce philosophe très respecté dans les milieux intellectuels, joue, lui aussi, sur les peurs millénaristes. Et, si ses travaux ont ouvert la voie à la fin du XXe siècle à une réflexion politique des plus urgentes, c’est tout de même oublier un peu vite le principe de Gabor, du nom de Dennis Gabor (1900-1979), ingénieur et physicien d’origine hongroise et inventeur de l’holographie (Prix Nobel de physique en 1971), à qui on attribue la citation suivante : « Tout ce qui est techniquement faisable doit être réalisé, que cette réalisation soit jugée moralement bonne ou condamnable. » Cela revient à dire que l’innovation n’attend personne. Dès qu’une découverte est faite, celle-ci peut immédiatement basculer dans le domaine commercial, et apparaît donc dans le paysage.

Yves Roucaute: «Sauver la planète de l’humanité est une galéjade»
Par Marie-Laetitia Bonavita. Publié dans Le Figaro, le 03/06/2022
Conclusion (provisoire) : Si l’action humaine a des conséquences illimitées, le philosophe et psychanalyste Cornelius Castoriadis considère que cela revient aux hommes de s’autolimiter. La Nupes de Mélenchon cherche à culpabiliser l’Occident, en rejetant le capitalisme. Les jeunes diplômés d’AgroParisTech ont appelé à « déserter » l’agro-industrie, en cédant aux sirènes de l’obscurantisme vert, etc. Pourtant, si l’apocalypse est dite pour bientôt, que l’écologie punitive fait recette, n’est-il pas plus judicieux de réfléchir à une écologie spirituelle plutôt qu’à cette écologie matérialiste et misérabiliste ? « Remettre l’homme au centre de l’univers et favoriser sa domination de la nature, voilà le chemin de la vraie moralité. Pourchasser ce qui nuit à sa joie de vivre, à sa liberté, à sa puissance, voilà le chemin de la véritable écologie », déclare Yves Roucaute. Une piste bien plus positive que cette psychose verte. Une piste à méditer...
(To be continued)
___________________________________________________________
[1] « Le transhumanisme est-il une menace pour l’humanité ? »
[2] Le Figaro, du 4 juin 2022.
[3] Idem.
[4] L’Obscurantisme vert. La véritable histoire de la condition humaine, d’Yve Roucaute, Éditions du Cerf, 2022.