Entretien avec Thomas Morales. La France, c’était mieux avant !

Thomas Morales est une voix importante dans le paysage français. Auteurs de livres remarqués, notamment Éloge de la voiture. Défense d’une espèce en voie de disparition et Un été chez Max Pécas, signant par ailleurs des tribunes régulières dans Le Figaro, il revient avec un livre marquant, Monsieur Nostalgie (Héliopoles, 2023), sorte de requiem pour la France, sa langue, sa culture, son bon goût, son art de vivre. Tout autant un plaidoyer pour un pays rayonnant qu’un récit mélancolique face à ce qu’il est devenu, ce texte est à la fois brillant et subtil, et Thomas Morales, nous y livrant ses impressions, ses commentaires sur notre Patrie, nous révèle également son univers très particulier. La France, était-ce mieux avant ? Réponse dans cet entretien mené à bâtons rompus. Cet entretien est paru dans le site du magazine Entreprendre.
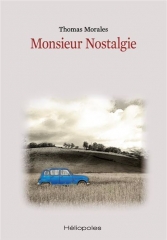 Marc Alpozzo : Cher Thomas Morales, votre livre Monsieur Nostalgie[1] est une « lettre à France », un témoignage, dites-vous dans votre Avant-propos, voire un « testament », le mot est très fort, en quoi ce beau texte d’un cinquantenaire exprime-t-il son amour pour son pays ?
Marc Alpozzo : Cher Thomas Morales, votre livre Monsieur Nostalgie[1] est une « lettre à France », un témoignage, dites-vous dans votre Avant-propos, voire un « testament », le mot est très fort, en quoi ce beau texte d’un cinquantenaire exprime-t-il son amour pour son pays ?
Thomas Morales : J’aime mon pays, ma langue et ma Patrie ne font qu’un dans mon esprit, j’aime aussi le vieux Paris, la province, les sous-préfectures endormies, les bords de Loire, les engins motorisés obsolètes, de la mobylette à la Citroën SM, la littérature de Villon à Blondin, les illustrés de mon enfance, les perdants magnifiques, le cinéma de papa, les ringards flamboyants, les cascades de Rémy Julienne le dimanche soir à la télé, le romantisme échevelé de Philippe de Broca et les auteurs réprouvés que sont les Hussards. Ma France n’entre dans aucun manuel, aucun code, aucun gabarit, je tente cependant de faire le pont presque impossible entre la comédie populaire incarnée au cinéma par Henri Verneuil, Gérard Oury et Georges Lautner et les errements du cœur chers à Claude Sautet et à Paul Guimard. Entre le « Corniaud » et les « Choses de la vie », mon cœur balance toujours. Je n’ai pas encore choisi mon camp à presque cinquante ans. Cette France-là est difficile à encapsuler et c’est un petit-fils de marchand de vin qui vous en parle, car elle peut donner des messages contradictoires, elle n’est pas linéaire, ce n’est pas une dissertation en trois parties. Ma France est donc foutraque, éprise de liberté, irrévérencieuse et, en même temps, elle s’inscrit dans les temps immémoriaux, par ses paysages et la permanence de ses mots. Ma France refuse la littérature à thèse qui instrumentalise et les donneurs de leçon dont le nombre semble grossir chaque année un peu plus. Ma France est peut-être un rêve, un mirage, j’en saisis dans « Monsieur Nostalgie » quelques éclats fugaces, quelques reliques, quelques fragments. Il y a un côté bazar aux souvenirs que je revendique fièrement, accumulation d’objets et de personnalités plus ou moins connues. Ma France peut s’enivrer d’un canard au sang préparé par le regretté Claude Terrail à la Tour d’argent, mais aussi s’accouder dans un Routier, devant un œuf mayo et un ballon de sauvignon. Je retrouve, par exemple, la beauté et la friabilité de mon pays chez le poète André Hardellet ; elle est, sous sa plume, buissonnière, banlieusarde, à la lisière du fantastique, gourmande avec des accents érotiques. Cette liberté chérie de rire de nous-mêmes semble avoir disparue des radars ces trente dernières années. Nous avons tellement appris à détester nos aïeux, à masquer toutes nos traces d’humanité. Moi, je les remets en lumière sur un ton rieur et carnavalesque ! Je dis à mes contemporains, n’ayez pas peur de regarder dans le rétroviseur, ce n’est pas un signe de faiblesse, plutôt un acte de résistance dans un monde qui déraille. Et qui sait, dans ces images d’Epinal, un peu fanées et ridiculisées par les tenants d’un progressisme à tout crin, vous y trouverez peut-être des sources d’inspiration, enfin je l’espère.
M. A. : On trouve dans le titre de votre ouvrage un mot très fort, celui de « nostalgie ». Or, en ouvrant un dictionnaire quelconque, on trouve rapidement la définition de ce mot : « nom féminin 1. Mal du pays. 2. Regret mélancolique (d'une chose révolue ou de ce qu'on n'a pas connu) ; désir insatisfait. Avoir la nostalgie de son enfance. » Le mot le plus proche est celui de mélancolie. Diriez-vous que vous avez mal à votre France ? Que votre pays vous échappe ? Que ce que la France devient vous conduit à la mélancolie et à la tristesse ? Et pourquoi ?
T. M. : D’abord, je dois vous avouer que sans nostalgie, il n’y a pas de littérature possible. C’est son principal activateur, son moteur essentiel, dès que l’on couche des mots sur le papier, on réactive les vannes du passé pour le tordre, le fantasmer ou mieux, le faire perdurer dans les mémoires. C’est l’option littéraire que j’ai choisie, en utilisant une forme particulière : la chronique. J’y tiens beaucoup car j’estime qu’elle surclasse les autres genres, elle dépasse même le sacro-saint roman. Elle demande du jus, du nerf et un élan salvateur ; du rythme et de la fluidité, ce sont les deux seules choses qui m’animent dans la vie. Je mets modestement mes pas dans ceux magistraux de Kléber Haedens et de l’italien Ennio Flaiano. Mon ambition est comme l’écrivait Valery Larbaud de faire de la réalité et de nos rêves un peu de prose. Et ma nostalgie me pousse vers les Trente glorieuses, époque bénie que j’ai à peine effleurée, car je suis né en 1974, la décadence était déjà en marche, comme inscrite dans mes gênes. Mon bain culturel est cette France des années 60 et 70, de l’expansion économique jusqu’aux premières crises, d’une société quelque peu corsetée à une émancipation rieuse. J’aime cet entre-deux-là, cet espace qui n’a pas soldé le passé et entrouvre la fenêtre sur un avenir que l’on pensait heureux. Dans cette capsule-temps, j’y entasse mes marottes, mes « Big Jim » et mes « bicross ». Le petit poucet semait des cailloux, moi je collectionne les traces du passé. « Monsieur Nostalgie » est mon album Panini personnel que j’ose montrer au public. Je suis un boulimique, je ne résiste pas à l’achat d’un livre de Jacques Perret, de Georges Conchon ou d’Albert Cossery chiné dans les boîtes vertes des bouquinistes dont je défends le maintien durant les Jeux Olympiques de Paris. Je ne résiste pas non plus à une miniature auto, avant de répondre à votre entretien, j’ai acquis une « Majorette », par gaminerie, par sentimentalisme. Ça confine à l’obsession, je vous l’accorde. Dans mon dernier livre, j’enfourne mes mythologies automobiles, mes acteurs, mes écrivains, mes chanteurs populaires, mes hommes politiques, mes sportifs, mes illusions et aussi mes espoirs déçus. Attention, je ne suis ni un béat, ni un enlumineur, je ne tente pas de réécrire l’Après-guerre sous un mode folklorique et guilleret. Toutes les époques charrient leur lot d’injustices. Je ne suis pas un théoricien, ni un sociologue, seulement un écrivain qui travaille sur cette matière noble et tente de faire partager la quintessence de notre vieille communauté de destin. Tout ça semble si loin aujourd’hui. Tant de choses, d’événements, de lieux ont été foulés, saccagés par bêtise. Tant de reniements aussi. Alors, je pourrais vous dire que la France actuelle m’ennuie et me désespère, elle manque à la fois de sursaut moral et de second degré, de panache et de stature. Ce n’est pas très original, vous en conviendrez. Nous sommes nombreux à faire ce constat-là. La France d’aujourd’hui est sentencieuse jusqu’à la haine, elle a le goût du déni et de la victimisation. Elle se tient parfois mal à la table du monde. Elle est également peu amène avec ses propres aînés. Dans « Monsieur Nostalgie », je m’appuie sur des figures vraiment tutélaires. Que serais-je devenu si, à l’adolescence, je n’avais pas rencontré Gabin, Bourvil, Marielle, l’indispensable Charles Denner ou l’inénarrable Pierre Mondy ? Ces seigneurs pratiquaient leur art avec talent bien sûr et surtout avec une droiture qui nous élève. Ils avaient de l’allure, du charisme, leurs silences étaient intelligents, ils ne parlaient pas tous les jours à la radio ou à la télé pour quémander des « likes » ou se plaindre, ils étaient discrets comme doivent l’être d’honnêtes hommes. Ils avaient beaucoup lu et travaillé, c’est un bon début pour espérer transmettre.
M. A. : « La nostalgie n’est pas encore un crime »[2], écrivez-vous. Alors, certes, pourtant, tout ce que vous déballez dans votre ouvrage semble vous faire prendre le risque d’une mise au pilori manu militari par la presse officielle, la Pravda des lettres, et le common sens officiel : vous pleurez votre langue, votre province, votre Paris, votre brocante, votre cinéma, votre télévision, bref, plus rien ne va pour vous. Votre texte semble être à la fois un dépôt de bilan et en même temps, (puisque dans la France de Macron nous sommes plongés plus que jamais dans le « en même temps », allons-y !) une sorte de plaidoyer, peut-être le meilleur des plaidoyers, pour faire aimer votre pays aux étrangers, voire même à encore quelques Français qui n’ont pas oublié leur identité ni d’où ils venaient ? Ce précis de nostalgie, est-il un guide pour les égarés qui cherchent encore la France quelque part en France ?
T. M. : Nous sommes tous des égarés. Nous naviguons à vue. Nous sommes pris dans la tenaille, entre une consommation à outrance et une standardisation de l’existence, une moralisation inquisitrice et une passivité humiliante. Et gare aux dérapages et aux embardées. Vous vous souvenez de la série britannique « Le Prisonnier » créée par Patrick McGoohan. Nous sommes tous des « Numéro 6 » sans malheureusement la possibilité de conduire une Lotus Seven. C’est interdit d’aimer les mécaniques expansives. Vous savez, simplement, sans grands mots à la rescousse, je n’ai pas honte de mon pays. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Quand je vois aux prémices de l’hiver les coteaux givrés du Sancerrois, je suis pris d’une émotion sincère. Je me revois, jeune journaliste, carnet moleskine à la main, écrire mes premiers reportages dans cette France rurale que je connais bien, courir d’une réunion de conseil municipal à un derby de rugby, passer une journée avec des élèves d’une classe unique dans un village qui ne semblait pas avoir bougé depuis Jules Renard ou Henri Vincenot, comment détester cette nation-là ! C’est pourquoi dans « Monsieur Nostalgie », je n’hésite pas à me mettre en scène, la chronique désincarnée n’est pas pour moi. Si j’évoque le Tour de France, c’est au plus près de mes souvenirs, je convoque mon grand-père, le démarcheur de la banque et les commentaires de Robert Chapatte dans le poste.
M. A. : On vous connait pour vos superbes tribunes dans Le Figaro, mais aussi pour des livres qui ont connu un beau succès, comme votre Éloge de la voiture[3], ou votre éloge du cinéma[4]. Vous ne défendez pas seulement la France et la culture française, mais vous défendez aussi la culture populaire, le cinéma de Philippe de Broca[5], le cinéma de Bébel[6], la discographie de Philippe Lavil, la littérature d’Alphonse Boudard, le dessin d’Albert Uderzo, l’humour de René Goscinny, le cinéma français, l’écrivain Cécil Saint-Laurent, le créateur de Caroline Chérie, et j’en passe. Qu’est-ce qu’il y a de si caractéristique dans la culture française ? Qu’est-ce que cette culture dit-elle de nous aujourd’hui, de ce que nous sommes et de ce que nous avons été ?
T. M. : Je n’ai pas la prétention de muséifier la « culture française ». Encore moins de la momifier. Je ne détiens aucune définition officielle. Par la variété des angles que vous venez de citer, j’ai, par contre, plaisir à montrer son extraordinaire vitalité durant ces Trente glorieuses. Á vrai dire, notre culture n’est jamais aussi rayonnante, puissante et « inspirante », cet adjectif déclassé qu’adorent les publicitaires, que lorsqu’elle réussit à faire le lien invisible, car tellement soyeux et impalpable entre la culture populaire et une forme d’art que je qualifierais maladroitement de plus exigeant. Philippe de Broca en était l’exemple le plus parfait. Je précise qu’il est vénéré dans les écoles de cinéma aux États-Unis, c’est dire qu’ailleurs on sait reconnaître le génie français à sa juste valeur. Broca a fait son succès dans des comédies d’action grand public, vivifiantes, presque épuisantes tant il fait courir ou cavaler ses héros de fiction. Dans ce cinéma-là, on rit, on vibre, on entend la voix d’Alexandre Dumas dans les sous-bois, le spectateur haletant est captivé par cette frénésie. Si ce n’était que ça, nous resterions malgré tout sur notre faim. Broca est éminemment français car il y ajoute les amours impossibles, toute la tradition romantique, et il s’autorise les bons mots, le dialogue percutant est signé Michel Audiard ou Daniel Boulanger. Et puis, au détour d’une scène, le réalisateur se fait plus grave, plus moraliste, ce toucher de pellicule est superbe. Les larmes nous montent aux yeux car on y perçoit l’homme dans toute sa fragilité, mais Broca n’insiste pas, ne se liquéfie pas dans le larmoyant, il enchaîne par une scène en mouvement, par politesse et classe. J’aime cette pudeur-là.
_________________________________________
[1] Paris, Héliopoles, 2023.
[2] Op. Cit., p. 60.
[3] Éloge de la voiture. Défense d’une espèce en voie de disparition, Monaco, Le Rocher, 2018.
[4] Un été chez Max Pécas, Paris, Pierre-Guillaume de Roux, 2019.
[5] Voir chapitre « Mon humeur », pp. 159-188.
[6] Thomas Morales, Bébel et moi, Paris, Nouvelles Lectures, 2017.