Entretien avec Claire Legendre « La réalité ne dépasse pas la fiction, elle naît par la fiction »

J'avais rencontré Claire Legendre alors qu'elle faisait ses débuts avec un livre qui était une sorte de roman pris dans les modes de son époque, que l'on disait très prometteur, nous étions en 1998. Auteur appartenant à la jeune garde montante, née à Nice en 1979, elle venait donc de faire une entrée remarquée dans la littérature française, avec ce premier roman aux accents de polar américain : Making of[1], que je trouvais assez mauvais pour ma part. Mais l'aura médiatique de cette jeune femme de vingt ans me donnait toutefois envie de continuer. Quelques mois plus tard, elle publia Viande (1999), puis quelques autres textes chez Grasset, et elle fut classée, peut-être un peu trop rapidement, dans la catégorie des jeunes auteurs phares montants. Loin du microcosme parisien cependant, Claire Legendre vivant dans le sud de la France, écrivait et enseignait la sémiologie théâtrale et l'écriture dramatique à l’Université de Nice, tout en terminant une thèse sur le théâtre de Stanislavski. J'avais alors demandé à la rencontrer en 2006, à la sortie de son roman, La méthode Stanislavski, parce que je voulais désormais en savoir un peu plus sur cette jeune écrivain, dont les romans me tombaient tous des mains, mais que j'avais plusieurs fois côtoyée dans des salons littéraires et vue sur un plateau de télé, répondre admirablement à Thierry Ardisson dans une émission qui ne faisait jamais de concession à ses invités. Cet entretien a trouvé une place dans La presse littéraire d'avril 2006, et il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
 On peut le dire, dès 1999 avec Viande[2], un roman dont le titre semble d’emblée se poser telle une dénonciation, vous vous inscrivez dans un courant hyper-féminin (et non pas féministe), qui revendique la levée des tabous, une nouvelle écriture féminine, armée d’un réel désir de guerre, avec pour volonté de libérer la femme du désir et de l’égoïsme de l’homme. Vous rejoigniez par là d’autres écrivains comme Claire Castillon, Virginie Despentes, Catherine Millet, Catherine Breillat et bien d’autres. Mais depuis quelques années, il semble que vous ayez quitté le train en marche. Pour vous, cette revendication est-elle bien sérieuse ? Croyez-vous que la littérature puisse faire encore bouger quelque chose ? Car si l’on en croit Michel Houellebecq, un roman ne changera plus jamais le monde.
On peut le dire, dès 1999 avec Viande[2], un roman dont le titre semble d’emblée se poser telle une dénonciation, vous vous inscrivez dans un courant hyper-féminin (et non pas féministe), qui revendique la levée des tabous, une nouvelle écriture féminine, armée d’un réel désir de guerre, avec pour volonté de libérer la femme du désir et de l’égoïsme de l’homme. Vous rejoigniez par là d’autres écrivains comme Claire Castillon, Virginie Despentes, Catherine Millet, Catherine Breillat et bien d’autres. Mais depuis quelques années, il semble que vous ayez quitté le train en marche. Pour vous, cette revendication est-elle bien sérieuse ? Croyez-vous que la littérature puisse faire encore bouger quelque chose ? Car si l’on en croit Michel Houellebecq, un roman ne changera plus jamais le monde.
Je crois qu’un roman n’a jamais changé le monde, et heureusement, d’ailleurs, ce n’est pas fait pour cela. Un romancier n’a de pouvoir que sur ses personnages, ses mots, sa fiction, éventuellement la psyché de son lecteur, ou du moins son imaginaire, et probablement, un petit pouvoir très limité sur l’histoire littéraire. Mais sur le monde, sa marche en général, rien, écrire une fiction c’est précisément s’abstraire du monde réel le temps de l’écriture. Si je voulais changer le monde, ou plutôt si je croyais en avoir le pouvoir, je ferais de la politique. Ecrire un roman, c’est aussi assumer le constat de notre impuissance à influencer le réel – puisque je ne peux rien faire pour embellir ma réalité, je vais passer un an ou deux dans un univers que je me choisis, que je me crée sur mesure. C’est un peu caricatural, mais il y a de ça. Mon univers rêvé porte évidemment les traces, en réaction, du monde réel que je fuis en l’écrivant. La publication, c’est autre chose, et peut-être qu’à ce moment-là, au moment de la confrontation des deux univers – réel et fictif – il y a un orgueil, une foi nécessaire, croire au pouvoir du roman. Ca dure trois mois. C’est un fantasme qui permet de passer la cap de la sortie en librairie, et puis on constate l’évidence, et on rentre tranquillement chez soi écrire un autre livre.
Viande était peut-être un livre féministe, mais désenchanté : la domination masculine, je ne la dénonçais pas comme une injustice sociale, mais comme une évidence physiologique. On ne peut pas changer cet état des choses : la domination masculine est intrinsèque, corporelle, incorrigible. Si l’on peut changer quelque chose, ce sont les consciences, les regards, mais contre les corps on ne peut rien.
Quant aux autres romancières que vous citez, je ne les ai quasiment pas lues – elles ont un univers singulier je pense, et le grand sac dans lequel on nous a mises était un raccourci journalistique confortable et assez maladroit. S’il y a une seule chose que l’on revendique en écrivant, c’est sa singularité propre. Je n’ai donc pas quitté le train en marche puisque de train, il n’y en avait pas. Nos chemins se sont peut-être croisés à un moment, mais chacune poursuit sa route, et la mienne me semble assez logique, bien qu’accidentée et parfois sinueuse.
Vos romans se fondent sur la tension du désir. Vous le faites d’ailleurs dire à l’un de vos personnages[3]. Pourtant, que ce soit Graziella Vaci dans La méthode Stanislavski, ou par exemple Clamence dans Matricule[4], tous ces personnages semblent montrer que ce désir là manque de chair aujourd’hui, est ensablé par l’orgueil, donne, comme une porte sur le néant, sur la vacuité, le vide d’une époque qui ne sait plus poser, orienter, maîtriser son désir. Est-ce une vision désenchantée de l’amour des corps, et du désir des êtres, ou une nouvelle vision du désir féminin et masculin ?
Je ne crois pas que ce soit une question d’époque. Le désir est toujours ensablé par l’orgueil, l’amour-propre, et s’ouvre effectivement sur un grand vide, puisque de l’autre qu’on désire, on ignore quasiment tout : la vie de l’autre, même le plus proche, est toujours une fiction que l’on s’invente à partir de quelques éléments interprétables à merci. Pour ça, je crois que les hommes et les femmes sont assez équitablement servis. Le désir est toujours désir du désir de l’autre. Quelque chose en effet de très « auto-centré », puisque l’autre nous échappe en permanence : la seule prise que nous avons sur lui, c’est notre propre fantasme. La seule rencontre possible est la chair. Et le désir a quelque chose de dérisoire lorsque cette rencontre n’a pas lieu. En même temps, un désir vain a quelque chose d’analytique, de presque métaphysique. Parce qu’il éclaire notre rapport à l’existence, il nous renseigne sur nous-mêmes. Je ne conçois pas le désir comme une altérité, mais comme une manière d’être au monde.
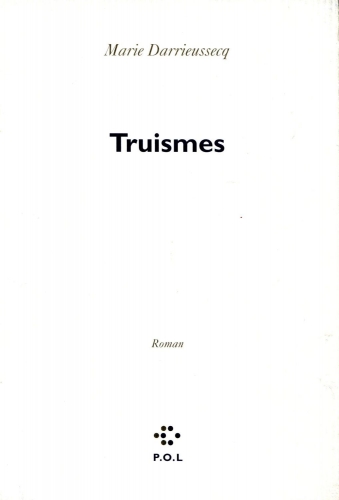 À l’instant, je parlais de désir féminin et masculin, mais cette ligne de frontière pourrait sembler au lecteur attentif d’autant moins pertinente que dans Viande, votre héroïne se voit un pénis pousser dans son sexe. Dans le même esprit que le roman Truisme[5] de Marie Darrieussecq, où l’héroïne se transforme en truie, devenant malgré elle « humanimal », votre personnage principal ne devient pas androgyne mais femme-garçon. Quelle est l’idée derrière cela ? Que l’époque ne dresse plus de frontières ? Que l’appartenance à une identité, une vie, un corps précis est devenue de nos jours une idée vieillotte, rétrécie ?
À l’instant, je parlais de désir féminin et masculin, mais cette ligne de frontière pourrait sembler au lecteur attentif d’autant moins pertinente que dans Viande, votre héroïne se voit un pénis pousser dans son sexe. Dans le même esprit que le roman Truisme[5] de Marie Darrieussecq, où l’héroïne se transforme en truie, devenant malgré elle « humanimal », votre personnage principal ne devient pas androgyne mais femme-garçon. Quelle est l’idée derrière cela ? Que l’époque ne dresse plus de frontières ? Que l’appartenance à une identité, une vie, un corps précis est devenue de nos jours une idée vieillotte, rétrécie ?
Dans Viande, Suzanne devient une fille avec un sexe d’homme. La dernière phrase du livre c’est : « je suis une fille ». Elle expérimente par là le désir masculin, un désir prédateur, et elle va jusqu’au viol, finalement la seule chose qui soit strictement impossible à une femme (je sais que ce point est aujourd’hui contesté, mais je n’en démords pas, littéralement une femme ne peut pas pénétrer de force un corps). Là encore ce n’est pas une question d’époque : la seule chose qui a changé, c’est qu’aujourd’hui je peux écrire ce livre et qu’il peut être publié, même en suscitant une levée de boucliers. Viande parle du rapport homme-femme comme d’un rapport sujet-objet. Pour avoir la parole, et même le dernier mot, bref pour être un sujet pensant agissant et s’exprimant, la femme doit s’approprier une part de virilité. Elle y goûte, fiévreusement, jusqu’à l’abus de pouvoir, mais dans le livre cette expérience, cette métamorphose fait suite à la mort de l’homme aimé : la femme qui parle, c’est un être qui a renoncé à se voir dans les yeux de l’autre, qui a renoncé à être l’objet d’un homme. Et parler ne la rend pas forcément plus heureuse. Ca donne juste un peu de sens à son existence. Jusqu’au vertige.
La violence érotique des rapports humains est un peu moins présente dans votre nouveau roman, mais ne vous semble-t-elle pas surfaite cette violence ? Car après tout, l’amour moderne reste un amour autocentré, un glissement incessant entre-soi et soi, non ? La seule violence que l’on pourrait alors y lire, ce serait peut-être une violence contre soi-même, incapable que nous sommes, la nouvelle génération, à nous décentrer, à aller vers l’autre. Clémence et Joseph dans Matricule : l’une se résigne après une révolte vaine, l’autre expérimente une sorte de suite de jeux pervers, plus égoïstes les uns que les autres. N’est-ce pas l’ivresse narcissique d’une société qui ne sait plus regarder ailleurs que tout au fond de son nombril ?
Peut-être est-ce une forme de sagesse que d’admettre qu’hors de soi, tout nous échappe. Le nombril de l’autre, on n’y a pas accès. Quand on croit regarder l’autre, c’est encore soi que l’on regarde. Quand on lit un livre, c’est encore soi-même qu’on guette à l’intérieur. C’est peut-être de cette frustration d’altérité que naît cette violence que vous remarquez. Dans Matricule, les rapports de Clémence et Joseph sont ceux du chat et de la souris : elle le désire, lui désire un enfant. Chacun essaie de réduire l’autre à son désir, comme pour préserver son identité propre, ne pas se laisser absorber par l’autre. La venue de l’enfant les mettra d’accord finalement en les absorbant tous les deux, et en les prolongeant à la fois. Ils deviennent des personnages périphériques, l’enfant prend toute la place. Comme si ce renoncement à persévérer chacun dans son identité ne pouvait advenir que par la procréation. Ils n’ont pas accepté de s’effacer pour l’autre, mais pour l’enfant ils y parviennent, ils y sont presque forcés.
Parlons de La méthode Stanislavski : dans ce roman, que ce soit le père de la narratrice - qui est d’ailleurs romancière !-, le séjour à la villa Médicis, son propre physique qu’elle décrit avec minutie et qui ressemble étrangement au vôtre, ou toutes les anecdotes, cela semble tenir de votre propre vie. Vous faites même référence à Serge Doubrovsky, qui est passé maître dans l’autofiction – autofiction qui n’est pas de l’autobiographie, rappelons-le, mais un récit fictionnel fondé sur des événements et de faits strictement réels. Serge Doubrovsky dit d’ailleurs de l’autofiction, que c’est confier le langage d'une aventure à l'aventure d'un langage en liberté. Pourquoi cette référence-là à l’autofiction ? Car de fait, cette réalité, qui dépasse la fiction, et dont vous dressez une critique intéressante dans votre livre[6], serait par elle seule, un peu tarte à la crème ? Y a-t-il quelque chose qui se cache derrière ?
Ce qui se cache derrière, c’est Stanislavski, le système stanislavskien qui propose à l’acteur de fouiller sa mémoire affective pour nourrir son rôle. Cela va bien au-delà d’une méthode de jeu : c’est une métaphore de l’art tout entier, y compris de l’écriture. Pour fabriquer une œuvre, c’est en soi qu’on trouve la matière. Le principe du re-vivre de Stanislavski rejoint la madeleine de Proust. Par le biais du stimulus sensoriel (le goût de la madeleine, un air de musique, la sensation d’un vêtement sur soi…) on retrouve un souvenir précis, une émotion, un affect, et on parvient à le restituer, le re-vivre littéralement, au moment de la production artistique, écriture, jeu théâtral, etc. Il y a donc dans l’œuvre cette part de vérité intime et universelle qui lui donne tout son relief, sa densité, son sens même. L’œuvre n’a de sens que si son créateur prend un risque, le risque de s’y perdre, de s’y donner tout entier, de s’y sacrifier. La Méthode Stanislavski n’est pas à proprement parler une autofiction, puisque les faits qui y sont racontés ne sont pas strictement réels et que l’héroïne n’est pas moi. Ce serait plutôt une mise en roman du système autofictionnel. La réalité ne dépasse pas la fiction, elle naît par la fiction. On a dans le roman cet aller-retour du réel au réel par le biais de la fiction : un fait-divers (réel, trivial, l’épisode du tueur des trains) inspire une fiction (la pièce de théâtre qu’écrit Graziella Vaci), et la fiction suscite une réalité nouvelle, tout aussi triviale et cruelle que la première (la disparition de l’actrice). Ce n’est pas une dénonciation mais un constat : l’art n’est pas une chose innocente, ses implications dans la vie sont incertaines, hasardeuses, dangereuses. Et c’est ce qui fait toute sa valeur.

L'écrivain Serge Doubrovsky
Votre narratrice dresse un panorama du microcosme éditorial, panorama qui ressemble à une critique sans concession. Prenant comme cadre, la « fête » du livre qui se déroule dans la ville de Nice, d’où vous êtes originaire, elle décrit avec un détail et une minutie de chirurgien, la grande comédie de l’édition, les gros vendeurs et les autres, les écrivains « municipaux » dont un est largement reconnaissable, pour au final, dresser un bilan qui semble des plus pessimistes[7]. La critique du microcosme n’est non plus d’une originalité en littérature aujourd’hui, mais ce qui est, je pense, innovant sous votre plume, c’est cette analyse que vous faîtes du lecteur qui ne semble plus beaucoup trouver d’intérêt pour l’écrivain : « Les badauds se déplaçaient par vagues successives, presque mécaniquement, ne jetant qu’un œil pressé aux étals de livres. »[8] Est-ce pour vous le signe de la fin d’une époque ? Voire l’entrée dans ce que Richard Millet appelle « l'ère du post-littéraire » ? Et cela n’en serait alors que l’une des conséquences…
On est bien obligé de constater que le livre n’a plus la même place qu’il y a cinquante ans. Graziella dit aussi que si l’on veut être respecté par ses voisins, il vaut mieux être une héroïne de télé-réalité qu’une romancière. Et c’est l’évidence : le livre ne s’inscrit pas bien dans cette dynamique consumériste que nous vivons actuellement, parce qu’il est trop long, trop complexe, trop ambitieux. Le roman, en particulier, est un concept de plus en plus difficile à défendre. Les livres qui se vendent le mieux sont des témoignages, qui ne livrent qu’une réalité brute. L’ultime légitimité de l’auteur, c’est d’avoir vécu ce qu’il raconte. Hors de l’expérience, point de salut. C’est aussi une des implications de La Méthode Stanislavski : il y a plusieurs manières de s’en sortir avec le réel, soit on le recrache tel quel, soit on en fait quelque chose, on le transforme, dans le meilleur des cas on le transcende, on l’abandonne à l’aventure du langage, et c’est ce que fait Doubrovsky par exemple, mais cette deuxième option – la littérature - ne fait plus recette. Les livres sont de plus en plus débarrassés de littérature, comme si c’était une ornementation subsidiaire, encombrante. Le livre tend à devenir quelque chose de simple, d’immédiat.
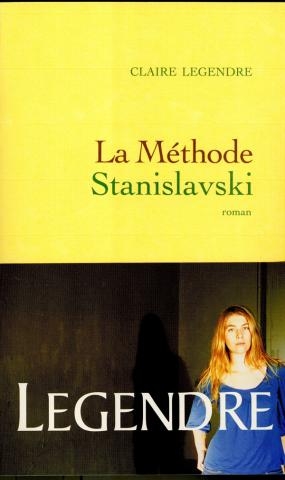 Le personnage de La méthode Stanislavski est une jeune romancière reçue à la villa Médicis, et qui se passionne pour un tueur en série qui sévit dans les trains. À ce propos, vous faites dire à votre narratrice, à propos d’elle-même, analysant ce drôle de passe-temps : « misérable petite idiote exilée dans un château si ennuyeux qu’il m’avait fallu combler mon vide avec l’image d’un assassin. »[9] Loin d’être futile ou d’un intérêt moyen, il me semble que cette réflexion interpelle le lecteur à propos de la jeunesse actuelle, du vide que lui offre la société, de sa propre vacuité. Est-ce pour vous l’idée que nous sommes désormais sans espoir de transcendance ? Qu’hormis l’ivresse narcissique et vaine de toute petite entreprise, nous sommes, tel que le dit Chuck Palahniuk dans son brillant Fight club[10] : « les enfants oubliés de l’Histoire, élevés par la télévision dans la croyance qu’un jour on sera tous millionnaires, stars du rock ou du cinéma » alors que bien évidemment, rien de tout cela ne nous arrivera jamais. Et que, par conséquent, exilé dans un château de rêve, il ne nous reste plus qu’à nous passionner pour quelques futilités sans substance.
Le personnage de La méthode Stanislavski est une jeune romancière reçue à la villa Médicis, et qui se passionne pour un tueur en série qui sévit dans les trains. À ce propos, vous faites dire à votre narratrice, à propos d’elle-même, analysant ce drôle de passe-temps : « misérable petite idiote exilée dans un château si ennuyeux qu’il m’avait fallu combler mon vide avec l’image d’un assassin. »[9] Loin d’être futile ou d’un intérêt moyen, il me semble que cette réflexion interpelle le lecteur à propos de la jeunesse actuelle, du vide que lui offre la société, de sa propre vacuité. Est-ce pour vous l’idée que nous sommes désormais sans espoir de transcendance ? Qu’hormis l’ivresse narcissique et vaine de toute petite entreprise, nous sommes, tel que le dit Chuck Palahniuk dans son brillant Fight club[10] : « les enfants oubliés de l’Histoire, élevés par la télévision dans la croyance qu’un jour on sera tous millionnaires, stars du rock ou du cinéma » alors que bien évidemment, rien de tout cela ne nous arrivera jamais. Et que, par conséquent, exilé dans un château de rêve, il ne nous reste plus qu’à nous passionner pour quelques futilités sans substance.
Il y a cette dimension dans le livre, ce désoeuvrement typique de l’athéisme, qui pousse au crime ou au suicide, comme dans certains films de Michael Haneke, par exemple Benny’s Video ou Le septième continent. L’écriture alors a quelque chose du divertissement pascalien : agir pour fuir le questionnement existentiel. Mais aussi faire quelque chose – de l’art – pour donner un sens à une existence qui en est a priori dépourvue. Il me semble que cela est arrivé en littérature avec le théâtre de l’Absurde, juste après Camus et l’existentialisme. Ce n’est pas nouveau. Ce qui l’est peut-être, c’est cette mythologie moderne qui fait du meurtrier une sorte de rock-star ou d’archétype des marges. Une incarnation du désenchantement. Koltès l’a montré dans Roberto Zucco. Le criminel est une sorte de métonymie du désespoir sociétal.
Cependant, cette phrase du roman que vous citez recouvre une réalité beaucoup plus tangible, c’est celle de l’écrivain : la Villa Médicis est une tour d’ivoire, au sens plein. On y est hors de la vie, pour créer ; il y a encore ce préjugé académique qui veut qu’on ne puisse créer que hors du monde, et cet exil fait partie du contrat. Or l’écriture – la mienne en tout cas – est forcément en prise sur le monde. L’obsession de la romancière pour le tueur en série répond à cette nécessité de réalité triviale, de contact avec le monde, son rythme, sa vie. Le crime est bien plus qu’une futilité sans substance, c’est le réel, le danger, l’horreur du monde dont précisément l’artiste est absent lorsqu’il est à Rome, entre quatre murs baroques, dans un quotidien « muséographique »

Constantin Stanislavski, par Valentin Serov
Vous basez votre roman sur une histoire de tueur en série inspirée d’une histoire vraie, et qui vous a réellement passionné à l’époque où un vrai tueur sévissait dans un train qui reliait la France à l’Italie –vous en parlez dans votre journal en ligne[11]. Cela peut se raccrocher sans mal à l’idée d’autofiction que nous avons développée tout à l’heure. Mais l’insistance dont vous faîtes montre autour de la psychologie du tueur, de la question de ce type de criminalité, semble nous dire, que l’idée même du serial killer a, dans ce roman, bien d’autres résonances que le seul cadre de l’autofiction. Je me trompe ?
J’étais à Rome en 1999-2000, au moment précis où l’on recherchait Sid Ahmed Rezala, dans tous les trains d’Europe, et il se trouve que je prenais souvent le train, pour rejoindre ma famille à Nice. Il y a 10 heures de voyage entre Rome et Nice. J’ai effectivement beaucoup pensé à ce risque, cette rencontre. On nous arrêtait à Vintimille pour des contrôles d’identité, il y avait une tension perceptible parmi les passagers. De plus, Rezala avait exactement le même âge que moi, à trois semaines près, il vivait dans le sud de la France, ce qui me le rendait presque familier. Je correspondais trait pour trait au profil des victimes –jeune femme, étudiante, voyageant seule, etc. Je n’ai pas choisi par hasard d’écrire sur Rezala. Cette histoire m’a poursuivie assez longtemps. Elle n’est pas emblématique des serial-killers en général. Rezala a éprouvé des remords, ce qui est extrêmement rare dans ce genre d’affaires. Et il s’est suicidé en prison. Les quelques déclarations qu’il a faites depuis sa prison le rendaient assez pathétique, par rapport à la monstruosité des crimes. Le principe de La Méthode n’était pas de l’humaniser, mais d’essayer de comprendre le mécanisme qui fait qu’on s’empare d’une personne véritable pour en faire un personnage, comment il devient l’emblème, le symptôme d’un malaise sociétal, ce mythe moderne dont je parlais tout à l’heure. Le personnage ne peut naître que lorsque le tueur est hors d’état de nuire (j’ai commencé à écrire le jour de son arrestation, le 11 janvier 2000, et le roman est sorti six ans après jour pour jour). Je me suis ensuite beaucoup documentée sur le crime sériel, j’ai invité Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, à la Villa Médicis, il était capital que le personnage devienne un objet d’étude, peut-être pour ne pas le confondre avec la personne véritable, pour établir cette frontière. Dès lors que le danger a disparu, la psychose laisse place au fantasme, à la fiction, à l’écriture.
Bien évidemment, la question du tueur en série entraîne votre roman sur la pente du roman policier. Certes, vous allez me dire que votre premier opus était, pour sa part, un polar, exploitant les ficelles et les techniques du genre, même si, pour Making of, c’était un peu plus compliqué que cela. Pour celui-ci, l’intrigue policière ne semble être qu’un vague prétexte à la construction d’une autre intrigue, plus diluée, plus sous-jacente. Cette intrigue est celle de la réalité… réalité que vous dénoncez à partir de votre référence au célèbre réformateur du jeu théâtral Constantin Stanislavski. Cela semble être là également au service d’une démarche beaucoup plus littéraire. Êtes-vous d’accord ?
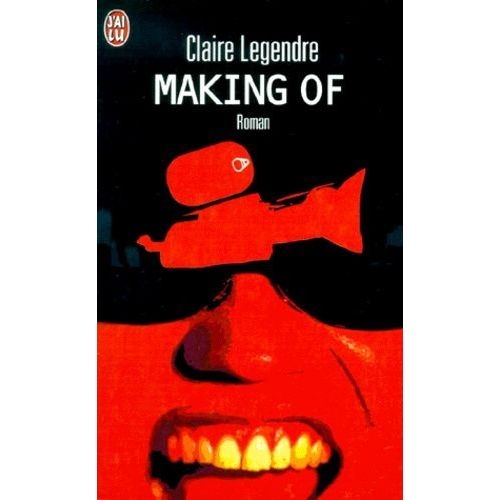 A l’époque de Making-of, je n’avais aucune culture policière, ce qui m’a permis d’écrire un polar complètement désinhibé, en jouant avec les codes, la narration, les personnages, les voix. Je suis partie du principe qu’il n’y avait pas une vérité, mais plusieurs subjectivités, et chaque personnage dévoilait sa version des faits, avec une voix, un point de vue singulier. J’ai construit ce roman comme un puzzle, en m’amusant beaucoup. C’est d’ailleurs le point commun le plus évident avec La Méthode Stanislavski : l’aspect ludique de la construction du livre. Pour ce dernier roman, j’ai lu énormément de polars, mais d’un genre bien particulier, en les choisissant spécialement pour leur univers, leur ambiance et leur construction. Je suis partie de Ben Hecht Je hais les acteurs, puis Christopher Isherwood, après quoi j’ai découvert Ngaio Marsh, dont la plupart des romans se déroulent dans le milieu du théâtre, et ensuite je suis allée voir du côté de Anne Perry, et enfin, pour l’architecture classique, les ficelles, Patricia Wentworth. J’ai passé deux ou trois ans avec ces auteurs. La gageure était pour moi de produire une construction classique, du moins en apparence, avec une narration linéaire, portée par la seule voix de mon héroïne. Je n’avais jamais atteint cette simplicité, et elle me semblait nécessaire si je voulais faire passer toute la machine théâtrale (et théorique) qui tient le roman. Il fallait que le récit soit simple, très abordable, pour que le principe de cet aller-retour entre réel et fiction puisse s’imposer, de manière subreptice, entre les lignes du polar.
A l’époque de Making-of, je n’avais aucune culture policière, ce qui m’a permis d’écrire un polar complètement désinhibé, en jouant avec les codes, la narration, les personnages, les voix. Je suis partie du principe qu’il n’y avait pas une vérité, mais plusieurs subjectivités, et chaque personnage dévoilait sa version des faits, avec une voix, un point de vue singulier. J’ai construit ce roman comme un puzzle, en m’amusant beaucoup. C’est d’ailleurs le point commun le plus évident avec La Méthode Stanislavski : l’aspect ludique de la construction du livre. Pour ce dernier roman, j’ai lu énormément de polars, mais d’un genre bien particulier, en les choisissant spécialement pour leur univers, leur ambiance et leur construction. Je suis partie de Ben Hecht Je hais les acteurs, puis Christopher Isherwood, après quoi j’ai découvert Ngaio Marsh, dont la plupart des romans se déroulent dans le milieu du théâtre, et ensuite je suis allée voir du côté de Anne Perry, et enfin, pour l’architecture classique, les ficelles, Patricia Wentworth. J’ai passé deux ou trois ans avec ces auteurs. La gageure était pour moi de produire une construction classique, du moins en apparence, avec une narration linéaire, portée par la seule voix de mon héroïne. Je n’avais jamais atteint cette simplicité, et elle me semblait nécessaire si je voulais faire passer toute la machine théâtrale (et théorique) qui tient le roman. Il fallait que le récit soit simple, très abordable, pour que le principe de cet aller-retour entre réel et fiction puisse s’imposer, de manière subreptice, entre les lignes du polar.
Revenons une dernière fois sur la littérature. Vous êtes romancière. Je pense que c’est ce qui vous pousse à dénoncer – à juste titre ! - dans ce roman, l'inflation de livres en librairie qui correspond à la suite logique de cette grave dérive démocratique qui installe dans l'esprit des gens l'idée que chacun peut écrire et même doit écrire. Selon vous, la littérature française a-t-elle encore un avenir ? Et que faudrait-il à la littérature du XXIème siècle.
Je pense qu’il faut d’abord rétablir la frontière entre littérature et industrie du livre. Une infime partie de l’édition actuelle est consacrée au roman, et je ne parle même pas du théâtre ou de la poésie. Si on écrit pour faire un best-seller, alors on ne fait pas de littérature. C’est juste une évidence. Ca ne m’empêche pas d’avoir envie d’être lue ; ça veut juste dire que je ne suis pas prête à faire des concessions à la démagogie et au consensus. Pour ce qui est de la démocratisation de l’écriture, il me semble que c’est plutôt une bonne chose, et le phénomène des blogs montre que le besoin de se raconter par écrit ne passe pas nécessairement par le livre. La littérature, c’est autre chose, une langue, un projet idéologique et esthétique qui s’accommode mal de la consommation et des lois du marché.

Claire Legendre
 Cet article est paru pour la première fois dans la revue La Presse Littéraire n°5 d'avril 2006.
Cet article est paru pour la première fois dans la revue La Presse Littéraire n°5 d'avril 2006.
En couverture : Claire Legendre, PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE
[2] Grasset, 1999.
[3] « Ce qui est intéressant, tu me l’as dit, c’est la « tension du désir » », La méthode Stanislavski, p.129.
[4] Grasset, 2003.
[5] POL, 1996.
[6] Ibid, p. 186.
[7] Ibid, pp.215-216.
[8] Ibid. p.217.
[9] Ibid. p. 112.
[10] Folio-SF.
[11] http://www.clairelegendre.net
Commentaires
Le désir mascuin n'est PAS un désir prédateur. C'est même le contraire. Autant dire que ça parait inconcevable.
C'est le soi-disant pouvoir (à la con) que nombres de crétins célèbres associent au pénis (à la con) qui est en cause. Lacan fait ce qu'il veut du sien mais le mien je le garde.
Je vais devenir masculiniste si ça continue ;-))))=
PS : je ne me suis jamais reconnu dans le regard que porte Benoite Groult sur les hommes. Si quelqu'un peut m'éclairer...
Qui parmi les hommes pense de son désir qu'il n'est pas prédateur ? Il y en a dans la salle. Qu'ils se dénoncent, sinon je punis la classe !
Prédateur ou non, il n'y a hélas pas les bons d'un coté et les méchants de l'autre, les vieux et les jeunes, les violeurs et les amoureuses transies (et enfin les riches et les pauvres): Il y a surtout des gros pourceaux incultes qui font la loi dans le milieu de l'édition en diffusant des livres pareils bourrés d'énaurmes poncifs finalement assez peu intéressants...
Dans le genre d'ailleurs je note qu'il y a aussi Boris Bergman & beaucoup d'autres, et c'est pourquoi on peut comprendre l'irritation de Gabriel.
c'est vrai que ça craint ce bouquin pour écrire il faut déja avoir qqchose à partager et là on voit pas comment, on s'en fout juste totalement.
P.S.: et sinon nous on a pas été édité (ou alors en tout cas pas en France), rassurez-vous.
en s'ils aiment ça moi j'ai rien contre: de tte façon il n'y a un peu que ça, et pour un moment!! -et bien sûr ça ne veut pas dire que j'oublierais.