Entretien avec Santiago Espinosa. Clément Rosset, philosophe du réel et du tragique

Le philosophe Clément Rosset nous a quitté le 27 mars 2018 à son domicile parisien. Aussi, il nous laisse une œuvre considérable, souvent mal comprise, dont les grands thèmes sont le tragique, le désir, le réel et la joie. Son disciple, Santiago Espinosa a publié récemment la première étude sur cette philosophie singulière, aux éditions des PUF. C’était l’occasion de le rencontrer. Cet entretien est paru dans le site du mensuel Entreprendre et dans le numéro 32 de Question de Philo. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
Pour mémoire : Le réel selon Clément Rosset
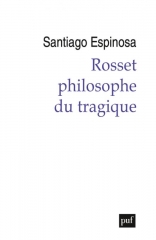 Marc Alpozzo : Vous êtes à la fois le fils spirituel de Clément Rosset et son légataire testamentaire. Comment cela est-il arrivé ?
Marc Alpozzo : Vous êtes à la fois le fils spirituel de Clément Rosset et son légataire testamentaire. Comment cela est-il arrivé ?
Santiago Espinosa : J’ai commencé mes études de philosophie au Mexique, où une professeure eut l’étrange idée de nous faire étudier Le Réel et son double (Gallimard, 1976), dans une très mauvaise traduction par ailleurs (je l’ai retraduit moi-même par la suite). Je ne sais trop ce que j’en ai compris à l’époque. Je préparais alors un mémoire sur la musique de Schopenhauer, qui fut publié plus tard[1], ce qui m’a amené à lire ce que Rosset avait écrit sur lui. De fil en aiguille, j’ai lu tout ce qu’il avait écrit jusque alors, au début des années 2000, et j’ai décidé de venir en France pour faire un doctorat avec la vague idée qu’il me dirigerait (j’ignorais qu’il était déjà à la retraite et qu’il fuyait tant qu’il pouvait le milieu universitaire). Quand j’ai traduit L’objet singulier (Minuit, 1979), j’ai eu la bonne idée d’en envoyer à Rosset le tapuscrit via les Éditions de Minuit — je savais qu’il lisait l’espagnol — pour qu’il me donne son avis, occasion de faire avec lui un entretien sur mon objet de thèse, la musique encore une fois[2].
Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons bu une bouteille du champagne pendant qu’il me posait des questions à propos de tout, sauf de ma thèse, et nous sommes allés dîner ensuite, sans toujours aborder mon travail de thèse. Nous nous sommes donc revus la semaine suivante, puis celle après, et celle d’encore après, et ainsi de suite pendant une douzaine d’années. Nous sommes devenus très amis, nous avons fait des voyages, des séjours à Majorque. J’étais devenu une sorte de secrétaire, je rédigeai certains articles qu’on lui demandait, je tapai ses livres ; de son côté, il lisait tout ce que j’écrivais, m’aida à préparer l’agrégation… il a même remis les pieds à l’Université pour siéger au jury lors de ma soutenance de thèse ! C’était une relation très complexe, à la fois très amicale, professionnelle (il m’a désigné comme légataire de son œuvre), mais aussi d’une certaine manière filiale.
M. A. : Comment peut-on définir le réel selon Clément Rosset ? C’est un réel très particulier, n’est-ce pas ? Personne ne semble le comprendre.
s. E. : C’est un peu la raison d’être de ce livre (Rosset, philosophe du tragique, PUF, 2023), que je n’avais pas l’intention d’écrire au départ. Certes, je me compte au nombre des disciples de Rosset, mais je ne me considère pas comme un « spécialiste » de son œuvre, ayant mes propres intérêts et projets personnels d’écriture. Surtout, il me semblait que ses livres étaient suffisamment clairs, qu’ils ne réclamaient aucune explication, que tout le monde pouvait comprendre ce que Rosset entend par réel dès lors qu’on ouvre un de ses livres et on prend la peine de le lire avec attention. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence que beaucoup de gens qui se recommandaient de Rosset, qui exprimaient ouvertement combien ils étaient inspirés par son œuvre, par sa notion du réel, sa critique du double, son éloge de la joie, ne comprenaient paradoxalement pas du tout, à mon sens, ces concepts, et faisaient d’énormes contresens à leur égard. On prenait le réel pour l’actualité (en particulier politique), la société, ou encore les petits faits du quotidien. Bien sûr, tout cela fait partie du réel, mais ce concept est éminemment philosophique : il désigne la totalité de ce qui existe, par opposition à ce qui n’existe pas, comme chez Parménide. L’objet de la philosophie est en effet cette totalité, qu’on l’appelle « réel », « être », « univers », ou autre. C’est cet objet problématique qui occupe le philosophe, et c’est à cela seul qu’on le reconnaît, justement. Le concept de réel chez Rosset se définit donc par opposition aux illusions, aux fantasmes des hommes, ce que va désigner le concept de « double » dans celui que Rosset considérait son grand livre, Le Réel et son double.

SANTIAGO ESPINOSA , CLÉMENT ROSSET
L'Inexpressif musical Suivi de Question sans réponse
Paru en 2013
M. A. : Précisément, vous dites dans votre livre que l’on a systématiquement ramené le réel de Rosset à d’autres auteurs, considérant que ce concept n’était pas très original, et que son originalité a été incomprise.
S. E. : Ce qui est très original chez Rosset, ce n’est pas tant le concept de réel, qui recouvre comme je l’ai dit l’ensemble de ce qui existe, puisque encore une fois c’est là l’objet même de la réflexion philosophique. Certes, le réel chez Rosset ne désigne pas la même chose que l’Être chez Heidegger, et tout d’abord parce que chez lui ce dernier est double (l’Être différant à tout jamais de l’étant, de ce qui est, paradoxalement) ; mais, précisément, un philosophe à proprement parler est un penseur avec une conception particulière de cet ensemble d’objets qu’on appelle réalité, une « ontologie », si vous préférez, et chez Rosset cet ensemble est tout ce à quoi il arrive d’être présent, d’où il faut conclure que le réel n’est pas, comme l’Être de la métaphysique, « ce qui se conserve, mais ce qui à chaque instant est présent », ce qui change donc. Le réel est ce qui existe, mais ce qui existe n’existe pas pour longtemps. C’est pourquoi il est tragique, et aussi pourquoi nous ne parvenons pas à nous y habituer. Or ce qui me paraît être la véritable originalité de Rosset, ce qu’on ne trouve pas chez d’autres philosophes, c’est cette trouvaille du double : cette idée qu’on ne peut échapper à la réalité, encore qu’on croie — et c’est cette croyance elle-même qui constitue l’illusion du double — penser à des réalités alternatives. Une réalité « autre » est au fond impensable, et l’illusion consiste justement à croire qu’on y pense alors que cette pseudo-pensée n’est rien qu’un refus affectif du seul réel pensable, celui qui est. Mais, là encore, on fait de gros contresens à propos de ce concept de double, qu’on confond souvent avec les arrières-mondes de Nietzsche, les idéals de Platon, etc. Ce n’est pas ça du tout. L’essentiel du double, chez Rosset, c’est ce caractère illusoire qui nous fait croire qu’on a pensé ou perçu quelque chose là où il n’y a ni pensée ni perception (on peut dire, au contraire, que le monde intelligible de Platon est fictif, mais il est tout de même pensé, et sans doute uniquement pensé).
M. A. : Peut-on dire que le double est une sorte d’ailleurs pour celui qui désire fuir le lieu où il ne se sent pas à l’aise ?
S. E. : C’est tout à fait cela. Je cite à ce propos un passage de Fernando Pessoa, dans Le Livre de l’intranquillité, qui écrit que la rive d’en face est toujours ailleurs, et que c’est là la source de toutes ses « souffrances ». Ce qui fait que le romantique, par exemple, souffre, c’est que l’ailleurs ne soit jamais ici. Car Pessoa peut toujours traverser la rivière pour se trouver en face, faisant que la rive qu’il a quittée se retrouve de nouveau ailleurs, et ainsi à l’infini. Pessoa est donc sûr de toujours souffrir, moins de n’être pas dans un ailleurs qu’il a pourtant à portée de vue, que d’être toujours ici. Or, ceci étant dit, on pourrait prétendre que Pessoa voit tout de même quelque chose — l’autre rive —, alors que dans l’illusion on ne voit justement rien. Il faudrait plutôt associer le double à l’ailleurs tel que le conçoit Baudelaire : « Anywhere out of the world», puisque ce « n’importe où hors du monde » désigne, non pas un « autre monde », mais un « monde autre », un réel autre, lequel se révèle à l’analyse n’être rien du tout, pas même dans la pensée. Baudelaire est ainsi l’exemple type de l’illusionné au sens de Rosset : s’il veut un monde autre, c’est qu’il croit — et c’est cette même volonté qui motive en amont la croyance — qu’il trouvera là, enfin, un objet de désir. Mais quel est donc ce monde autre ? Personne ne le sait, à commencer par Baudelaire. Et qu’est-ce qu’on y trouvera ? Là encore, personne ne le sait. Ce monde autre n’est évidemment rien que la négation de ce monde-ci. Or, dès ses premiers livres, Rosset avait en en vue cette intuition, qu’il précisa peu à peu : lorsqu’on oppose — comme le fait par exemple la morale — une réalité autre, réputée meilleure, à la réalité qui existe, tragique, ce n’est pas parce qu’on a une idée précise de cette autre réalité, mais c’est uniquement qu’on rejette affectivement la réalité immédiate. C’est parce que l’affectivité humaine se trouve insatisfaite, parce que l’homme n’est pas heureux, pour le dire clairement, qu’on conçoit l’idée hallucinatoire que cela n’est pas normal, qu’on devait au contraire l’être, et qu’alors quelque chose a dû mal tourner, que le réel qui devait être n’est finalement pas advenu, le réel qui est étant ainsi le double défectueux de celui qui n’est pas. C’est donc l’idée que le malheur de l’homme est une anomalie qui se trouve à l’origine de l’illusion. Comme si l’on avait promis à l’homme le bonheur et que quelqu’un avait brouillé les cartes et lui avait substitué le tragique — voilà qui explique la sempiternelle recherche de la morale des coupables. Qui donc est responsable de la malversation ? Cela fait deux mille quatre-cents ans qu’on croit enfin tenir le coupable (les méchants, les riches, l’étranger…) et le bonheur n’arrive toujours pas. C’est ce que montre l’exemple d’Œdipe dans le Réel et son double. Œdipe croit qu’il a été trompé, qu’il y a eu une ruse, que quelque chose est arrivé à la place de quelque chose d’autre. De même nous : puisque le tragique est là, on conclut qu’il a pris la place du bonheur ; que ce dernier est resté dans l’autre monde, dans le possible qui ne s’est pas réalisé. On voit bien que cela n’est pas la pensée d’une réalité autre, mais plutôt de cette même réalité dont on se contente de soustraire tout ce qui ne répond pas à nos exigences affectives.
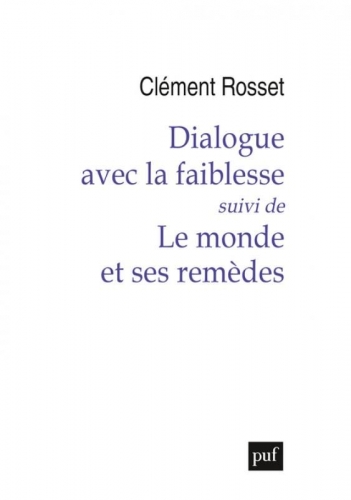
Texte inédit de Clément Rosset paru en 2023 chez PUF
M. A. : Dans sa jeunesse, Clément Rosset a pris appui sur deux grands philosophes, Nietzsche et Schopenhauer. Est-ce que ce désir de se hisser dans un arrière-monde ne relève pas de cette volonté désirante qui aurait dû comprendre que l’état contemplatif est la seule source de bonheur, d’où Le Monde et ses remèdes (PUF, 2023) ? On veut vivre selon ses désirs mais ils ne correspondent pas toujours à la réalité.
S. E. : Je dirai que Rosset est bel et bien un philosophe du désir, comme Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, plutôt qu’un philosophe de l’être. Le réel est ce qui est donné, tel un mur, un « mur du donné », lit-on justement dans Le Monde et ses remèdes (PUF, 1964/2023), puisque non modifiable, s’imposant à la conscience et désamorçant par là même le désir. Mais il y a une différence essentielle entre la conception que se fait Rosset du désir et celle que s’en fait Schopenhauer, puisque pour Rosset — comme pour Spinoza et Nietzsche, et au contraire de Schopenhauer et Freud, par exemple — le désir n’est pas une marque de souffrance ou de privation. Le malheur de l’homme ne vient pas de l’absence de satisfaction du désir, mais plutôt de son incapacité à désirer quelque chose. Ce n’est pas le fait d’obtenir l’objet convoité qui rend joyeux, mais c’est plutôt le fait de désirer quelque objet réel que ce soit, puisque cela exprime l’adhésion à une existence qui nous est précisément imposée. Voilà pourquoi les concepts de bonheur et de joie s’opposent diamétralement : on entend par bonheur une satisfaction totale, ou du moins partiale, de nos désirs, ce que le tragique interdit d’emblée — à commencer par le désir de vivre —, alors que la joie, qui révèle l’adhésion au tragique, n’est pas annihilée par le savoir préalable de l’insatisfaction fondamentale de l’affectivité humaine. En ce sens, dit Rosset dans La Force majeure (Minuit, 1983), la joie est éminemment folle, irrationnelle, voire miraculeuse, telle une « grâce » : il est impossible d’en rendre compte rationnellement. En effet, la conscience du tragique devrait logiquement conduire au pessimisme ; et cependant la joie de participer à l’existence, existence dont on a reconnu le caractère à jamais indigeste, est là malgré tout. D’où la boutade, qui n’en est pas vraiment une, de Rosset, qui résume sa philosophie : « Réjouissez-vous, tout va mal ! ».
M. A. : En effet, le désir chez Rosset est un désir tragique, qui ne sait pas ce qu’il veut. Dans son Schopenhauer, philosophe de l’absurde, (PUF, 1967), qui est son mémoire de maîtrise, me semble-t-il, il montre bien une intuition qui vient avant Camus, que l’absurde du monde découle d’une absence de nécessité du monde. Les choses n’ont aucune nécessité, et c’est sur cette absence de nécessité que va croître la joie.
S. E. : Schopenhauer est un rationaliste déçu. Il aurait bien accepté l’existence si elle avait eu un sens, or elle n’en a pas. Chez Nietzsche, puis Rosset, il n’y a pas cette exigence de rationalité ou de finalité. Ainsi, le manque de signification de l’existence n’est pas assez puissant pour atteindre la joie et l’entamer. Ce qui ne veut pas dire qu’on est joyeux parce que le monde est insensé ou idiot. C’est juste qu’il n’y a aucune raison d’être joyeux, aucune justification, aucune explication. La philosophie de Rosset se présente alors comme une tentative de mettre la joie à l’épreuve. Chaque livre analyse un problème qui aurait pu affaiblir la joie, qui aurait pu révéler chez elle quelque illusion, l’homme joyeux ayant fermé les yeux sur tel ou tel aspect cruel du réel. En ce sens, il faut dire que chaque livre de Rosset est une victoire de la joie, puisqu’il s’agit à chaque fois de montrer que c’est bel et bien sur le réel, sur l’existence tragique, qu’elle porte, et sur rien d’autre qu’elle.
M. A. : Alors, j’aime beaucoup votre livre, parce que c’est avant tout un essai philosophique pour montrer ce qui n’a pas été compris dans la philosophie de Rosset, qui est soit mal compris, soit mal mené, ou bien peu ou mal lu, et lorsqu’il l’est, c’est pour dire qu’il n’est qu’un sous-Nietzsche. En même temps, il a indéniablement un public. Pourquoi tous ces malentendus ?
S. E. : En effet, il est lu, il a un public, mais je pense que c’est plutôt un public de littéraires, d’artistes, pas vraiment de philosophes ou de professeurs de philosophie. Il faut dire que dans les universités françaises on enseigne avant tout la phénoménologie. Dès lors, parler d’une réalité immédiatement sensible et palpable aux prises avec le désir humain, c’est comme parler une langue étrangère aux étudiants, qui ne font que ressasser depuis des décennies le crédo husserlien ou heideggérien. À cela s’ajoute une écriture limpide, sans jargon, ce qui, comme chez Descartes, ne va pas sans poser quelques difficultés. Je crois me souvenir qu’on a pu évoquer, au sujet de l’écriture de Descartes, une « clarté sombre ». Il en va un peu de même chez Rosset. C’est peut-être parce que son écriture est très claire, contrairement à celle de certains de ses contemporains (Derrida par exemple), que le lecteur croit avoir très bien saisi le propos alors qu’il lui a entièrement échappé. Le concept de réel est le premier à n’être pas compris. On pourrait bien sûr dire la même chose du concept de volonté chez Schopenhauer, d’impression chez Hume, de durée chez Bergson, qui sont des concepts phares et souvent les moins bien compris, c’est sans doute inévitable. Toujours est-il que les concepts rossetiens de réel, de double, de joie tragique, sont exactement ceux qui prêtent à confusion. Ajoutons qu’il est devenu de nos jours très difficile de porter un intérêt quelconque à des livres qui ne traitent pas des sujets d’actualité, comme le droit des animaux, l’écologie, l’inclusion des minorités, etc., et surtout qui n’y proposent aucun remède. Ce qu’on reproche à la philosophie de Rosset est qu’elle n’arrange rien, qu’elle ne propose aucune solution aux maux de l’existence. Et pour cause : elle s’acharne bien plutôt à montrer qu’ils sont inhérents à l’existence, et que toute morale qui se vanterait de trouver des solutions n’est qu’un mensonge éhonté. De fait, comme la grande majorité des philosophes sont des moralistes, et que Rosset s’amuse à couper la branche sur laquelle ils sont assis, on comprend qu’ils ne soient pas très contents !

Clément Rosset à la fin de sa vie
M. A. : Clément Rosset est un philosophe précoce. Un des plus précoces que je connaisse. Il débute avec un premier livre à 18 ans, il est encore à Janson de Sailly, puis il écrit au Nouvel Obs, c’est une petite star de l’époque. Il me semble qu’il est arrivé trop tôt, qu’on l’a catalogué au rayon des farceurs, des iconoclastes, avec son « terrorisme en philosophie », venant dynamiter le fond de sérieux de la philosophie. On trouve cependant, à partir du Réel et son double (Gallimard, 1976), un autre Rosset qui alors déconcerte, puisque ses livres ne sont plus des ouvrages systémiques, mais de petits livres qui ne disent rien du réel sinon par touches impressionnistes. N’est-ce pas le fond du problème ? On le prend depuis pour un littéraire et non pour un philosophe.
S. E. : C’est tout à fait possible. Rosset m’a dit d’ailleurs un jour, alors que je lui faisais un éloge de sa Logique du pire (PUF, 1971), dont le bandeau indiquait justement « Du terrorisme en philosophie », qu’il ne l’aimait pas du tout. C’était une première thèse de doctorat qu’il avait faite avec Jankélévitch, qui l’avait trouvé trop courte (au lieu de l’étoffer, Rosset en écrivit une deuxième, L’Anti-nature, PUF, 1973). Il trouvait ce livre lourdingue, mal écrit et difficile car il était encore sous l’influence de Deleuze. Il m’a dit cette phrase littéralement : « À l’époque, je croyais qu’il fallait faire difficile pour être pris au sérieux ». Il s’était par la suite libéré de cette croyance absurde qui pèse encore sur bien d’autres ! Les livres que vous avez cités, puis les inédits parus depuis, jusqu’à La logique du pire, sont des ouvrages écrits par un jeune homme qui parfois se met en colère, qui fait de la philosophie de manière terroriste, raillant les philosophes de la tradition, et qui se prend peut-être un peu trop au sérieux — ce qui n’enlève rien, bien entendu, à leur contenu proprement philosophique. À l’époque, on a dû l’associer aux philosophes à la mode, les déconstructeurs, les archéologues du savoir, etc. Il est vrai qu’il était très proche de Deleuze, qui le citait dans ses livres, vis-à-vis duquel il a pris des distances en 1968. Peut-être a-t-on fini par se rendre compte qu’il s’agissait, chez Rosset, d’un philosophe qui faisait bande à part, qui ne défendait aucune « cause », à part celle d’une réflexion sans concessions sur le réel, et non, encore une fois, sur l’actualité politique, économique ou sociale. Et, en effet, comme vous le dites, après Le Réel et son double, il se contentait de faire de brèves incursions dans tel ou tel aspect du réel, d’en donner quelques impressions fugitives, jugeant sans doute qu’il valait mieux évoquer la réalité par métaphore plutôt que par le langage logique, nécessairement grandiloquent, ce qui l’amenait parfois à trouver plus de philosophie dans un roman ou un album de Tintin, que chez Kant ou Hegel.
M. A. : J’étais à l’Université de Nice, durant les années 1990, et on avait l’impression, à ce moment-là, qu’il faisait paraître des livres de plus en plus courts, et de moins en moins importants. Or, maintenant que cette œuvre est achevée, si j’ose dire, on saisit enfin qu’il fallait attendre le dernier de ses textes, pour comprendre l’ensemble de sa pensée.
S. E. : Oui, chaque livre est comme une chambre dans un petit château, et je vous confesse que j’ai eu la même impression moi-même, commençant ma lecture de l’œuvre de Rosset par les livres gros. Ceux de la seconde période, pour ainsi dire, étaient en effet de plus en plus courts, remplis de citations de surcroît, contenant des passages entiers de telle ou telle pièce, jusqu’au dernier, L’endroit du paradis. Trois études (Les Belles Lettres, 2018) qui fait à peine vingt pages en tout et pour tout. Je sentais parfois que je demeurais un peu sur ma faim. Donc, je suis d’accord. Mais une fois qu’on a compris où il voulait en venir, qu’il avait la ferme volonté de ne traiter qu’un seul problème dans ses livres — ce qui donne cette impression de lire à chaque fois le même livre et en même temps un autre, eadem sed aliter —, les choses s’éclairent. C’est toute la difficulté de son œuvre. Il fait la même chose mais différemment, il revient systématiquement sur le même problème mais pas du même point de vue : « Alors, le double, j’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire ; mais est-ce que l’ombre, l’écho ne sont pas des doubles eux aussi ? » Ou encore : « Le double ne nous permet-il pas, en fin de comptes, de voir un peu la réalité qu’il cherche à cacher ? » Et c’est ce qui explique en partie la multiplication de contresens que font les lecteurs pressés. Chaque livre aborde ainsi un nouvel aspect d’un unique thème, à savoir : la dénonciation des stratégies employées par les hommes pour échapper à une réalité qui leur déplaît.
M. A. : Dernier point : lorsque j’ai connu Clément Rosset, il était en dépression. De celle-ci il a tiré un livre, Route de nuit (Gallimard, 1999). Or, si l’on s’en tient à la philosophie de Rosset, cette dépression est incompréhensible. Un peu comme le suicide de Deleuze. En 1996, à propos de ce suicide, Paul Veyne nous donne une explication : « Sa mort volontaire et raisonnable, au sens que les stoïciens donnaient à ce mot, achève une destinée véritablement philosophique. » Peut-on faire la même chose avec la dépression de Rosset ? Les lecteurs s’interrogent sur ce point. C’est important, il me semble, de leur répondre sur le sujet.
S. E. : Toutes les questions que vous me posez là, je me les suis également posées, habitué que j’étais à une philosophie de la joie, de l’approbation de l’existence telle qu’elle est, du rire exterminateur, je ne comprenais pas que tout d’un coup le grand rieur aille mal. Lorsque je l’ai rencontré en 2007, il n’était pas vraiment dépressif. Assez ivrogne, certes, mais cela n’était pas du tout un effet de la dépression, puisqu’il l’avait toujours été un peu. Je pense que la dépression qu’il fit dans les années 1990 fut assez profonde pour laisser durablement des traces chez lui ; mais Rosset n’a jamais remis en cause son intuition première, celle de la joie. C’est comme s’il s’agissait pour lui de deux domaines qui ne se touchaient par aucun endroit : d’un côté la vie avec ses tracas, ses échecs (amoureux par exemple) inévitables, de l’autre la joie de vivre. C’est tout le paradoxe dont nous avons parlé plus haut. Il a vécu cette dépression comme un désagrément supplémentaire de la vie, comme un rhume qu’on attrape et contre lequel on ne peut rien. Mais ce n’est pas parce qu’on est enrhumé qu’on va trouver que la vie est insupportable, n’est-ce pas ? Au fond, pourquoi, je vous relance la question, le fait d’être dépressif contredirait une adhésion préalable de l’homme à l’existence ? Une dépression n’est peut-être pas tout à fait un « non » au monde… Du reste, on a dit qu’une telle adhésion est en fin de comptes tout à fait illogique.
Entretien avec Santiago Espinosa à propos de son livre "Rosset - Philosophe du tragique"
M. A. : Certes, mais la dépression est tout de même une expression de quelque chose qui a du mal à se dire, donc d’un manque d’approbation au réel.
S. E. : Oui, mais il s’agit d’une dépression complètement circonstancielle, liée à la rupture d’une relation amoureuse qui avait duré plusieurs années. Ce n’était pas bien entendu la première désillusion amoureuse qu’il vivait, et on pourrait aller jusqu’à suggérer que l’intuition du tragique avait pour arrière-fond l’intuition, dans l’adolescence, que l’amour n’est pas une chose simple à trouver et à entretenir. La dépression était la réaction émotionnelle logique à la rupture, alors que la joie véritable n’est nullement liée à telle ou telle circonstance dont on peut se féliciter. C’est même tout le contraire : quel serait le mérite d’une « sagesse » qui ne se réjouit que lorsque tout va bien, et renonce lorsque tout va mal (c’est-à-dire le plus souvent) ?
M. A. : Qu’est-ce que le dernier inédit, que vous venez de faire paraître chez PUF[3], apporte de complémentaires aux autres textes ?
S. E. : Cet écrit me paraît intéressant pour deux raisons : la première est que, écrit en 1961, c’est un livre visionnaire. Rosset a 21 ans, et ce qu’il décrit est exactement ce que nous vivons aujourd’hui, autrement dit un effondrement des « vertus éthiques » de courage, de force, qui permettent à l’homme d’affronter une réalité douloureuse, au nom de je ne sais quelle « bienveillance ». On y trouve une critique de l’éducation, de l’influence du moralisme protestant américain dans tous les domaines de la vie intellectuelle en Europe. Rosset est le seul à ma connaissance à le faire à cette époque ; nous commençons quant à nous seulement à constater les dégâts. C’est très intéressant de lire un garçon de 21 ans qui voit clairement ce qui se prépare, alors que tout le monde s’extasie encore. L’autre bonne raison touche à ce que vous avez dit tout à l’heure, et que l’on croit pouvoir reprocher, mais à tort, à Rosset, à savoir : prétendre que la vision tragique est, ou bien un renoncement à l’action, ou bien une position réactionnaire. En fait, à l’inverse des moralistes qui pensent que puisque le monde va mal on peut et même on doit le transformer, Rosset se recommande d’une éthique consistant à faire face à une réalité qu’on ne peut en aucune façon transformer. C’est cela que le plus grand nombre ne parvient pas à saisir : pourquoi ne pourrait-on pas changer la réalité, après tout ? Il faut répondre que le réel sera toujours réel, quel qu’il soit, comme l’ici de Pessoa : changer de rive nous conduit nécessairement dans un autre ici, jamais ailleurs. Et c’est cela qui est très finement vu par le jeune Rosset. La question pourrait être la suivante : qu’est-ce qui fait que ça ne va pas ? Ce que montre ce livre, entre autres choses, c’est précisément, que ce dont on se plaint — l’actualité toujours : la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, etc.—, et que l’on croit pouvoir réparer, n’est rien qu’un petit aspect de ce qui ne va pas pour de vrai : le fait que le réel est tragique, que nous ne parvenons pas à en faire un objet de désir, que la mort, la maladie, l’échec nous guettent de partout. Rosset se moque ainsi de tous ces gens qui pensent qu’en « transformant le monde » — quoi qu’ils entendent par là —, ils en finiront avec le tragique. C’est un peu comme si l’on pensait qu’avec l’éclairage municipal on pouvait en finir avec le cancer et la mort, écrit Rosset ailleurs. Cette pensée est assez proche de la morale par procuration de Descartes, qui affirmait qu’au lieu de changer le monde, il est préférable de changer ses désirs. Molière le dit encore mieux dans Le Misanthrope: « Et c’est une folie à nulle autre seconde, de vouloir se mêler de corriger le monde. » Voilà une sagesse qui nous aurait peut-être épargné quelques folies en ce début de siècle malade !

Santiago Espinosa et Marc Alpozzo
Bibliographie indicative :
Clément Rosset
Le Réel et son double : essai sur l’illusion, Paris, Gallimard, 1976
Le Réel : Traité de l’idiotie, Paris, Éditions de Minuit, 1977
L’Objet singulier, Paris, Éditions de Minuit, 1979,
La Force majeure, Paris, Éditions de Minuit, 1983
Dialogue avec la faiblesse, suivi de Le Monde et ses remèdes. Paris, PUF, 2023
Avec Santiago Espinosa
L'Inexpressif musical, suivi de Question sans réponse de Clément Rosset, Paris, Les Belles Lettres, coll. Encre Marine, 2013
Esquisse biographique. Entretiens avec Santiago Espinosa, Encre Marine, 2017
Santiago Espinosa
Rosset, philosophe du tragique, Paris, PUF, 2023
 Cet entretien est paru dans le n°32, Question de Philo, Janvier 2024.
Cet entretien est paru dans le n°32, Question de Philo, Janvier 2024.
_______________________________________________
[1] Santiago Espinosa, Schopenhauer et la musique, Paris, PUF, 2022.
[2] Santiago Espinosa, L’Inexpressif musical, suivi de Clément Rosset, Question sans réponse, Paris, Les Belles Lettres, « Encre Marine », 2013.
[3] Clément Rosset, Dialogue avec la faiblesse, suivi de Le Monde et ses remèdes. Paris, PUF, 2023