La nuit de l'angoisse. Note sur Heidegger
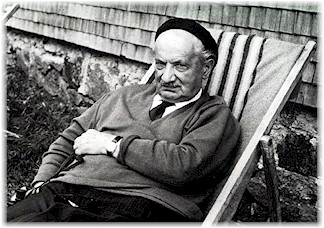
À la différence de Sartre, Heidegger ne dramatise pas l'angoisse, mais en fait une notion centrale et essentielle de son grand oeuvre. Cette longue étude est parue dans le numéro 15, des Carnets de la philosophie, en janvier 2011. Elle est désormais disponible dans l'Ouvroir.
« Mon univers : mat. Rien n’y résonne vraiment – rien n’y cristalise. »
Roland Barthes, Journal de deuil.
- Le phénomène de l’angoisse ou la mise entre parenthèses du « monde »
L’angoisse dans la philosophie de Heidegger a un statut spécifique[1]. En tant qu’affection insigne, elle amène l’homme à s’arrêter dans sa fuite, et à se retrouver lui-même, ou plus précisément selon les mots de Heidegger, le Dasein est « transporté par son propre être devant lui-même »[2]. Jusqu’ici, le Dasein s’était librement et sans trop de déplaisir, livré aux vapeurs du On. Il s’était identifié à cet On épousant les mouvements du monde de la préoccupation sans trop chercher à s’autodéterminer. Cette fuite, qui était la sienne, n’avait d’ailleurs pas pour vocation de se trouver, mais bien plutôt de se perdre. Or, se fuir soi-même, cela veut surtout dire tenter de fuir ses possibilités les plus propres. C’est une manière de refouler en soi le soi, et ça n’est nulle part ailleurs que dans cette fuite que le Dasein se prive d’une ouverture à son être. Autrement dit, la fuite n’étant que fuite de son propre soi, au moment où il fuit, le Dasein s’emmène avec lui-même, car il est ontologiquement fondé à se découvrir, contenant en soi la possibilité de mise en lumière de la totalité de l’être, et ne pouvant trouver ailleurs qu’en lui-même une ouverture à cette totalité. Or, dans sa fuite, il n’est pas possible pour le Dasein de s’auto-analyser, puisque toute l’introspection à laquelle il pourrait avoir recours ne serait qu’artificielle.
La peur
Méthodologiquement, l’ouverture à la totalité de l’être requiert l’angoisse. Aussi, ne faut-il pas confondre l’angoisse comme affection fondamentale (Grundbefindlichkeit), – où l’on retrouve immédiatement cette idée d’insigne affection, – avec tous les autres affects (peur, ennui, etc.)
Car à la différence de la peur (Furcht) l’affect voisin, et dont la « relation ontologique » avec l’angoisse est fondamentale, l’angoisse est angoisse devant quelque chose d’indéterminée. Lorsque, pour clarifier la structure ontologique de l’angoisse, Heidegger analyse l’affect de la peur (§ 30) il le présente sous trois angles : ce qui fait peur, l’avoir-peur et le pour-quoi de la peur. Le Devant-quoi de la peur est le « redoutable » ce qui n’est pas encore déterminé, mais qui avance et que l’on ne peut encore maîtriser. « Ça fait peur » disons-nous, car ce qui est redouté semble être clairement évitable. L’avoir-peur est ce moment où l’on se sent concerné par ce qui est menaçant. On peut avoir peur pour soi ou pour l’autre. Le Pour-quoi de la peur caractérise le moment où l’étant est en proie à la peur, isolé, sans recours, mis à nu face à ce qui le préoccupe. Or, si l’angoisse est radicalement autre, c’est parce qu’elle est une « disposition affective » qui, à la différence de la peur, surgit devant quelque chose d’indéterminée. L’angoisse ne sait pas de quoi elle angoisse. Tandis que si j’ai peur, j’ai nécessairement peur de quelque chose. Par exemple, je peux avoir peur de la mort, je peux avoir peur de la maladie, je peux avoir peur de perdre mon emploi. La peur est donc un affect qui surgit devant quelque chose de déterminé. Lorsque j’ai peur, j’ai peur de quelque chose de menaçant qui vient d’une direction déterminée, et met en péril quelque chose de déterminée. En revanche, lorsque j’angoisse, je redoute une inconnue venant de partout et de nulle part. Si la peur, dans son état de peur, me révèle ce qui la provoque, l’angoisse ne me révèle rien. Je reste prostré avec mon angoisse. Devant ma peur, je suis certes seul, mais autrui peut me venir en aide. Dans l’angoisse, je ne suis pas seulement seul, je suis très précisément isolé.
L’ébranlement
Le Dasein en proie à l’angoisse ressent en premier lieu un ébranlement. D’abord, parce que l’angoisse, à l’inverse de la peur, ne donne plus lieu à une telle « déroute ». Ensuite, parce que l’angoisse n’a pas d’objet. Jusqu’ici, je pouvais craindre pour mon travail, ma réputation, ma vie même. Sur le quai d’une gare par exemple, je ne franchissais pas la ligne blanche marquée au sol, de peur d’être percuté par un train. À présent, la crise d’angoisse a rendu toutes ces peurs vaines. Ce qui est « à-portée-de-la-main, et sous-la-main, à l’intérieur du monde, ne fonctionne, comme ce devant-quoi l’angoisse s’angoisse. »[3] Aucun objet intra-mondain n’a le pouvoir de déclencher l’angoisse ; aucun objet intra-mondain n’a non plus le pouvoir de l’apaiser. Avec l’angoisse, l’horizon qui était le mien s’effondre. Je n’ai plus de lointain. Je n’ai plus de ciel, plus de sol, le paysage s’est écroulé devant mes yeux comme un décor de cinéma. Les repères spatiaux sont brouillés. Je n’ai plus de frontières, plus de distances. Ni « ici » ni « Là-bas ». Le monde ambiant, la préoccupation devenant, soudain une symphonie égarée, un vacarme silencieux. Voilà pourquoi la menace qui pèse sur moi n’est plus localisable. Je ne sais pas où elle est, car je ne sais plus où je suis. Soudain, avec l’angoisse, le monde ne me parle plus. Il n’a plus de « significativité ». L’effondrement dans l’angoisse de tout l’étant disponible, la crise d’angoisse ouvre sur le « rien et le nulle part » (SZ, 187, trad. Martineau).
L’expérience de la rupture et de la désolation
On pourrait alors parler d’expérience de l’« arrachement » et de la « rupture ». De quoi m’angoisse-je, si ce n’est du recul même des étants, de l’indifférenciation dans laquelle s’engouffrent ces étants ; ce qui m’angoisse, c’est le retrait, l’absence, le Rien de l’étant. Ce qui m’angoisse, c’est cette angoisse du Rien qui, une fois l’angoisse calmée, fait dire au « parler quotidien » : « Au fond ce n’était rien. » Parce que ce qui est apparu là, et qui se signale dans le « parler quotidien » par ce qui n’est pas utilisable à l’intérieur du monde, est de fait le Rien en personne. Mais le parler quotidien n’emploie pas le terme « Rien » dans un sens juste. Lorsque mes amis viennent me dire, pour me rassurer, « ce n’était rien », ils emploient ce terme dans le sens de l’ustensile, de l’«utilisabilité »[4], ce qui veut ici dire que le Rien est là employé pour dire quelque chose. Bien sûr, l’angoisse a certes mis en suspens le « monde » ; il ne l’a néanmoins pas effacé. Pourquoi alors ne puis-je dire à mon tour : « Ce n’était rien » ? Parce que jusqu’ici, le monde et le soi entretenaient un rapport mutuel.
Les étants, dans un rapport de « renvoi », étaient fondés sur quelque chose dans le monde. A présent, l’ébranlement ressenti dans l’angoisse a remis en question cet ordre établi, et le Dasein, ouvert « originairement », a été mis, dans l’angoisse, « directement » face au monde même. C’est-à-dire à son indétermination et son insignifiance. Le Dasein perd alors le sens du monde ambiant. Cessant d’être simplement une « angoisse devant », l’angoisse est également à présent une « angoisse pour ». L’angoisse ayant désormais atteint les racines de l’être, le monde, c’est-à-dire la préoccupation, mais également mes activités quotidiennes qui ne me parlent plus. Le malaise me gagnant à présent dans l’angoisse, fait imploser la parfaite tranquillité de mes habitudes, rend mes activités ordinaires insignifiantes, répudie le On. Tout ce qui faisait jusqu’ici sens, dans la « vie quotidienne », s’est soudain évanoui, brisé dans cette « nuit » de l’angoisse à l’intérieur du monde, et dans une sorte de non-significativité, c’est-à-dire d’inimportance générale. Certes, les étants, pour leur part, continuent bien leurs connexions mutuelles, mais dans l’expérience de l’angoisse, – cette expérience de la rupture –, les étants cessent de s’imposer au Dasein, et ainsi s’effondrent. Je fais alors l’expérience de la désolation. C’est-à-dire, que non préparé à cette expérience, la terre désertique et le flot d’abattements auxquels elle laisse place me donnent encore moins la possibilité de l’analyser. Je suis ébranlé, parce qu’au moment où, dans l’angoisse, je découvre « que cela ne va plus de soi », par exemple que la vie que je mène n’est pas une vie, parce qu’elle ne fait soudain plus sens, qu’elle ne représente plus qu’une fuite ou une évasion, avant d’être un pouvoir « révélant » ou « découvrant », ce que je perçois maintenant, grâce à l’angoisse elle-même, c’est mon impuissance à continuer d’affronter la vie que je mène : « Je suis à bout ». Le tourment qui se manifeste alors, est le propre de l’épreuve de l’effondrement de tous les signifiants, qui représentaient l’armature de mon existence, les faisceaux du sens. À présent, « Le « monde » ne peut plus rien offrir, et tout aussi peut être l’être-là d’autrui »[5].
Le Dasein dépouillé
Nous voilà désormais introduit au second trait de l’angoisse : transporté au-devant de lui-même, le Dasein est dépouillé, il ne parvient plus à trouver sa place dans le monde avec « l’être-là d’autrui » (das Mitdasein Anderer). Le « je » qu’il fut jusqu’ici n’a plus de consistance, c’est-à-dire qu’il ne sait plus se saisir à partir de la publicité du On. Le Dasein est désormais « isolé ». Il est seul au milieu d’un monde qui s’est effondré et qui, désormais, ne lui offre plus aucun refuge, plus aucun sens. On peut ainsi comprendre que rien d’intra-mondain ne m’apparait comme objet de mon angoisse, et qu’ainsi, je suis singularisé par l’angoisse, parce que j’ai perdu le chemin. Le monde encombré mais néanmoins rassurant de la préoccupation quotidienne s’est soudain défait sous mon regard, et le On auquel je pouvais jusqu’ici m’identifier ne peut soudain plus rien pour moi. Dans mon errance, je ne peux pas non plus me raccrocher à la menace qui est, elle-même, indéterminée. Or, si l’angoisse isole[6] le Dasein du reste du monde, c’est parce qu’il se voit soudain jeté hors de son sort, hors-de-chez-soi. Le Dasein est à présent atteint de solipsisme existential. Dans cet état, le menaçant, ne se trouve, ni « ne vient de » nulle part, n’est pas « localisable »[7]. Je suis singularisé, isolé, au sens où ça n’est ni toi, ni moi, ni on, c’est un je que j’ignorais jusque-là. Véritable mise en suspension du « monde », c’est avec l’angoisse que l’on trouve la véritable épokhé heideggérienne[8].
L’angoisse est angoisse de rien
Pourquoi ? D’abord, parce que bientôt, la désolation s’estompe, et « un calme singulier »[9] lui succède et se répand. Le Dasein a été expulsé des choses et de lui-même. L’angoisse n’étant angoisse de rien, le Dasein ne peut pas même avoir une représentation de l’angoisse. Voilà pourquoi « Dans l’angoisse – disons-nous – un malaise nous gagne »[10]. Heidegger thématise là l’effet dévastateur de l’angoisse comme un moment crucial à la fois de perte, perte de ses repères, de la compréhension de soi et des autres, mais aussi de l’effondrement du monde de la signification porté par la préoccupation, pour le retrouver, suite à la rupture avec le On, dans sa profonde nudité. L’angoisse a fait surgir le Rien et le nulle part, nous dépaysant, en nous expulsant des choses et de nous-mêmes. On peut désormais comprendre ce que Heidegger dit dans sa conférence de 1929, – conférence qui renouvelle le problème de l’angoisse en lui donnant une extension inédite – lorsqu’il parle de ce calme d’une grande singularité. C’est-à-dire que le Dasein se prépare à être parfaitement neuf. Avoir une nouvelle peau, prendre un nouveau départ ; c’est la métamorphose. Nous comprenons alors mieux pourquoi, dans l’angoisse, ayant assisté impuissants, à l’effondrement de la totalité des étants disponibles, « nous flottons (désormais) « en suspens ». »[11]
*
Le repos fasciné
Reprenons désormais la question : « Dans l’angoisse, il y a un mouvement de « recul devant… », un mouvement qui sans nul doute n’est plus une fuite, mais un repos fasciné. Pourquoi ? Parce que tous ces étants que nous pensions auprès de soi s’effondrent soudain pour nous signaler que soudain, le hors-de-chez-soi est constitutif de notre être même. L’angoisse, on l’a compris, est une forme de tabula rasa. Jusqu’ici, jamais le Dasein n’était libre de lui-même : ni libre de ses humeurs, ni libre de maîtriser telle ou telle tonalité, sinon par une contre-tonalité. De plus, le Dasein n’avait pas, mais ne pouvait pas non plus s’emparer de lui-même et s’assurer de lui-même comme s’il était la source absolue du sens de ce monde. Or, cette terrible dévastation amène le Dasein dans la nudité de son essence. C’est-à-dire qu’au moment où ses repères se sont effondrés, dans son esseulement, le Dasein est mis en face de ses possibilités. Heidegger l’écrit d’ailleurs en ces termes : « L’angoisse isole le Dasein vers son être-au-monde le plus propre, qui, en tant que compréhensif, se projette essentiellement vers des possibilités. »[12] Au moment de cet effondrement, ce pour quoi le Dasein s’angoisse, c’est pour l’être de ses possibles. En tant que soi singulier, le Dasein a à faire face à sa liberté. Voilà la notion ontologique qui soudain apparaît sous la plume de Heidegger, et qu’il nous faudra prendre en compte. Jusqu’ici, le Dasein était sous influence, dépendant et soumis à la dictature du On. à présent, le voilà seul face à sa liberté, devant « se choisir » et « se saisir soi-même »[13]. Mais le Dasein n’est pas transporté au-delà du monde par l’angoisse. Si l’angoisse esseule le Dasein, et le place en face de sa liberté, elle replace sa liberté face aux chaînes quotidiennes d’un langage qui ne prend jamais en compte le sujet seul, mais le On. Or, le On sent que ce n’est rien. Et voilà où surgit le Rien, ce dernier faisant son apparition par l’angoisse, car « L’angoisse manifeste le rien. »[14]
- La nuit de l’angoisse
- Le Rien comme phénomène fondamental
Qu’en est-il plus précisément de ce Rien ? En laissant l’initiative à l’angoisse de nous le donner, quelle est sa réalité, son déroulement, sa présence ? Le Rien n’étant ni une chose, ni un étant, il ne peut être trouvé du côté du nihil negativum, c’est-à-dire d’une « expérience négative » de la vacuité des choses ; le rien ne peut être non plus trouvé si nous ne défaisons pas notre regard de ce dont nous parlons d’habitude, c’est-à-dire un « rien vulgaire, rendu incolore sous la pâle évidence de ce qui va de soi »[15]. Nous allons voir que cette grande avancée phénoménologique amène l’angoisse à s’ouvrir sur un rien qui s’entend comme révélation ; or, ce rien peut être considéré comme un accès à l’être[16].
L’ennui
Puis-je dans l’angoisse faire connaissance avec le Rien en personne ? Il me faudrait pour cela être capable d’appréhender la totalité de l’étant. L’homme, dans sa finitude, n’en a pas le pouvoir, si ce n’est en imagination. Cette donation semble alors parfaitement impossible au Dasein, au même titre que la donation du Rien. En soi, pourtant, cette donation ne l’est pas. Pour l’expliquer, Heidegger prend les exemples de deux tonalités : l’ennui et la joie. Considérons d’abord l’exemple de l’ennui : dans la vie quotidienne, nous manipulons des étants, mais nous ne faisons jamais commerce avec ces étants dans leur ensemble ; nous nous adressons toujours à tel ou tel étant en particulier ; de fait, nous ne visons jamais la totalité des étants. Pourtant, cette unité est maintenue dans cette dispersion de manière abstraite. Il peut arriver pourtant qu’un étant chute, et perde, au moins un instant, son caractère privilégié d’utilisabilité. Et soudain, « tel livre, tel spectacle, telle occupation ou tel désœuvrement »[17] m’ennuie. Je ressens alors une indifférence spécifique face à cet étant en particulier, – ce qui est à distinguer de l’ennui profond qui touche tous les étants en général, et transforme la vie en une longue et lente litanie, pour laquelle, je ressens une « étrange indifférence ». Mon ennui généralisé est alors, un ennui de soi. L’autre tonalité, étant la joie, dans laquelle, nous ressentons « la présence de l’être-là » au contact de la personne aimée.
La crise d’angoisse
Une difficulté philosophique subsiste : comment par l’ennui ou la joie puis-je avoir accès aux étants dans leur totalité ? Continuons avec l’exemple de l’ennui[18]. Nous nous attachons toujours, au quotidien, à un étant en particulier selon l’usage que nous allons en faire. Mais lorsque l’ennui nous prend, l’usage de ces étants est rendu caduc ; soudain, je ne distingue plus ni les différences quantitatives, ni les différences qualitatives. S’ouvre alors à moi, par mon indifférence aux choses, la totalité des étants dans leur indifférenciation.
Mais notons-le : l’ennui n’est pas une disposition suffisante pour nous révéler le Rien. Pour que l’homme soit porté devant le Rien en personne, il lui faut une crise d’angoisse. Car l’angoisse en tant que disposition fondamentale repousse les étants dans une indifférenciation, en les rendant inintéressants, inutilisables, rendant enfin le Dasein à lui-même. Dans l’angoisse, j’aurais beau tenter de me repérer, de continuer de croire en ce que je fais, ou en la valeur de cette chose, rien n’y fera. Tout aura disparu, englouti dans une mer d’indifférence. Et comme un naufragé au long cours, je serai ainsi emporté avec l’épave. Il ne suffit pas de voir notre monde s’écrouler comme un château de cartes, nous nous affalons avec. De fait, nous sommes gagnés, dans l’angoisse, d’un terrible malaise. Mais le nous ici ne se confond plus avec le On. C’est le « je » qui est soudain pris de troubles. Le malaise qui me gagne, c’est celui de l’homme égaré, errant, sans aucun espoir de trouver du secours. Je ne suis pas abandonné des autres. Ils sont bien là, tout autour de moi, ils tentent même de m’aider, mais leurs mots, et leur soutien ne suffisent plus. Je ne suis désormais plus en mesure de comprendre ce qu’ils me disent. J’ai été expulsé du groupe, je n’appartiens plus au monde des mots d’usage. Dans le recul des étants, je ne suis plus, un « moi » ou un « toi », qui regarde ébahi, le monde s’effondrer, – d’ailleurs, ce monde est toujours debout. Je suis placé au centre de l’étant, et je fais face à la menace, sans garde-fous. Je dois affronter « le pur être-là »[19]. C’est-à-dire, que je dois m’affronter moi-même.
Mais comment puis-je, si « l’angoisse nous ôte la parole »[20], et qu’elle nous fait taire, malgré nos efforts de recourir à la parole pour évacuer le « vide du silence » ? Tous nos propos tournant désormais court, manquent systématiquement leur objet. Alors que le questionnement autour du Rien cherche à tâtons un étant, en réalité ce silence précisément dit l’« être »[21]. C’est-à-dire que, dans le naufrage des étants, il y a subtilement ce glissement vers l’être que nous ne voyons pas encore, mais que le Rien révèle. C’est-à-dire que le Rien, comme nous l’avons déjà précisé plus haut, s’identifie à l’être[22].
L’impuissance des mots
On constate alors que le Rien, jusqu’ici réduit au silence le plus complet par la science, – car on ne pouvait théoriquement rien en dire[23] –, est ici celui par qui le silence provient pour une toute autre raison. Certes, cette rencontre avec le Rien comme phénomène fondamental ne peut se dire par des mots, car il y a un indicible au centre même de la rencontre qui tient du fait que le sens, la connexion avec les réseaux de signifiants est rompue. Or, il semble pourtant que la saisie du Rien se fasse sur le mode de l’incompréhension dans un premier temps. Un cercle vicieux s’installant désormais dans notre rapport au Rien, c’est dans son silence autarcique, ne renvoyant à rien qu’à lui-même, – car il ne révèle aucun étant, au contraire, il les rend même tous muets, – que se pose désormais le problème phénoménologique, puisque ce Rien qui ne peut s’exprimer hors de son « indifférenciation », ne sachant rien dire d’autres que Rien, ne nous permet pas d’avancer dans cette nouvelle compréhension. Ne pouvant rien exprimer, rien dire, sauf sur le mode du « ne pas », perdu dans une forme d’autisme, le Dasein fait alors l’expérience de ce que J.-L. Marion appelle : « le silence autistique[24]. » C’est littéralement une « grève de la parole » du Dasein. Une grève libératrice de son être, qui lui permet d’enfin se regarder en face, de s’écouter et de laisser s’exprimer ce qu’il retenait jusqu’ici prisonnier dans l’obscurité et le silence.
Le naufrage du monde
Mais continuons en écoutant Heidegger : « Le Rien n’attire pas à soi ; au contraire, il est essentiellement répulsion. Mais en repoussant, sa répulsion est comme telle l’expulsion qui déclenche le glissement, celle qui renvoie à l’existant qui, dans son ensemble, s’engloutit. Cette expulsion totalement répulsante, qui renvoie à l’existant en train de glisser dans tout son ensemble, c’est elle dont le Rien obsède le Dasein dans l’angoisse et qui est comme telle l’essence du Rien (Nitchs) : la réduction à Rien (Nichtung). »[25] Que dit ce texte ? Lorsque l’angoisse nous oppresse, tout simplement, nous sommes pris d’une répulsion spontanée devant l’indistinction effrayante des étants dans leur effondrement général ; suit alors l’expulsion, comme une mise à zéro dans le naufrage d’un monde qui soudain ne répond plus au beau milieu de cette crise d’angoisse, c’est-à-dire que celle-ci, parce que le monde ambiant est devenu incompréhensible, nous oblige au silence, face aux décombres de ce monde ancien.
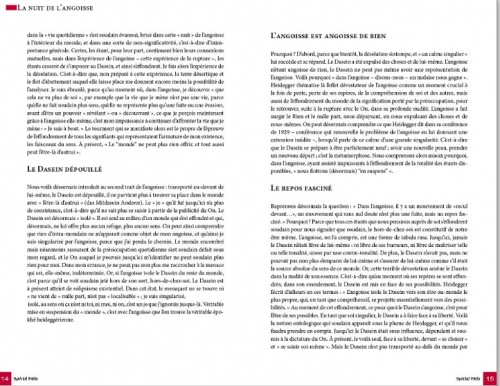
Extrait de cet article, paru dans la revue Spécial Philo, n°4, nov-déc. 2013-jan 2014
Le Rien déploie l’être
De fait, répétons-le, si le Rien dans la philosophie de Heidegger, est essentiellement le lieu d’une révélation, c’est celle de l’être. Le Rien déploie l’être. Et ce, même si les mots sont impuissants à révéler cette révélation. Nous l’aurons évidemment compris, c’est parce que le Rien dans le langage ordinaire ne tient qu’à signifier l’insignifiant de l’angoisse que cette impossibilité existe. En réalité, dans « la claire nuit du Rien de l’angoisse »[26], il nous faudrait nous arrêter sur « l’énoncé d’un Non au sujet de « ce qu’il n’y a pas ». »[27] Ce qui nous amène à évoquer la difficulté d’interprétation du Rien que relève J.-L. Marion. L’angoisse et le Rien ayant ensemble suspendu la parole et la distinction, il est juste de se demander à la suite de phénoménologue, s’il est encore possible après cette mise entre parenthèses de questionner la revendication. Mais le Rien n’est pas un Rien de rien. Dans son texte corrigé de 1949, Heidegger renforce l’être et l’étant, faisant du Rien le passage obligé vers l’être[28].
Le déploiement de l’être devient alors possible, non plus à partir de l’appel de l’étant qui se perd, mais à partir du dernier appel, l’appel de l’être. C’est par l’appel des lointains, qui est l’appel de l’être (Anspruch des Seins) que Heidegger, dans sa postface, nous montre qu’il nous faut à présent parcourir l’écart entre le Rien et l’être en partant de son extrême fin, et non par son commencement, – introduisant ainsi le proche, c’est-à-dire là où nous sommes, autrement dit, le Rien.
Le sentiment d’étrangeté
D’où une double erreur commise par le On : l’angoisse n’est pas un état d’âme ou un vécu qu’il s’agirait de sonder et qui ne porterait sur Rien, mais un « phénomène d’être », car seul l’être peut appeler à l’être. En ce sens, l’angoisse n’a pas pour objet de révéler quoi que ce soit qui tienne de la préoccupation. De plus, ce sentiment d’étrangeté qui apparaît soudain dans le phénomène de l’angoisse a pour objet d’isoler le Dasein, de l’esseuler, de l’arracher à la déchéance, de le soustraire à la familiarité, en lui rendant « manifeste l’authenticité et l’inauthenticité en tant que celles-ci sont des possibilités de son être. »[29]
Enfin, l’irruption de l’angoisse dans notre vie, aussi rare[30] qu’imprévisible, n’a pas de motif propre. « Aussi profonde est l’assise de son règne, aussi futile peut être le motif qui l’occasionne. »[31] Rien ne prédétermine la donation du Rien. Et il ne peut pas plus se fonder en sens. L’angoisse vient donc ébranler l’apparente sérénité. En réalité, l’angoisse vient abolir la distance qui sépare le moi du moi-même. Dans le monde de la préoccupation, le Dasein jusqu’ici ne vivait jamais dans la proximité avec lui-même, toujours mis à distance par l’inauthenticité d’une vie qui ne lui permettait pas de vivre auprès de l’être, c’est-à-dire par lui-même. Le passage de la distance à la proximité va néanmoins déstabiliser le Dasein qui, dans l’angoisse, ressentira un « isolement » inquiétant, au sens où, même si autrui ou les choses sont toujours là, il est désormais ramené à son être-au-monde pur et nu, dont il ne dépend que de lui, esseulé, de le prendre en main ou non. C’est la raison, pour laquelle, dans l’angoisse, nous dit Heidegger, « on se sent ˝étrangé˝ »[32].
- Du chemin escarpé de l’« étrang(èr)eté »
L’angoisse brise la familiarité, elle dépayse, et inquiète. Pourquoi ? Parce que jusqu’ici le On avait cette « prétention de nourrir et de mener une « vie » pleine et authentique (qui) procure au Dasein une tranquillisation, pour laquelle, tout va « pour le mieux » et pour qui toutes portes restent ouvertes[33]. » Cette illusion une fois perdue, ça n’est pas la peur qui submerge le Dasein, pour les raisons que nous avons déjà montrées plus haut. En réalité, c’est désormais la possibilité pour moi, moment où mon être-en-vue-de-moi-même apparaît dans son caractère crucial, d’être enfin moi-même. Aussi, est-ce pourquoi dans l’angoisse, je suis soudain submergé d’un sentiment d’inquiétante étrangeté[34] (Unheimlichkeit). Dans cet état, le menaçant, ne se trouve ni « ne vient de » nulle part, n’est pas « localisable »[35] ; toute identification du monde à partir de moi-même devient impossible.
L’angoisse ne m’a pas rendu « étranger » au monde. Je ne suis pas, par l’angoisse, répudié du monde. Il ne s’agit donc pas de parler d’anéantissement ou de négation « de l’existant dans son ensemble »[36].
Le malaise du Dasein
En fait, pour bien comprendre, tentons le rapprochement par exemple, de l’état de malaise du Dasein avec le terme d’« acédie » dont parle Saint Jean Climaque dans le XIIIème degré de l’Echelle sainte[37] – qu’Arnaud d’Andilly traduit d’ailleurs bien improprement par « ennui ». Bien plus que l’ennui, l’acédie, c’est le désenchantement et la désillusion ; un relâchement de l’âme ; une langueur dans la psalmodie ; une mise en doute de la bonté de Dieu et de la fécondité de notre énergie créatrice. Nous détournant de notre combat, l’acédie nous rend secs et stériles ; elle endurcit notre cœur[38]. Comment ne pas comprendre le sens du sentiment de malaise, d’étrang(èr)eté que ressent désormais le Dasein. Aussi, cette traduction que je reprends, et qui a été adoptée par Martineau, présente le grand mérite d’exprimer à la fois l’idée d’« étrange » et d’« étranger » que j’ai essayé d’exprimer avec l’exemple de l’acédie ; elle montre combien le Dasein, saisi du sentiment d’angoisse, ne comprend plus l’effondrement de la familiarité quotidienne représentant jusqu’ici le seul sens qu’il pensait comprendre. « Hors de chez soi », le Dasein ne peut désormais plus avoir recours à la « publicité du on » pour se retrouver.
Hors-de-chez-soi
Jean Greisch nous met d’ailleurs en garde : il faut éviter de confondre l’Unheimlich avec un « égarement » ordinaire qui serait le propre d’une perte d’orientation. Dans l’étrang(èr)eté, nous ne sommes plus dans « une complète sécurité et une complète absence de besoin dans l’ordre de la préoccupation quotidienne[39]. » On bascule en réalité dans un sentiment inverse, et le « chez-soi » familier que le On proposait jusqu’ici n’est plus efficient. À présent, dans la crise d’angoisse, « il n’y a strictement « rien » à voir ». Le Dasein réalise que ce « hors-de-chez-soi » est le propre même de son être. Dans le bris du On, la donation du Rien en a révélé la rupture, ainsi que la nudité de l’essence du Dasein. On voit alors, combien l’idée du « Rien », sous la plume de Heidegger, manifeste la radicalité du phénomène d’angoisse, au point d’en exprimer le phénomène absolu.
La révélation
Nous pouvons désormais considérer, qu’avec Heidegger, l’angoisse est ce moment crucial, cette tonalité fondamentale qui nous met en présence du « Rien lui-même », qui nous permet d’aller à la rencontre de ce Rien. Mais l’angoisse n’ouvre pas seulement sur le Rien. Il ouvre aussi sur une « révélation ». Heidegger déplace le Néant théorique, qui n’est plus ici qu’une modalité de l’angoisse, vers l’angoisse elle-même, devenue « révélatrice » du Néant dans un « repos fasciné »[40]. Cette fascination pour le Dasein, joue le rôle de « répulsif », qui l’« expulse » hors de la familiarité de l’Umwelt, de la banalité quotidienne pour lui révéler – une révélation qui n’est rendue possible que par cette rupture – l’existant dans sa « parfaite étrangeté »[41].
Dans « la claire nuit du rien de l’angoisse »[42] une triple révélation apparaît au Dasein : révélation du monde, révélation du Dasein lui-même, et révélation de leurs rapports.

Martin Heidegger en vacances
 (Paru dans les Carnets de la philosophie, n°15, jan-fev-mars 2011 et dans Spécial Philo, n°4, nov-dec. 2013, jan 2014)
(Paru dans les Carnets de la philosophie, n°15, jan-fev-mars 2011 et dans Spécial Philo, n°4, nov-dec. 2013, jan 2014)
____________________________________
[1] Freud tenait un discours similaire à propos de l’affect de l’angoisse auquel il a consacré de longues réflexions. Voir à ce propos, J. Laplanche, Problématique I : L’angoisse, Paris, PUF, 1980, p. 39.
[2] Martin Heidegger, Sein und Zeit (SZ), § 40, (184), trad. E. Martineau.
[3] SZ, (186), trad. E. Martineau.
[4] Trad. Vezin. Martineau dit « étant à portée-de-la-main ».
[5] SZ, (187), trad. F. Vezin.
[6] Le terme est d’E. Martineau. F. Vezin traduit par « esseulement ».
[7] J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris, PUF, 1994, 2003, p. 233.
[8] Il est à noter que J.-F. Courtine voit dans cette mise en suspension du jugement par le phénomène de l’angoisse, une sérieuse « répétition » de la problématique de l’épokhé. – Sur ce point, on se reportera à son commentaire, « Réduction et différence » in Heidegger et la phénoménologie, Paris, Vrin, 1990, p. 234.
[9] Trad. Munier, p. 51.
[10] Mar tin Heidegger, Was ist Metaphysik ?, Trad. Munier, p. 51.
[11] WM, trad. H. Corbin, p. 59.
[12] SZ, (188), trad. E. Martineau.
[13] Nous retrouvons une analyse de la liberté chez Sartre profondément similaire, mais dans un climat métaphysique sartrien de lutte et de désespoir.
[14] WM, p. 51, trad. R. Munier.
[15] Ibid, p. 50
[16] Notons tout de même que chez Heidegger, l’identité entre l’être et le Rien n’est cependant pas si évidente.
[17] WM, p. 50, trad. R. Munier.
[18] C’est la tonalité qui bénéficie de la description la plus détaillée. La joie et l’amour demeurant à peine évoquée. J.-L. Marion émet, à juste titre, quelques réserves quant à la pertinence de leur mention dans la conférence de 29. (Voir, J.-L. Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie, Paris, coll. « Epiméthée », PUF, 1989, p. 261 sq.)
[19] WM, p. 51, trad. R. Munier.
[20] Idem.
[21] J.-L. Marion fait toutefois une remarque intéressante à ce propos. En effet, si l’avant-dernier alinéa de la Postface de 1943 prétend énoncer un tel renvoi, l’énoncé phénoménologique, lu à la lettre, devient intenable, voire contradictoire. Voir op. cit., pp. 274-275.
[22] Voir à ce propos la postface de WM (1943). Or, cela rend absolument irrecevable par ailleurs, l’association de la thèse de Heidegger sur le rien à une tentation nihiliste, ou une promotion du règne du néant. Voir à ce propos, J.-L. Marion, op. cit., p. 236, note 2.
[23] Faisons remarquer que si les sciences positives n’ont rien à dire du Rien, la philosophie jusqu’à Heidegger n’en avait pas plus à dire. Nous renvoyons le lecteur à H. Bergson et la confusion langagière qui est le propre de son analyse du Rien, qu’il considère comme un simple problème de mots que l’on confondrait avec un problème d’idées. (Voir sa célèbre conférence de 1920 Le possible et le réel.)
[24] J.-L. Marion, Réduction et donation, Op. cit., p. 274.
[25] WM, p. 61, trad. H. Corbin (modifiée).
[26] WM, p. 52, trad. R. Munier.
[27] WM, p. 64, trad. H. Corbin.
[28] Voir l’analyse de J.-L. Marion, « Réduction et différence », op. cit., p. 272 sq.
[29] J.-L. Marion, Ibid, p. 243.
[30] « Cette angoisse originelle n’advient qu’en de rares instants », WM, p. 53, trad. R. Munier.
[31] WM, p. 66, trad. H. Corbin.
[32] SZ, § 40, (188), trad. F. Vezin.
[33] SZ, § 38, (177), trad. F. Vezin.
[34] Il est à noter que S. Freud a écrit un article à propos de l’Unheimlichkeit, « L’inquiétante étrangeté » in L’inquiétante étrangeté et autres textes, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1985, trad. B. Féron, pp. 209-263, bien qu’ « un abîme sépare l’approche clinique-explicative qui est celle de Freud de l’approche descriptive-existentiale qui est celle de Heidegger », J. Greich, op. cit., p. 233.
[35] J. Greisch, op. cit, p. 233.
[36] WM, p. 61, trad. H. Corbin.
[37] Saint Jean Climaque, L’échelle sainte ou les degrés pour monter au ciel, Monastère orthodoxe Saint Nicolas, 1973, trad. Arnaud d’Andilly.
[38] On pourrait trouver une similitude familière entre l’acédie et l’angoisse. Aussi, ces deux termes peuvent-ils être rapprochés de la dépression qui s’analyse en psychologie comme une perte de repères, un effondrement des valeurs et de l’élan vital et un repli sur soi ; les symptômes de la dépression, outre la chute de l’humeur, le blocage et la souffrance morale, entraînent le déprimé à un doute ravageur en ce qui concerne ses propres capacités et les valeurs auxquelles il croyait jusqu’alors. Ce mal étrange et mystérieux inquiète, mais comme il résiste à une compréhension logique et à un dénouement par l’action, il entraîne le déprimé à une pénible impression d’incurabilité, et la certitude de ne jamais s’en sortir. Il existe là un courant sérieux en philosophie et psychanalyse, tentant de concilier la compréhension de la maladie psychosomatique et la phénoménologie, se tenant au carrefour où se croisaient Freud, Husserl et Heidegger. Aussi, je renvoie au fondateur de l’analyse existentielle (Daseinanalyse), Ludwig Binswanger, Introduction à l’analyse existentielle, Paris, coll. « Arguments », Editions de Minuit, 1971, trad. J. Verdeaux et Roland Kuhn.
[39] SZ, § 40, (189), trad. F. Vezin.
[40] WM, p. 52, trad. R. Munier.
[41] WM, p. 61, trad. H. Corbin.
[42] WM, p. 52, trad. R. Munier.