Michel Houellebecq, le devoir d'être abject
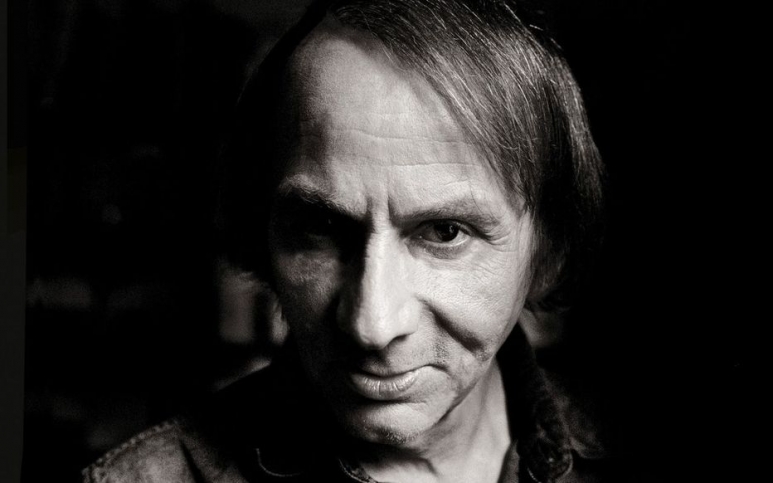
Écrit en 2005 et paru dans le numéro 17 du Journal de la culture la même année, puis, relu et augmenté, cet article a d'abord trouvé une place dans un recueil d'articles intitulé Les Âmes sentinelles, que j'ai fait paraître aux éditions du littéraire, en 2011 ; il figure désormais au sommaire de mon livre Galaxie Houellebecq (et autres étoiles) paru aux éditions Ovadia (2024).
« Acceptable comme tout écrivain de valeur, Houellebecq ne l’est pas. Son encre est trempée dans le cyanure, sa littérature est dangereuse, parce qu’elle dit le pays dans lequel nous vivons », Marc Weitzmann[1]
I. Houellebecq, le cynique
La littérature de Houellebecq apparaît pour ses contempteurs, comme une littérature monstrueuse. Disons plutôt que c’est Houellebecq lui-même qui apparaît comme un monstre. Un authentique monstre. Pourquoi ? Parce que dans un langage cru et sans nuances, il dénonce l’échec d’une civilisation. Tous ses personnages, généralement des hommes médiocres, souffrent et cherchent désespérément l’amour de l’autre. Mais les illusions de la libération sexuelle, l’individualisme primaire qui s’est installé dans les rapports humains, – chacun revendiquant pour lui seul son droit au plaisir –, le sadomasochisme, la compétition sexuelle, la négation ou mutilation du corps d’autrui, autant de murs, autant de fossés qui séparent les individus et qui ont eu raison de notre désir de rencontrer autrui. Autant de limites posées par la gestion des intérêts privés, l’égoïsme, le tout-à-l’ego. Autant de remparts à l’amour et au bonheur.
La suite de cet article figure dans Galaxie Houellebecq (et autres étoiles)
Ce livre peut être commandé directement sur Amazon
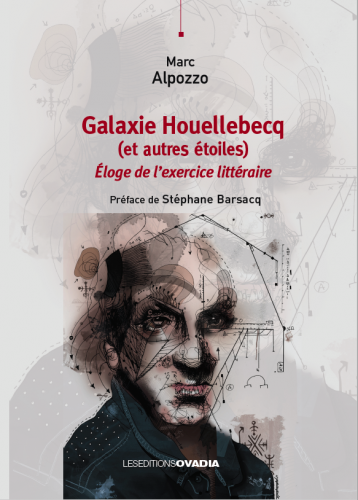
Commentaires
wouaiiiiis abjecte je m'en délecte ha ha ha
Moi aussi John, moi aussi.
En résumé, tout le monde kiffe Houellebecq... Demain, deuxième et dernière partie... on line !!!
Yes, ça kiffe grave dans les chambrées.
Souffrez, mes chers amis que l'abjection me débecte, que je l' exècre et que j'aie tendance à la prendre pour ce qu'elle est: une éructation sans esprit dont je me passe fort bien. Mais vous, je vous aime bien.
C'est juste que nous sommes pervers et que tu ne l'es pas.
Probablement, mon cher françois. :-))
La perversion, frustration qu'on a mise sur un piédestal, peut mener à la souffrance et tout salir, du lit jusqu'au système bancaire...
En bonne terrienne pragmatique, je m'honore de soigner mes frustrations (tout le monde en a) en gardant l'esprit ouvert à toutes les formes de guérison. Je trouve toujours assez indécent les gens qui pense être intéressants en déballant leurs tripes fétides. J'ai définitivement tourné le dos à Houellbecq en l'entendant "vomir" sa mère. J'ai refermé son livre en me disant "Quel intèrêt ???" comme à la Fiac devant la machine à fabriquer des excréments, (une oeuvre d'art, dit-on....).
Oui, mais il en a tant vendus qu'il peut vivre toute sa vie sans travailler.
quand j'ai lu " les particules élémentaires " je crois que j'ai entrevu la source de cette personnalité négative, écoeurée de tout. séparer deux frères pour pouvoir vivre leur vie quel égoïsme de ses parents!
les bases ont été lézardées dès l'enfance!
mais il faut éviter de se laisser séduire !! ou on devient désabusé , on ne voit plus rien de ce qui reste beau il reste encore la nature ( quoiqu'on en dise ) et aussi les sentiments réveillons-nous que diable !
évitons le matérialisme et le sexe à tout prix et n'importe comment!
sinon on va crever !
Je pense que l'on en veut bcp à Houellebecq de nous fasciner tant. Son style, ses personnages, son univers, tout est là pour nous séduire, ou tout du moins, réveiller en nous certains fantômes, certaines frustrations, un certain dégoût, inhérent à tous, de la vie.
Je crois aussi que le temps de Houellebecq (comme celui de Dantec, -bien que ce dernier ait tenté de rejoindre une conception du monde plus christique, plus emplie de spiritualisme mystique pour échapper à ses démons, à son dépressionnisme névrotique) est fini. Houellebecq contrairement à Dantec reste plus prudent, demeure stable sur ses positions athées et rationnelles. De fait, son propre dépressionnisme, proche d'une aspiration au néant, se referme sur lui comme un mausolé. D'où cette inaptitude à vivre qu'il conserve contre vents et marées, et l'échec qui est le sien à construire une oeuvre universelle.
Houellebecq a réveillé en nous nous névroses, nos anxiétés, notre angoisse existentielle ; à nous de suivre désormais d'autres pistes. Pourquoi pas celle de BHL (voir mon dernier post à ce jour "Houellebecq/BHL") qui est franchement spinoziste... ?
Houellebecq dit, decrit, disseque, ce que peu d'entre nous regardent en face, il ecrit l'impensable, la part monstrueuse de l'existence, que l'on s'efforce de nier par la sublimation.
"Ce sont généralement de petites « garces » de dix-sept ou dix-huit ans incapables, bien souvent par bêtise crasse, de sortir de l’amour de leur petite personne sans existence, sans importance[4]. Des crétines aussi belles que stupides. Plus tard, lorsqu’elles seront devenues des femmes, elles prendront « des calmants, (feront) du yoga, (iront) voir des psychologues ; (les femmes) vivent très vieilles et souffrent beaucoup. Elles vendent un corps affaibli, enlaidi ; elles le savent et en souffrent. Pourtant elles continuent, car elles ne parviennent pas à renoncer à être aimées. "
Mais toutes ces choses ont toujours été dans le monde... Houellebecq est un beau macho et bien prompt à l'amalgame, celui de la clique qui insulterait d'ailleurs aujourd'hui Casanova !! Dans ses livres il parle surtout de relations tarifées, c'est davantage franc peut-être, mais ça ne fait forcément de lui un second Byron ou un deuxième Albert Cohen. Ses livres sont parfois ennuyeux... Enfin pour l'addiction globale du monde au prozac et autres drogues autorisées et le devoir d'être insupportable, là il est certes dans le vrai.
La niaiserie est de rigueur, ça au moins c'est sûr...
[CQFD]
N.B: avec l'ignorance bien évidemment. Un peu d'ailleurs comme dans La Possibilité d'une île.
En effet c'est toujours très instructif de voir, d'une part, par qui Houellebecq est détesté (wokism, cancel cult, gauchecultu) alors que d'autre part, il est normal que "tout le monde soit dérangé" par son œuvre.
Ça pique toujours un peu avec MH -comme le réel-, c'est probablement une œuvre importante
Pour son prochain roman (s’il y a), il va en avoir, de la matière !..
Merci pour cette belle lecture qui m’a permis de clarifier encore l’intérêt et l’estime que je porte à l’œuvre de Houellebecq… malgré des passages qui me hérissent (particulièrement dans Sérotonine).
"Un univers personnel désolé et désolant (cf. le regretté Cyrille Fleischman, l"auteur des savoureux "Rendez-vous du métro Saint-Paul", après la parution des "Particules élémentaires").
Merci pour cette belle lecture qui m’a permis de clarifier encore l’intérêt et l’estime que je porte à l’œuvre de Houellebecq… malgré des passages qui me hérissent (particulièrement dans Sérotonine).
Ne pas confondre l’homme et l’auteur, Mais surtout, parce que dans un langage cru et sans nuances, Houellebecq dénonce l’échec d’une civilisation...... Je reprends la phrase de l'article pour la commenter. Il va sans dire qu'un média souhaite dissocier souvent un homme d'un auteur comme si l'écriture était toute neutre, comme si l'auteur n'était jamais l'homme et que l'écrit est la résultante d'études universitaires uniquement ou l'étude de faits historiques. LA vérité n'est point accessible uniquement dans les université et dans les livres. Une personalité se reflète dans son écriture. On est ce qu'on mange et l'on est ce qu'on écrit en partie du moins, le reste ce sont nos sens qui voient le monde que l'on reporte dans un livre et cela est intéressant et important. Je ne connais pas Monsieur Houellebecq pour ne l'avoir jamais rencontré. Il m'intrigue et j'espère un jour avoir l'occasion de dialoguer avec lui, car je ne suis pas sure qu'il soit aussi cynique qu'on le croit.