Gérard Oberlé ou une histoire de la liberté

« Ceux qui pensent que leur vie vaut d'être racontée, devraient toujours s'en charger eux-mêmes ». Ainsi nous parle Marc-Antoine Muret au commencement de son récit. Sa voix, lourde de tout ce que la mémoire offre de faillibles, d'inventions, de divagations, de menteries, résonne du fin fond du XVIème siècle, et nous parvient, dans ce grand bruit assourdissant, pas toujours très intelligible, d'un siècle révolu, baroque, lumineux et cruel à la fois. Un siècle humaniste. Recension parue dans le Magazine des livres, numéro 18, de juillet et août 2009. Le voici désormais accessible dans l'Ouvroir.
Naturalia non sunt turpia
(Ce qui est naturel n'est pas honteux)
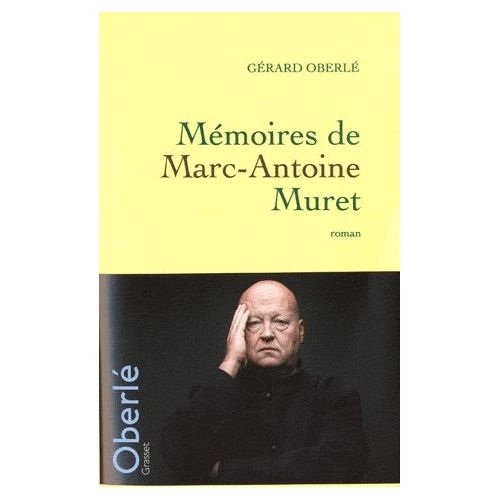 « Ceux qui pensent que leur vie vaut d'être racontée, devraient toujours s'en charger eux-mêmes ». Ainsi nous parle Marc-Antoine Muret au commencement de son récit. Sa voix, chargée de tout ce que la mémoire offre de faillibles, d'inventions, de divagations, de menteries, résonne du fin fond du XVIème siècle, et nous parvient, dans ce grand bruit assourdissant, pas toujours très intelligible, d'un siècle révolu, baroque, lumineux et cruel à la fois. Un siècle humaniste.
« Ceux qui pensent que leur vie vaut d'être racontée, devraient toujours s'en charger eux-mêmes ». Ainsi nous parle Marc-Antoine Muret au commencement de son récit. Sa voix, chargée de tout ce que la mémoire offre de faillibles, d'inventions, de divagations, de menteries, résonne du fin fond du XVIème siècle, et nous parvient, dans ce grand bruit assourdissant, pas toujours très intelligible, d'un siècle révolu, baroque, lumineux et cruel à la fois. Un siècle humaniste.
Une vie
La vie de Marc-Antoine Muret est l'histoire d'une liberté. C'est-à-dire, l'histoire d'un homme qui agit selon sa nature en dehors de tout déterminisme. L'histoire d'un homme qui écoute son corps. C'est l'histoire d'un homme qui préfère aimer et jouir d'un savoir que de recevoir les honneurs destinés aux serfs sociaux ; qui choisit l'errance du poète et la débauche à la servitude morale. C'est donc l'histoire d'une vie assez peu ordinaire que nous offre Gérard Oberlé. Celle d'un homme qui a su trouver ce courage de ramasser sa liberté ; celle d'un homme qui a eu la farouche volonté d'assumer cette liberté naturelle, donnée à la naissance de chaque individu.
C'est l'histoire d'un homme qui ressemble de très près à des intellectuels, des poètes, des philosophes qui ont su goûter aux délices que nous offraient la vie et notre nature, sans la moindre honte, la moindre gêne ; caractères affirmés, tournés vers la vie et le bonheur, et fuyant les honneurs (« qui déshonorent », comme le disait Flaubert.)
À l'instar de Casanova, Lord Byron, Montaigne, La Boétie, Marc-Antoine Muret est un homme qui nous dit ce qu'est la liberté. Et nous l'enseigne par sa propre vie.

Gérard Oberlé à table avec Bernard Pivot, photographie Jacques Lange
Le temps du récit
C'est donc au moment où « son sable est presque passé », aux portes d'une vie qui s'achève, qu'une « foule de souvenirs mélancoliques ou joyeux » vont être désormais couchés sur le papier. C'est ainsi que se clôt et s'ouvre le récit de l'existence faîte de convictions et de débauches de Marc-Antoine Muret. C'est sur un aveu qu'il entame ses mémoires : « J'ai vécu deux vies, deux vies de même durée, mais fort dissemblables, car la seconde fut comme l'antithèse de la première. »
Et l'homme qui nous parle, sait combien une vie peut être faîte de ces délices consommés que l'on censure au nom de la morale, de ces imprévus qui font toute la consistance et la fragilité d'une existence ; cet homme sait combien l'indépendance d'esprit peut coûter cher à celui qui ose l'assumer. Celui qui s'adresse à nous ici, est l'un de ces grands humanistes de la Renaissance qui eut comme élèves Montaigne, Jodelle et quelques autres poètes. Celui que l'on ressuscite ici, dans une langue chatoyante et charnelle, est lui-même un poète qui fut l'ami de Ronsard et de Baïf.
Liberté chérie
Cet esprit élégant et subtil, qui nous parle, a, toute sa vie, chérit la liberté, les livres, la musique, la table, le vin et les beaux lurons. Aussi, confesse-t-il sans remords ni regrets, qu'à cinquante-huit ans, il ne se trouve pas étonné de recevoir son « lot de délices et de peines » qui ne sont que la récompense et la rançon d'une vie qui fut célébrée et vécue sur le mode de la malice et parfois de l'irrévérence. Une vie vouée aux lettres qui lui offrirent la consécration littéraire, à la musique qui lui offrit la joie, à la gourmandise qui lui brisa la santé, aux pratiques voluptueuses qui furent autant d'infirmités qui « ont feutrés (ses) penchants d'homme de chair aussi bien que (ses) humeurs belliqueuses de savant. »
Aussi, je voudrais, ici, par ces quelques lignes, vous parler d'un homme dont l'histoire vous hantera pendant encore longtemps. Celle d'un homme qui a vécu sans ressentir la moindre nécessité de condamner sa nature, au nom d'un devoir moral abject, que la société des hommes s'impose. L'histoire d'un artiste qui s'est accordé le droit d'aimer la beauté des jeunes hommes sans craindre les réprimandes de l'éternel et qui, pour ce penchant dit « contre-nature », fut condamné à Paris, brûlé en effigie à Toulouse, chassé à Venise, et pour ce même penchant, obtint la citoyenneté de Rome. Allez donc comprendre !
Préservez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge
Gérard Oberlé écrit ce récit pour que l'on se souvienne, et que l'oubli du latin, la mort des langues d'autrefois n'enterrent à jamais ce poète qui vécut en homme affranchi, et qui fut sûrement, l'un des plus beaux humanistes français. Il déclare d'ailleurs à propos de ce personnage qu'il ressuscite : « Pour moi, il incarne la Renaissance. Les poètes de la Pléiade l'ont eu pour maître. Montaigne, avant, aussi. »
Il aura pourtant été renié par ses amis, Marc-Antoine, par son pays ; il aura échappé deux fois au bûcher, car on n'aimait pas les sodomites en ce temps-là. Et, de Paris à Toulouse, ou encore de Bordeaux à Venise, puis enfin à Rome où il finit par trouver grâce, c'est un peu comme si les sociétés occidentales ne pouvaient supporter à la vue, un homme de lettres, cultivé et délicat, vivre en accord avec ses maîtres, et surtout, en accord avec ses désirs.
Il fut de cette race de « Maudits », que l'on s'efforça d'oublier, dont on prit soin d'effacer la moindre trace de son passage, de refouler dans l'inconscient collectif, de s'acharner à en fournir une image caricaturée, si l'on ne l'avait tout bonnement pas jetée aux « oubliettes » de la culture.
Voilà pourquoi, très certainement, Gérard Oberlé s'entête à dépoussiérer ce nom d'un de nos précieux humanistes, de rendre ses lettres de noblesse à un poète oublié. Il nous a peint, dans une langue absolument magistrale, l'histoire d'un homme qui a reçu tous les présents : envahi de livres depuis l'enfance, pétri de culture classique, latin et grec, un enseignement qui a forgé un caractère, puis l'a sauvé, qui a fort vite claqué la porte des salles de classe, s'est détourné de ses profs (qui n'étaient à ses yeux que des « savantasses »), a erré, et a payé une vie d'errance le prix fort. Il nous offre dans style fort maîtrisé, des mémoires qui ne pâliraient pas de honte devant celles d'Hadrien. Il nous raconte une histoire en deux temps.

Gérard Oberlé dans son manoir
Deux existences
« Tavernes, bordiaux, prison, de ma vie de brigand ce fut le lot ! Adieu, Marc-Antoine, pardonne-moi de t'avoir traîné dans mon enfer. » C'est ainsi que la vie vous mène. Car elle est sans appel. Vous pouvez vivre heureux, être aimé, vivre à votre fantaisie, et rien ne pourrait laisser présager le malheur qui va bientôt fondre sur vous. Et pourtant ! La fracture est là ! Le couperet tombe ! La prison, puis la fuite et l'errance, Marc-Antoine est de ces hommes que ni le destin, ni la prison n'aura épargné. Il va pourtant assumer sa vie jusqu'au bout. Une vie faîte de choix et de rencontres : « J'étais un Bragard exubérant, mais c'était moi seul, et non la fatalité, qui minait le sol sur lequel je batifolais. Le désastre ne se serait peut-être pas produit si j'avais croisé plus tôt l'astre qui a bouleversé ma vie au cours de la deuxième année de mon séjour parisien. Trente-deux années se sont écoulées depuis notre rencontre, mais ma main tremble autant que mon coeur au moment où j'écris son nom sur ce cahier. Il s'appelait Luc-Memmius Frémyot et venait de Bourgogne ».
De professeur qui ne trouve pas de chaire à l'Université pour cause de « mauvaises moeurs », chassé et menacé du bûcher de Poitiers à Venise, c'est finalement à Rome que Marc-Antoine va trouver grâce, en revêtant un habit d'ecclésiaste. Deux existences menées sur le mode de la dichotomie absolue. Deux existences qui montrent que l'on peut être honni sur sa terre natale, et auréolé sur une terre d'accueil. Mais surtout, que la morale étriquée des bourgeois, la vie austère des aristocrates n'auront su avoir raison d'un hédonisme éclairé, et d'un ami des lettres.
Alors oui ! La détermination de certains à maintenir Marc-Antoine dans l'illégitimité, à le pourchasser, à le réduire au désespoir aura tourné court. À cinquante-huit ans, l'artiste qu'il est, qu'il fut, ce poète maudit, infréquentable qu'il fallait enterrer vivant, dont tout devait être fait pour que le public oublie jusque son existence, son nom, et qui s'était reconverti à une vie vouée à Dieu pour échapper à la censure et la mort, de Poitiers à Paris, et de Bordeaux à Venise, protégé pourtant à Rome, écrit, narre son récit pour son neveu, le jeune Marc-Antoine.
Il raconte son histoire rocambolesque et atypique, de sa naissance à sa mort.
Ce livre est un roman
Sa mort. Elle survient le 4 juin 1585.
Après de longues souffrances, Marc-Antoine Muret s'éteindra dans les bras mêmes de son fidèle François Benci. Cette mort aurait d'ailleurs dû être le linceul recouvert à jamais sur le nom d'un poète, dont les vers en latin, à jamais oubliés du public, auraient été semés aux quatre vents. Mais c'était sans compter sur quelques passionnés, dont Gérard Oberlé, latinistes convaincus, qui ont exhumés cette belle histoire de la liberté, pour donner le change à une époque, où l'esprit des lettres, les humanismes, et l'esprit d'indépendance semblent sur le déclin.
O quoties obitum linguae statuere latinas !/Tot tamen exequiis salva supertes erat ! ( Sans cesse on proclame que le latin est mort / et pourtant il a survécu, sain et sauf à chacun de ses enterrements !), Joseph Eberle, Lingua Morta.

Gérard Oberlé en train d'écrire
 Paru dans le Magazine des livres, n°18, juillet/août 2009.
Paru dans le Magazine des livres, n°18, juillet/août 2009.
(À propos de Gérard Oberlé, Mémoires de Marc-Antoine Muret, Grasset, 2009)