Le surhomme de Nietzsche, cet homme malade
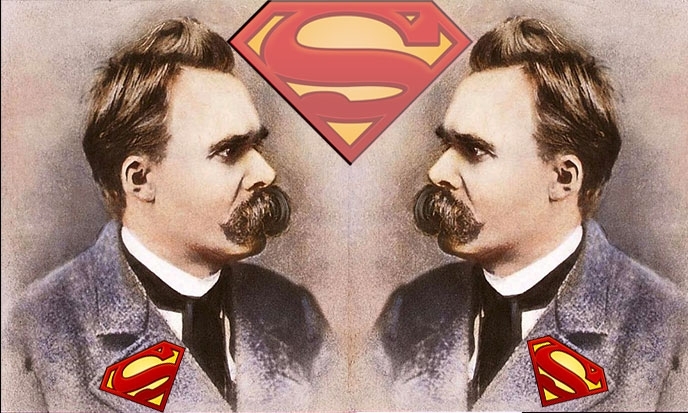
Doit-on parler de la maladie de Nietzsche ? Le philosophe allemand Karl Jaspers le pense, car, chez notre penseur du dix-neuvième siècle, ce qui prédomine dans son œuvre, c’est une idée existentielle de la grande santé. Et cette idée, qui traverse toute l’œuvre, « se rapporte à la valeur de l’homme dans la totalité de son rang existentiel ».
Impossible de comprendre Nietzsche si l’on ne lit pas ses livres à partir de la maladie et de la bonne santé. Je sais, certains vont m’accuser de lire le penseur du surhumain à partir des lunettes de vue de Gilles Deleuze, et ainsi, de m’être entiché de mauvais maîtres. Pourtant, tel que le philosophe universitaire le dit : « La maladie [...] constitue plutôt une intersubjectivité secrète au sein d’un même individu. » Comment devons-nous donc le voir ? La pensée de Nietzsche serait donc cette pensée des hauteurs, qui penserait la maladie comme une évaluation de la grande santé et la grande santé comme une évaluation de la maladie. Cette idée de Gilles Deleuze me semble être une idée forte à partir de laquelle il convient de lire Nietzsche.
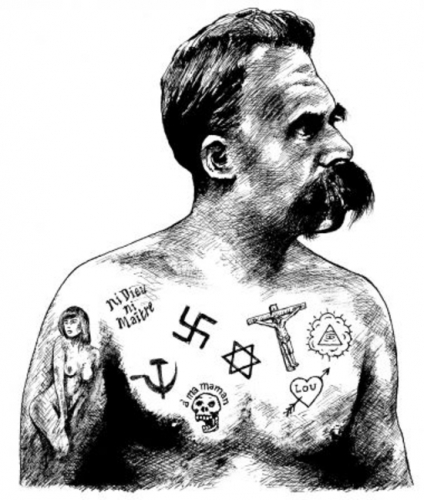
Caricature efficace de Nietzsche
Gilles Deleuze le raconte très bien dans son petit opuscule intitulé très sobrement Nietzsche, c’est grâce à son fidèle ami Overbeck que le père du Zarathoustra obtint une faible pension, qui fut le déclencheur d’une vie voyageuse, à la recherche de climats favorables entre la Suisse, l’Italie ou le Midi de la France. Avant d’être presque oublié et de s’enfoncer dans la solitude, Nietzsche fut célèbre, d’abord pour son premier livre Naissance de la tragédie (1871), puis ses quatre Considérations intempestives (1873-1876) dont la première consacrée à David Strauss sera un succès, et la quatrième Richard Wagner à Bayreuth consommera les réserves explicites à l’endroit du célèbre musicien. S’en suivent Humain, trop humain (1878) puis Le Voyageur et son ombre (1879), Aurore (1880) et le Gai Savoir (1882) dans lequel il rapporte un nouveau concept, trouvé au bord du lac de Silvaplana, en août 1881, celui de l’éternel Retour[1]. Entre 1883 et 1885, ce sera l’écriture de ce livre, qui à mon sens est, avec La Volonté de puissance, le socle même de l’œuvre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Puis, ce sera Par-delà Bien et Mal (1886), Le livre V du Gai Savoir, Généalogie de la morale (1887), Le cas Wagner, le sublime Crépuscule des idoles et L’Antéchrist (1888) et enfin, Ecce homo, envoyé à l’éditeur mais ayant fait office de publication posthume en 1908.

Derrière le soi-disant fou sommeille le surhomme
À partir de 1888, Nietzsche se met à envoyer des lettres totalement délirantes à son ami A. Strindberg, parmi lesquelles on compte cet étrange moment (cité par Gilles Deleuze dans son texte) : « J’ai convoqué à Rome une assemblée de princes, je veux faire fusiller le jeune Kaiser. Au revoir ! Car nous nous reverrons. Une seule condition : Divorçons... Nietzsche-César. » Quelques jours plus tard, le 3 janvier 1889, ce sera la crise puis l’effondrement. S'en suivent l’apathie, l’agonie et enfin la mort à Weimar en 1900.
« Nietzsche est reconnaissant à la maladie de la coopération décisive qu’elle apporte à son itinéraire spirituel », écrit Karl Jaspers dans son introduction à la philosophie de Nietzsche. Ainsi, il n'y a donc rien à dire, je crois qu’on ne peut pas comprendre la philosophie du philosophe allemand si on ne part pas de la maladie. Pour beaucoup, je sais que c’est abaisser l’œuvre que de choisir cette porte-là de la compréhension. Mais on voit bien que Nietzsche, contre Socrate, le dialecticien, le métaphysicien, celui qu’il accuse d’avoir déprécié la vie, se veut médecin, médecin de la civilisation. Et c’est avec le martelet du médecin qu’il prend le pouls des idoles de son époque, mais aussi des époques précédentes, contre la dégénérescence de la philosophie, qui, par la main du dialecticien grec, se retourne contre elle-même. Pour ce philosophe artiste et médecin, qui n’aimait pas cette génération de philosophes, dont Socrate est le représentant privilégié, évaluant la vie et son aptitude à porter les plus grands fardeaux, ceux des valeurs supérieures, qui ne sont autres que le Divin, le Vrai, le Beau, le Bien ; il préférait les créateurs et les législateurs, car ceux-ci étaient danseurs, aux dialecticiens et métaphysiciens, amoureux de la raison et de la logique, parce que c’était pour lui le signe d’une dégénérescence de la philosophie et de ce philosophe qui, soudain, se comporte comme un soumis.

Nietzsche malade à la fin de sa vie
À la dialectique, Nietzsche oppose la Volonté de puissance qui consiste à créer et à donner. On le sait bien, et Gilles Deleuze exprime bien ce concept en disant : « la volonté de puissance fait que les forces actives affirment, et affirme leur propre différence ; en elles, l’affirmation est première, la négation n’est jamais qu’une conséquence, comme un surcroit de jouissance. » Or, définir ce qu’est la volonté de puissance revient à définir ce qu’est le surhomme dans le domaine du vivant. Et c’est par-là que la maladie s’infiltre. Le surhumain est cet être qui assume la volonté de puissance, ce désir vital, ce souffle de vie qui exprime que nous sommes vivants. Il y a donc une puissance créatrice supérieure chez ce surhumain. Supérieur à l’humain, comme l’humain est supérieur au singe. Pour un tel chimpanzé, un bout de bois devient subitement un outil, un commencement de civilisation, comme Stanley Kubrick le montra si bien dans 2001, l’odyssée de l’espace. D’objets naturels éparpillés, rassemblés, hiérarchisés, regroupés sous un symbole et un signifiant, voilà que vient le monde de la culture, la structuration d’un monde à vivre, Peter Sloterdijk parle de « la domestication de l’Être ». Cette domestication du monde vient de cette tendance s’inscrivant dans un processus variant au fur et à mesure de l’avancée des hommes, passant de l’hominisation à la surhominisation, comme le surhumain erre entre un monde et l’autre. Et, de l’humain au surhumain, il faut nécessairement la Volonté de puissance.
Or, voilà que l’on met le doigt dans l’engrenage. On sait depuis que l’on a lu Gilles Deleuze (Nietzsche et la philosophie aux PUF) – mes obsessions, pardonnez-moi ! – que « le projet le plus général de Nietzsche consiste en ceci : introduire en philosophie les concepts de sens et de valeur ». Or, on sait que la maladie est l’affaire de la vie de Nietzsche. Tout est maladie en lui et autour de lui. La maladie occupe dans l’univers de Nietzsche une place centrale. Excessive. (Je renvoie d’ailleurs à ce propos au livre de Karl Jaspers, pp. 103 sq. dans la collection Tel Gallimard, car je n’ai ni le temps ni l’envie de développer !) La maladie l’a conduit jusque dans le Midi de la France, solitaire à Sils-Maria, loin de son poste de professeur de philologie à Bâle, de sa sœur et de sa mère (qu’il pense détester au plus au point). La maladie, qu’il pressent dans toute une civilisation, le conduit même jusqu’à condamner la quête du sens (je pense par exemple au Crépuscule des idoles, « Les quatre grandes erreurs » §2) Et c’est ainsi, à partir de cette errance existentielle liée à la maladie, qu'il est aujourd'hui l’homme brisé qu’il est devenu peu à peu. C'est à cause d’elle ! C’est de ces maux et de cette expérience unique que la maladie lui a conférés, qu’il a écrit son œuvre aussi. Ne l’oublions pas ! Et c’est d’ailleurs, dans l’avant-propos du Gai savoir, que Nietzsche va mettre en lien, la grande maladie et la grande santé, le corps malade et la systématisation philosophique, allant jusqu’à écrire, que c’était « à se demander si la maladie n’était pas ce qui inspirait le philosophe ».

Nietzsche contre le christianisme
L’homme sera donc « l’animal malade » dont la maladie et la souffrance oblige à chercher un sens à sa vie, qu’il trouvera sûrement dans les arrières-mondes qu’offre la foi chrétienne, et par conséquent, il deviendra friand des idéaux ascétiques. (Là non plus je ne développe pas, je pense qu’une lecture attentive de Par-delà bien et mal et surtout de Généalogie de la morale devrait vous guider dans cette idée.) Dans cette dérive, on retrouve une « volonté de vérité à tous prix » pour reprendre la formule de Nietzsche lui-même (je vous prépare un article sur le sujet, mais un peu de patience, que diable !...), car, si elle n’intéresse pas, néanmoins elle comble une volonté défaillante.
Là donc, où les hommes cherchent du sens, pour faire barrage à la maladie, c’est le sens établi qui, soudain, redouble la maladie. Inspirée par Socrate, ce fauteur de troubles, son rationalisme moteur d’une dialectique devenue folle (voir à ce propos Crépuscule des idoles « Le problème de Socrate ») cette maladie nourrit l’esprit chrétien, voire toutes les religions qui offrent à l’incertitude du monde, la certitude d’une vérité illusoire. Et c’est justement, parce que la maladie apparaît dans cette faiblesse de la volonté, que Socrate et le christianisme entendent consoler et calmer, que Nietzsche pense qu’un médecin est nécessaire, médecin que l'on trouve en la présence de Zarathoustra. La « transmutations de la volonté » sera donc le moyen de la guérison, même s’il faudra s’armer de patience, et que ce sera à la fois pénible pour le patient et exigeant en termes d’efforts. Du « non » à la vie, à l’incertitude du monde, à l’impermanence des choses, « la transmutation des valeurs » doit amener l’homme à dire « Oui » à tout. Rendu disponible au monde, l’homme rejettera les « arrières-mondes », se délivrera de sa faiblesse, et acceptera que le monde est et sera à jamais insaisissable.
Pourtant, si dans la préface du Gai Savoir, Nietzsche sait qu’il ne pourra promettre un accès facile à la « grande santé », la sienne lui devient très vite insaisissable, au point qu’au moment où il se sent guéri, il s’affale, il tombe, il s’effondre dans une rue de Turin. On peut bien gloser sur cet effondrement, sur ce surhomme, cette « grande santé » tant recherchée, il n’empêche que le surhomme est malade. À force de refuser le sens et la quête de sens, au nom d’un monde, non pas insensé mais plus insaisissable, on pressent qu’en Nietzsche, le sens s’est dérobé sous ses propres pieds et l’a rendu fou. Néanmoins, il faut garder en tête son enseignement, car même si son ambition n’était au final que folie, un exercice authentique de la raison passe sûrement par l’acceptation de ce qui est, à savoir la finitude humaine, l’impermanence du monde, cela s’appelle le « perspectivisme », mais il ne s’agit pas de dire ce qu’est le monde, ni même de refuser la quête du sens, ce qui relève-là plutôt d’un non-sens, mais il faut, comme le faisait Socrate, vouloir le sens en sachant bien, non-dupes que nous sommes, qu’il se dérobe toujours au dernier moment. Néanmoins, refuser cette idée à rendu malade le surhomme...

Nietzsche (1844-1900)
_______________________________
[1] Je renvoie à l’analyse de ce concept de Gilles Deleuze dans son Nietzsche et la philosophie, PUF, 1962. Concept, je le crois profondément, bouleversant pour tout homme qui a une fois ressenti ce retour non comme une simple répétition mais comme une profonde sélection du différent.
Commentaires
Réflexion très intéressante donc à relire. Merci à vous
L'amusant c'est que Nietzsche considérait la compassion comme une faiblesse maladive ; cependant, c'est en voyant un cheval de fiacre maltraité qu'il s'insurgea en pleine rue, ce qui le fit déférer à l'asile... On soutient même qu'il parla au cheval, mais personne n'a jamais su ce que le cheval lui répondit...
J‘en ai fait une première lecture, d‘autres suivront pour essayer d‘en comprendre un bout...
Qui a dessiné cet image ?
Marc Alpozzo : oui oui, ça peut rassurer que Nietzsche soit fou, etc. M'enfin dans Rigodon (Céline, Roman II, Pléiade, p. 739, "Haupt le médecin Nietzschéen"), on l'évoque, Nietzsche, après cela, je vous invite à réfléchir à le relation entre folie et histoire, mais pas en trop de mots, si c'est possible, dire le plus de choses dans le moins de mots "ce qui se conçoit clairement...", enfin c'est pas facile, alors allez-y... ou bien quand même, en peu de mots. Qui a le temps ou le courage (pour ce qu'il en reste du courage...), de lire de longues dissertations ici ? des pensums ?