L'artiste, l'oeuvre. À propos de Jean-Pierre Pincemin. Entretien avec Maryline Desbiolles

Il s'avère que je connais Maryline Desbiolles depuis mes années de lycée, puisqu'elle a été mon professeur de lettres. J'ai été à la fois très surpris par son premier roman à sa parution, Une femme de rien (Mazarine, 1987), et profondément marqué, au point que je l'ai suivie dans toutes ses séances de signature dans les librairies niçoises, vers la fin des années 80. Le temps est passé, et elle a trouvé une juste reconnaissance avec son roman La seiche (Seuil, 1998). Puis nous sommes devenus amis. Il s'avère qu'en parallèle de cette amitié-là, je me suis attaché à une autre, et celle-ci n'était pas moins que la fille de l'artiste Jean-Pierre Pincemin lui-même, décrit par Maryline Desbiolles dans ce roman. La parution des draps du peintre fut un choc pour cette jeune demoiselle, qui ne décolérait plus depuis sa lecture du portrait de son père qu'en fit Maryline Desbiolles, et qu'elle disait infâme. J'étais alors très embarrassé, car je devais réaliser un entretien pour le Magazine des livres, et j'ai été pris entre deux feux. Mon choix s'est alors porté sur la littérature, dont on connaît ô combien la subjectivité. Si ce peintre, et père de famille, jouissait d'une représentation idéalisée dans l'esprit de sa fille, qu'elle défendait d'ailleurs jalousement, ce qui est parfaitement son droit, Jean-Pierre Pincemin n'en était pas moins un homme public et, à cet effet, pouvait être décrit par une romancière, sous l'angle de sa propre subjectivité. Nous avons donc réalisé cet entretien, avec l'auteur d'Anchise, dans une brasserie à Nice, et celui-ci est paru dans le site du magazine. Le voici désormais accessible dans l'Ouvroir.
Marc Alpozzo : Ma première question portera sur le genre même de votre dernier roman. Peut-on parler justement de « roman » à propos de votre dernier ouvrage, Les draps du peintre[1] ? Car pour la première fois, de tous vos livres, ça n’est pas spécifié sur la page de garde.
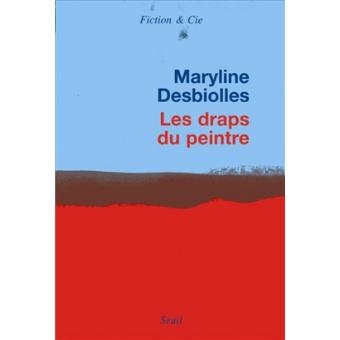 Maryline Desbiolles : C’est rare qu’on le remarque, mais oui, en effet, on s’est interrogé avec l’éditeur, et il me proposait des choses. Je pense qu’ici en effet, la question de son genre est importante, car c’est un livre qui cherche justement son genre, et je ne saurai actuellement vous répondre à ce propos. Ça n’est pas un genre qui préexiste à ce livre. Il y a du documentaire, il n’y pas de fiction. Mais le fait que ce ne soit ni un documentaire ni une biographie, relève alors de l’engagement de l’écriture. Le pari que l’écriture va trouver quelque chose, que des choses vont apparaîtrent, vont être dénouées dans les quelques connaissances que j’ai du peintre.
Maryline Desbiolles : C’est rare qu’on le remarque, mais oui, en effet, on s’est interrogé avec l’éditeur, et il me proposait des choses. Je pense qu’ici en effet, la question de son genre est importante, car c’est un livre qui cherche justement son genre, et je ne saurai actuellement vous répondre à ce propos. Ça n’est pas un genre qui préexiste à ce livre. Il y a du documentaire, il n’y pas de fiction. Mais le fait que ce ne soit ni un documentaire ni une biographie, relève alors de l’engagement de l’écriture. Le pari que l’écriture va trouver quelque chose, que des choses vont apparaîtrent, vont être dénouées dans les quelques connaissances que j’ai du peintre.
Vous racontez, à travers le récit, l’histoire d’un peintre qui n’est jamais nommé, le narrateur s’y refuse systématiquement. On peut toutefois admirer une de ses œuvres sur la couverture de votre livre. C’est précisément Jean-Pierre Pincemin, qui est l’un des représentants du courant artistique « support-surface », mais qui n’est toutefois pas si bien connu du très grand public. Il était, à une époque, une de vos connaissances personnelles, pourquoi ce choix ? Diriez-vous le narrateur, c’est moi ?
Je vais essayer de vous répondre le plus franchement possible. Je m’intéresse beaucoup à la peinture. J’ai écrit sur la peinture. Je vis avec un sculpteur qui a fait partie du mouvement « support-surface », qui a connu Jean-Pierre Pincemin, et j’ai pas mal d’œuvres de ce peintre chez moi. Ça compte dans cette démarche. Et il se trouve que j’ai raconté un jour à mon éditeur une rencontre que j’ai faîte de Jean-Pierre Pincemin. Et à ma grande surprise, mon éditeur m’a dit qu’il fallait que j’écrive là-dessus. Vraiment, j’ai ri. Je lui ai d’ailleurs dit que lorsqu’on arrivait à parler de quelque chose cela n’engageait généralement pas l’écriture. Je crois que cette dernière porte plus sur des choses dont on n’arrive pas à parler. Pourtant, c’est quasi à cause de mon éditeur que j’ai écrit ce livre, car durant des années, il ne m’a pas lâchée. C’était devenu tel, qu’on en avait fait une sorte de « private joke ». Cela dit, l’éditeur ça n’est pas un copain, et le fait d’en parler avec lui, c’est tout de même quelque chose, symboliquement. Et un jour, un an plus tard, on n’était plus sur le mode du rire cette fois, il me dit « Maryline, vous devez absolument écrire ce livre, c’est votre vie ». Et là, je dois dire que cela m’a ébranlée. Donc, d’une certaine manière, c’est un travail de commande. Cela dit, il a fait là un vrai travail d’éditeur : il a eu une intuition, et en ce sens, je lui rends hommage. Et en même temps, j’ai redouté d’entrer dans le travail de rédaction de ce livre, car je sentais bien que ce serait coton. Et je ne me suis pas trompée. Ce que j’ai maudit cette commande.

Jean-Pierre Pincemin, Authon la Plaine - 2003 -
Photographie - Collection particulière - Photo © X. Gary
« Coton » à quel niveau ?
J’espère que ça ne se sent pas dans le livre, mais ça été le livre qui m’a été le plus difficile à écrire.
Ça ne se sent pas. Je le confirme. Mais j’ai deux questions par rapport à ce livre. Je dois d’abord vous dire, entre parenthèses, que je vois trois périodes chez vous : celle qui s’étend de votre premier roman Une femme de rien[2], certes passé inaperçu à l’époque, mais qui constituait pourtant déjà le grand départ de votre œuvre romanesque, jusqu’au recueil de nouvelles, Les chambres[3]. C’est une Maryline Desbiolles qui est encore en pleine révolte, sur le plan existentiel, métaphysique et social. Puis il y a eu la deuxième période à partir de La seiche, c’est une œuvre plus apaisée, qui entre dans d’autres normes, même si l’on retrouve certaines caractéristiques des personnages de la première période, puis à partir de Primo[4], je dirais que vous être entrée dans la période du « romanquête. » Êtes-vous de cet avis ? C’est ma première question.
 Oui, depuis Primo, dans lequel je m’intéressais là à l’histoire de ma grand-mère, et c’est effectivement le roman où je suis le moins. Même si c’est à propos de ma grand-mère. Il y avait là de l’enquête justement. Ceci dit, il me semble aussi que, malgré tout, dans Les Draps du peintre, il y a de l’homme de rien.
Oui, depuis Primo, dans lequel je m’intéressais là à l’histoire de ma grand-mère, et c’est effectivement le roman où je suis le moins. Même si c’est à propos de ma grand-mère. Il y avait là de l’enquête justement. Ceci dit, il me semble aussi que, malgré tout, dans Les Draps du peintre, il y a de l’homme de rien.
En effet, je le crois aussi. Alors pour continuer. Ma seconde question : pour reprendre la mythologie qui nous fait dire que chaque écrivain n’écrit jamais que le même livre, dans la même veine que cette Femme de rien qui traitait de la dérive et de la déchéance d’une femme dont on ne sait si elle est prostituée ou SDF ou les deux, Les draps du peintre est une sorte de cheminement artistique d’un autodidacte surdoué qui progresse et dérive, à la fois ouvrier, et artiste, riche et pauvre. On a en même temps, l’impression que cela va beaucoup plus loin. Quelle part de vous, j’aimerais vous demander, avez-vous introduit dans ce livre, tant on a le sentiment que ces deux romans se font écho ?
En même temps, je ne me reconnais pas du tout dans une femme de rien, sociologiquement parlant.
En effet, j’en suis convaincu. Mais sur le plan existentiel ?
Oui, sur le plan existentiel, bien sûr. Mais dans ce livre, Les draps du peintre, tout ce que je dis est vrai. Je n’ai rien inventé. Et dans Une femme de rien tout est faux. Je me suis servi de ce que j’avais sous la main. J’ai fait avec des œuvres, des catalogues, des écrits de l’artiste, des lettres de lui, et des rencontres. Je n’ai pas un point de vue de connaisseur. J’ai fait avec un peu. Mais cet « un peu » est une condition d’écriture, je pense. Car l’écriture peut s’immiscer dans ces lacunes, dans le fait que je ne maîtrise pas du tout la situation. Je vis avec tous les doutes, tous les trous de mon histoire. Alors l’écriture invente, je dirais, malgré elle. Bien sûr, je n’ai rien inventé, mais j’invente une relation d’écrivain avec lui. C’est le parti-pris de l’écriture qui fait que cela engage l’écriture sur un autre terrain que celui de l’objectivité – auquel je ne crois d’ailleurs pas – ou de la biographie.
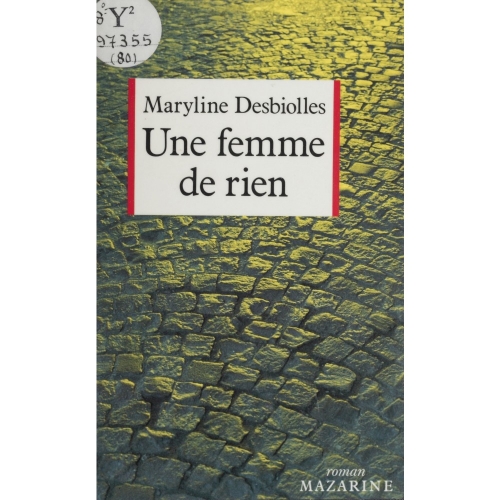 Une femme de rien, premier récit, et comme dans tout premier récit, l’auteur parle toujours de lui, si j’ose dire. Or, c’est justement une femme qui, sur le plan existentiel, est à la dérive, ou qui essaye de se trouver une place et une personne quelque part, mais qui se trouve dans le néant, c’est-à-dire le néant existentialiste, celui de Sartre, la facticité, tout ne tient à rien, cette femme de rien ça ne tient à rien, elle aurait pu être autre chose, elle aurait pu être princesse…
Une femme de rien, premier récit, et comme dans tout premier récit, l’auteur parle toujours de lui, si j’ose dire. Or, c’est justement une femme qui, sur le plan existentiel, est à la dérive, ou qui essaye de se trouver une place et une personne quelque part, mais qui se trouve dans le néant, c’est-à-dire le néant existentialiste, celui de Sartre, la facticité, tout ne tient à rien, cette femme de rien ça ne tient à rien, elle aurait pu être autre chose, elle aurait pu être princesse…
Elle aurait pu être autre chose. C’est le mot. Et combien Jean-Pierre Pincemin…
Et d’ailleurs, les deux luttent… L’incipit d’une Femme de rien débute par : « Elle se tranche le doigt ». Mais « elle », ça n’est personne. On peut tous se reconnaître en « elle ». C’est le signe des personnes à la fois absolues et relatives…
C’est vrai, en effet, et en plus, lorsque vous me dîtes « Elle se tranche le doigt », soudain, je m’aperçois avec stupeur que Jean-Pierre Pincemin a les doigts et les pieds coupés. Je ne l’avais pas remarqué jusqu’ici… Maintenant que je découvre, je crois que c’est le lien des personnes qui ne sont pas complètes.
Ouvrier, Jean-Pierre Pincemin n’avait rien à faire avec la peinture. Surtout en France, la peinture appartient au monde des bourgeois. Il y a donc cette schizophrénie, cette ambivalence qui font qu’à tout moment, il aurait pu passer à côté de son destin...
Pour moi, c’est un héros précisément parce qu’il aurait pu faire autre chose, mais qu’il est devenu peintre, connu dans le milieu de l’art, qu’il a réussi, car il vendait ses toiles très chères, et qu’il est exposé aujourd’hui dans les musées.
Le narrateur n’a pas toujours un œil très complaisant sur le peintre. Il le regarde un peu comme quelqu’un d’étrange qu’il ne parvient pas bien à saisir, comme si le peintre essayait toujours de se dérober au regard et à l’intelligibilité, comme s'il voulait échapper au regard, qui observe et qui juge. Est-ce que c’est ainsi que vous l’avez travaillé ce personnage ?
Oui, et puis aussi c’est un personnage qui me rebute. Comment dire ? Je ne suis pas d’emblée du côté de la femme ou de l’homme de rien, au fond. C’est ambivalent. Donc, en même temps, il me rebute. Je lutte contre. Ne serait-ce, que parce qu’il est déplaisant, crasseux…
Il avait une détestation des bourgeois, des conservateurs, des collectionneurs même qui achetaient ses œuvres, et qu’il traitait par le mépris. C’était risible, mais en même temps… Il avait des côtés comme cela, il refaisait par exemples des tableaux, il prenait même un malin plaisir à les refaire la veille, histoire d’empoisonner tout le monde, il avait un côté comédien aussi, côté mise en scène de lui-même : « Puisque vous aimez ma peinture, vous devez aussi aimer mon personnage quitte à rentrer dans un univers dégoûtant. » Il faisait un peu le fou du roi. Il fallait le prendre comme il était… Il fallait donc affronter cela. Et en plus, c’était un type qui avait beaucoup de séduction, car il parlait très bien, il avait une sorte de voix comme ça envoûtante, séduction et répulsion à la fois, car il était aussi un homme pas facile qui pouvait dire des saloperies, être très cassant, on se méfiait donc un peu de lui. On avait un peu peur…

Jean-Pierre Pincemin
Sans titre
Technique mixte
C’était un rebelle, au fond. Pensez-vous que c’est la condition sine qua non pour réussir dans la peinture quand on n’est pas un bourgeois ?
Pas aujourd’hui. Les gens qui réussissent actuellement ce ne sont pas des rebelles. Socialement, c’est même le contraire.
Oui, parce qu’aujourd’hui, c’est une passade de l’histoire, nous n’avons plus d’ennemis, donc il faut être lisse.
Et puis ça n’est pas nouveau, les peintres ont souvent fait la cour aux grands, et puis peut-être l’a-t-il fait, mais il avait quand même un côté qui n’était pas assez lisse. Définitivement pas.
Mais il existait bien sur le plan de la peinture. Ses œuvres se vendaient plus chers que toutes les autres du même mouvement. Et il s’est même écarté à un moment du mouvement, car il y avait un courant théorique dans lequel il ne se reconnaissait pas, bien qu’il ait été le plus porteur d’utopie...
Le terme est lancé. Durant tout le livre, je me suis demandé : qu’est-ce que Maryline Desbiolles veut vraiment nous dire ? J’étais partagé entre le romanquête, le personnage… n’est-il pas ré-inventé ? Car après tout, vous en avez le droit, à partir du moment où vous fabriquez un roman, certes, il y aura ensuite des procès en sorcellerie, mais le romancier, c’est ainsi, il fait ce qu’il veut. Et puis à un certain stade de votre texte, je me suis dit, mais au fond, elle nous parle de l’« utopie », à la fois de l’utopie de l’art, à la fois de l’utopie d’un homme, et elle nous parle surtout d’un homme qui est allé jusqu’au bout de son utopie. On a le sentiment qu’il est un soixante-huitard qui ne s’est jamais guéri de Mai 68.
Je suis d’accord. Et en même temps, ce livre sort dans la flopée des livres sur 68. Comme quoi, on dirait qu’il n’y a pas de hasard. Les choses ont l’air, mais… Je pense qu’il y a un lien. Je pense que c’est un livre sur les utopies de ces années 70. Vous l’avez bien vu, n’est-ce pas ?
Quand je commence un livre, je n’ai pas les idées claires. J’ai une sorte d’impatience, je sais qu’il faut que j’y aille, mais je suis dans le brouillard. C’est la condition même du roman, pour moi. Certes, ce roman est un roman qui cherche. Je ne sais pas ou qu’un peu. Il cherche son genre : qu’est-ce que la peinture ? qu’est-ce que ce peintre ? qu’est-ce que l’utopie ? Oui, voilà, c’est un livre qui cherche, il y a quelque chose de cet ordre.
C’est ce que j’ai ressenti en lisant votre livre. Je me suis demandé à quel point vous n’étiez pas dans une recherche d’autre chose. Comme si vous aviez épuisé avec votre génération, je pense, le roman traditionnel, classique comme La seiche[5] qui entre encore dans un cadre classique et théorique du roman. Et là, vous ressentez comme la nouvelle génération d’écrivains, que le roman dans ce cadre-là ne dit plus rien, aujourd’hui. C’est le roman du vingtième siècle. Et on a l’impression que cette génération d’auteurs cherche autre chose, de nouveaux repères qui sont peut-être déjà là, mais que l’on n’arrive pas encore à visualiser.
Par exemple, on se souvient toujours plus des critiques que des louanges, à propos de Anchise[6], un journaliste avait dit qu’il n’était pas abouti. Eh bien, tant mieux. Pour moi, c’est la condition même de l’écriture. Je crois d’ailleurs, même si cela se manifeste de plus en plus, que c’est une condition même de l’art, au fond.
Une chose est importante pour moi, c’est le fait que l’art soit une recherche permanente, que l’on remet les choses en jeu, à chaque fois que rien ne doit aboutir. Et je salue cela chez Pincemin. Je salue le fait que cela ne se clôt pas. Et même dans la figuration, c’est une expérience nouvelle pour lui, car il ne savait pas dessiner, et là encore, il y a cette quête.
Ce qui m’a le plus marqué dans ce livre, c’est le fait que vous ne nommiez jamais le peintre ? Vous parlez du nom, citant même en épigraphe de votre livre, cette phrase du poète italien Antonio Porchia : « Plutôt que me nommer, mon nom me rappelle mon nom ». Qu’est-ce que cela à faire avec l’histoire d’un peintre, et l’histoire de l’art ? Peut-on dire que cela a un lien ? Au fond, l’art contemporain dématérialise tout, et notre monde même est en train de se dématérialiser. À quoi cela va-t-il bientôt renvoyer ? Dîtes-vous par là que le peintre est en train d’annoncer un monde qui va totalement se « virtualiser » ?
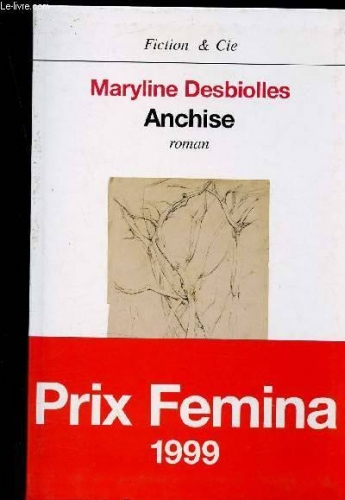 Le nom c’est le cœur du livre. C’est une question qui m’obsède la question du nom propre, d’être une personne singulière séparée des autres, d’être commun ou pas, de partager des choses. Cette question du nom propre qui vous enferme, oui, c’est quelque chose qui m’obsède. Et c’est une question qui se rapproche de celle du « moi » qui est, à mon sens, vacillante. « Moi » auquel je crois de moins en moins. Je parle du moi comme sujet, bien sûr. C’est une imposture de plus en plus, même si le mot est un peu fort. Le moi constitué avec ses goûts particuliers, je n’y crois pas, pour vous le dire clairement. C’est Je est les autres. Et en même temps, ça n’est pas une dilution. Mais c’est une posture très adolescente de définir sa singularité par des goûts très affirmés. C’est amusant. On doit en passer par là, mais en même temps… Et puis l’originalité pour l’originalité… Je n’y crois plus. Je crois qu’on partage tous les sentiments, et on les éprouve tous, à des degrés différents certes, mais croire que nous sommes les seuls à faire ceci ou cela… et c’est en cela qu’on peut lire des livres, ou aller voir des œuvres d’art… Parce que ça nous parle… Et puis cela se rapproche également de la question du genre… Cette question est là aussi en moi… Le roman n’est pas tout à fait un mauvais genre, même si c’est à mon sens un genre impur, mais c’est un genre complètement ouvert. Pour vous dire, ce que j’aime dans le roman, c’est qu’on ne sait pas ce que c’est…
Le nom c’est le cœur du livre. C’est une question qui m’obsède la question du nom propre, d’être une personne singulière séparée des autres, d’être commun ou pas, de partager des choses. Cette question du nom propre qui vous enferme, oui, c’est quelque chose qui m’obsède. Et c’est une question qui se rapproche de celle du « moi » qui est, à mon sens, vacillante. « Moi » auquel je crois de moins en moins. Je parle du moi comme sujet, bien sûr. C’est une imposture de plus en plus, même si le mot est un peu fort. Le moi constitué avec ses goûts particuliers, je n’y crois pas, pour vous le dire clairement. C’est Je est les autres. Et en même temps, ça n’est pas une dilution. Mais c’est une posture très adolescente de définir sa singularité par des goûts très affirmés. C’est amusant. On doit en passer par là, mais en même temps… Et puis l’originalité pour l’originalité… Je n’y crois plus. Je crois qu’on partage tous les sentiments, et on les éprouve tous, à des degrés différents certes, mais croire que nous sommes les seuls à faire ceci ou cela… et c’est en cela qu’on peut lire des livres, ou aller voir des œuvres d’art… Parce que ça nous parle… Et puis cela se rapproche également de la question du genre… Cette question est là aussi en moi… Le roman n’est pas tout à fait un mauvais genre, même si c’est à mon sens un genre impur, mais c’est un genre complètement ouvert. Pour vous dire, ce que j’aime dans le roman, c’est qu’on ne sait pas ce que c’est…
Alors en ce qui concerne l’art, je vais vous dire, le mouvement support-surface a été un moment très important, où il y avait vraiment l’envie de sortir la peinture de son cadre, de son châssis. Et cela moi-même m’éblouit. La question de la couleur, de l’abstraction… La question que posait support-surface était qu’est-ce que la peinture ? Et cela stimule mon livre, en effet. Ça n’est pas anodin. J’y vois non pas la continuation, mais l’incarnation de l’utopie.
Maintenant que j’ai écrit ce livre, je trouve que ce peintre est un personnage magnifique. Non pas parce qu’il est resté fidèle à sa pauvreté d’antan, car il est traître, les gens pauvres de cette époque ne vivaient pas comme lui, il met en scène de façon outrancière, et là, il y a de la rébellion, et j’aime cet extrémisme. Tous mes personnages ont cet extrémisme, Anchise, Une femme de rien, etc. La façon de sortir de son milieu, n’a pas été de devenir bourgeois, mais de le jeter à la figure des gens, d’être outrancier, et cela me fait rire, car cela me paraît être une manifestation de vie, ne pas vouloir entrer dans un certain ordre, c’est une sorte de geste flamboyant.
Il rejoint comme par hasard, la cohorte de mes personnages boiteux, mais cette boiterie est une condition d’un supplément de vie, il boite, mais il danse en même temps. C’est la manifestation de quelqu’un qui est vivant.
Même si vous ne l’exprimez plus aussi directement que dans vos premiers ouvrages, j’ai le sentiment de retrouver toujours la même révolte dans votre dernier livre ?
Oui, eh bien, tant mieux si vous percevez toujours cette révolte dans Les draps du peintre, en effet, elle est à l’œuvre, même si elle a pu prendre d’autres voix… c’est le cas de le dire… Écrire avec des voix, et mettre à l’épreuve son écriture avec des voix autres, c’est à présent mon envie. Bien que ça ne soit pas parler à la place des gens de l’Ariane[7], ou à la place du peintre, ce que je trouve d’une obscénité insupportable.
Et puis, je vais vous dire, il y avait également quelque chose dans ce mouvement support-surface, c’était de faire avec ce qu’on avait. Par exemple peindre sur des draps. Eh bien, j’ai fait pareil. J’ai évidemment des personnages forts qui m’habitent. Mais je prends le risque d’être contaminée par d’autres voix. Par un autre. Et avec Pincemin, c’était un risque majeur, car il me faisait peur. Sa solitude, sa déchéance me faisaient peur et en même temps me fascinaient.
Pensez-vous au fond, que quoi qu’il arrive, quelles que soient les mutations sociales, la situation, etc., il faut vivre en poète ? N’est-ce pas votre réponse à la déchéance, au fond, à partir du moment où l’on vit en poète on ré-enchante l’existence et on en sort vainqueur ?
Je ne dirais pas cela comme cela, dans la mesure où pour moi la poésie est liée à l’écriture. Comment dire ? D’abord, chacun a une réponse pour sa propre vie, mais il me semble qu’il y a des choses à tirer des poètes et des artistes, qu’ils ouvrent nos vies. Et pour dire les choses bêtement, on a des choses à mettre en doute, grâce à la poésie, et grâce à la peinture. Et une vie au fond qui n’est pas dans le doute est foutue. Elle est proche de mourir. Ce qui compte au fond, c’est de se maintenir vivant. Vivant. Coûte que coûte. Jusqu’au dernier moment. Comment vous dire ? Les vieilles personnes me fascinent par exemple. C’est la raison pour laquelle j’ai écrit Anchise. Je trouve que c’est une expérience à ne pas manquer. Je le vois comme ça. Comment rester vivant même lorsqu’on est très vieux ? Et qu’est-ce qui fait que l’on cherche encore à vivre, c’est-à-dire à être présent au monde. Et je crois qu’il y a des tas de possibilités, pas seulement d’être poète.
Maryline Desbiolles vit et écrit dans l'arrière pays niçois. En 1998, elle publie La seiche. Cet ouvrage a révélé le lyrisme maîtrisé de son écriture que l'on retrouve dans Anchise, qui obtient le prix Femina en 1999. Elle est aussi à l'origine de la création de deux revues de poésies Offset en 1980 et La Metis en 1990.

Née à Ugine en 1959, Maryline Desbiolles est l'auteure d'une trentaine de romans,
parmi lesquels Anchise, prix Fémina 1999.
(Entretien paru dans le site du Magazine des Livres.)
[1] Editions du Seuil, 2008.
[2] Editions Mazarine, 1987.
[3] Editions Noël Blandin, 1992.
[4] Editions Seuil, 2005.
[5] Editions du Seuil, 1996.
[6] Editions du Seuil, 1999.
[7] C’est pourtant pas la guerre, 10 voix + 1, Seuil, 2007.
Commentaires
Dans l'attente de découvrir de nouveaux billets de ce type.