Entretien avec Romaric Sangars. Écrire contre les lumières éteintes de notre modernité

Je note un défaut majeur chez nos contemporains : le pavlovisme ! En me faisant l’écho du livre de Romaric Sangars La dernière avant-garde. Le Christ ou le néant (Cerf, 2023), qu’il a eu la gentillesse de m’adresser à sa sortie, en citant sa thèse la plus importante et la plus essentielle pour un esprit qui réfléchit, et qui en se contente pas seulement d’aller bêler avec ses congénères suivistes (qui ne comprennent rien à leur propre pensée, pensée d’ailleurs qui ne pense pas !), à savoir, face à l’urgence de l’époque, le choix est binaire : le Christ-roi ou le néant, je sais déjà que les remarques seront acides, ironiques ou encore méprisantes. J’ai envie de dire à ces gens-là : lisez ! instruisez-vous ! Réfléchissez ! Votre monde est déjà mort ! J’ai donc eu la chance de recevoir ce livre, écrit par un vrai écrivain de notre époque (il en reste, en effet !) dont je connaissais déjà la réputation, et au milieu de la monotonie et de la médiocrité masturbatoire de la création ou de la réflexion de notre piètre temps, j’ai trouvé un souffle, un cap, une révélation, une dynamique spirituelle qui nous extirpe du chaudron de bégaiements suivistes qui remplissent notre modernité presque éteinte. Cet entretien est paru dans le site du magazine Entreprendre. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
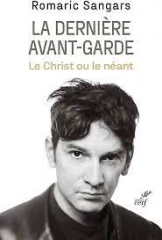 Marc Alpozzo : Cher Romaric Sangars, vous avez publié deux romans, Les Verticaux et Conversion[1] et un premier essai, très remarqué, et remarquable, intitulé ironiquement, Suffirait-il d’aller gifler Jean d’Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française ?[2] J’ai beau apprécié sa littérature, que je considère comme un petit pêché mignon, il n’en demeure pas moins que votre livre pointait à juste titre une tendance pernicieuse de la littérature, et que l’académicien incarnait avec bonheur : celle d’une littérature consensuelle avec l’époque, au détriment de sa vocation première : la subversion. Jean d’O, qui fut un totem de notre société des lettres, jusqu’à sa mort survenue en 2017, est même entré dans la prestigieuse Pléiade. C’est aussi, à la suite de ce premier essai, que votre nouveau livre, La dernière avant-garde. Le Christ ou le néant[3], s’inscrit, en élargissant le constat. On y trouve par exemple une description de la crise totale de l’art et de la modernité[4]. Pensez-vous que le déboulonnement de ce qu’il y avait de sacré dans l’art, à savoir, la subversion, la contestation des institutions, les rituels d’exorcismes, et que l’on retrouve encore dans des œuvres comme celles de Pierre Michon, de Richard Millet, de Michel Houellebecq, etc., est-il le propre de la décadence moderne, de l’effondrement des valeurs de notre société, et de son inintelligence progressive ?
Marc Alpozzo : Cher Romaric Sangars, vous avez publié deux romans, Les Verticaux et Conversion[1] et un premier essai, très remarqué, et remarquable, intitulé ironiquement, Suffirait-il d’aller gifler Jean d’Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française ?[2] J’ai beau apprécié sa littérature, que je considère comme un petit pêché mignon, il n’en demeure pas moins que votre livre pointait à juste titre une tendance pernicieuse de la littérature, et que l’académicien incarnait avec bonheur : celle d’une littérature consensuelle avec l’époque, au détriment de sa vocation première : la subversion. Jean d’O, qui fut un totem de notre société des lettres, jusqu’à sa mort survenue en 2017, est même entré dans la prestigieuse Pléiade. C’est aussi, à la suite de ce premier essai, que votre nouveau livre, La dernière avant-garde. Le Christ ou le néant[3], s’inscrit, en élargissant le constat. On y trouve par exemple une description de la crise totale de l’art et de la modernité[4]. Pensez-vous que le déboulonnement de ce qu’il y avait de sacré dans l’art, à savoir, la subversion, la contestation des institutions, les rituels d’exorcismes, et que l’on retrouve encore dans des œuvres comme celles de Pierre Michon, de Richard Millet, de Michel Houellebecq, etc., est-il le propre de la décadence moderne, de l’effondrement des valeurs de notre société, et de son inintelligence progressive ?
Romaric Sangars : Cher Marc Alpozzo, merci pour cette fulgurante rétrospective ! Disons que la subversion est devenue une notion ambiguë dans une époque comme la nôtre où elle est revendiquée docilement par tous les ados attardés qui s’imaginent artistes parce qu’ils ne savent pas planter un clou. Paradoxalement, c’est même l’Académie française, aujourd’hui, qui se montre subversive, du moins à contre-courant, quand elle se cabre contre la lubie progressiste de l’écriture inclusive que défendent en revanche quelques petits Trotski des facultés qui s’imaginent, eux, follement subversifs en le faisant, tout en nous expliquant que cette subversion n’en est pas une. M’attaquer à un académicien pour entrer dans la carrière était d’ailleurs, de mon point de vue, un geste finalement plus traditionnel que subversif, si l’on observe notre histoire littéraire récente, lequel geste fut jugé outrancier par des disciples d’André Breton et d’Antonin Artaud, allez comprendre… Tout cela pour conclure que la notion de subversion en tant que telle ne me paraît plus très satisfaisante, étant donné le contexte, car trop facilement falsifiable ou donnant lieu à de nombreux malentendus. Alors parlons de vitalité spirituelle d’une œuvre. L’esprit est toujours subversif en ce qu’il souffle où nous ne nous y attendons pas et une véritable œuvre littéraire ou œuvre d’art se reconnaît aussi à ce signe. Les écrivains qui se contentent d’exploiter des formes créées avant eux pour répondre à des urgences défuntes font seulement écho à des génies disparus. Ce n’est pas franchement nocif mais ce n’est pas très excitant non plus. Plus ennuyeux, ceux qui ne produisent que des illustrations du catéchisme en vogue, se masturbent sur les migrants (enfin sur l’idée qu’ils s’en font), brodent sur leur dernier viol ou nous exposent combien la vie est exaltante depuis leur ablation mammaire. Toute cette bouillie ne sert qu’à conforter l’auditeur de France Inter dans ses croyances, il y trouve d’ailleurs une forte gratification narcissique, ce qui est toujours précieux quand on n’existe qu’à l’état d’hologramme projeté par son temps. Mais enfin, l’art, ça vous brise ou ça n’est rien. Et ça ne peut vous briser qu’en opposant à l’inertie du monde une forme inédite et une substance explosive. Ce qui correspond au principe vital, à tout ce qui naît véritablement. Le reste est réplique, fantômes…
M. A. : La thèse de votre nouveau livre se trouve dans le sous-titre : Le Christ ou le néant. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
R. S. : Je pensais important d’opérer un aggiornamento sur la modernité. Cela fait une cinquantaine d’années que les philosophes ou observateurs critiques admettent qu’elle est morte en tant que période historique mais la plupart des acteurs du débat public ou artistique continuent de faire comme si ses mots d’ordre étaient légitimes. Ce qu’on a appelé la post-modernité, cette espèce de gueule de bois de l’ivresse moderne, ne marque qu’une ambiance, pas un mouvement historique. Depuis, nous sommes entrés dans ce qu’un Lionel Ruffel appelle l’ère « contemporaine » selon une nouvelle acception du terme, et qui me semble à moi, essentiellement, une grande décompensation de la modernité. Ce phénomène me semble avoir les propriétés d’un trou noir : à son terme, on rejoindrait le néant. La seule manière d’échapper à cette force d’attraction remarquablement puissante pour la psyché collective, c’est de revenir à l’origine lumineuse de ce qui se dégrada ensuite dans l’aventure moderne : la révélation chrétienne dans son plein rayonnement, un zénith que je situe autour du XIIe siècle, dans le moment « christo-centrique ».
M. A. : Je dois dire que votre essai est rafraîchissant pour notre époque, et montre, avec vos précédents ouvrages, que vous êtes un écrivain de premier plan, en devenir certes, mais précieux pour notre temps, car vous savez montrer avec beaucoup de simplicité et de rigueur, sans compter une précision d’orfèvre, le propre de notre crise moderne : l’assèchement spirituel, qui conduit à l’assèchement des esprits, notamment, celle de l’art, qui devient individualiste, militant, idéologique, mais qui refuse d’incarner quelque chose de plus grand que lui[5]. Vous parlez de « simple sédatif ». Cette crise totale, que l’on peut considérer comme une grave crise spirituelle, la plus grave, car elle peut largement emporter notre civilisation, à quoi est-elle due selon vous ? Qu’est-ce qui nous a conduits à de tels gouffres ?
R. S. : Je suis honoré par ce que vous me dites. Il me semble que la modernité, en s’assimilant progressivement à un dévoiement de l’aventure chrétienne, ne pouvait qu’aboutir à ça. La puissance de libération contenue dans le christianisme s’est dénaturée en autonomisation progressive (autonomie complète de l’homme, de la raison, de l’art, des buts politiques puis économiques…) ; le projet authentiquement transhumain du christianisme s’est travesti en toute sorte de projets parodiques d’hommes nouveaux, jusqu’à la mode trans selon laquelle le Nouvel Adam, c’est tout simplement Ève. Cette dynamique fantastique déployée à partir du XIIe siècle grâce à une certaine métaphysique a donc été dévoyée vers des plans inférieurs, s’est fragmentée, et aujourd’hui, n’ayant pu atteindre des buts qu’elle ne savait plus situer correctement, elle se retourne contre elle-même. Évidemment que le projet de transformer le monde et les êtres par le seul secours de la raison et de la science ne pouvait qu’échouer. Dans le contre-coup de cet échec, le post-moderne déconstruit ce que le moderne avait détourné, ce qui est à la fois débile et suicidaire.
M. A. : Vous abordez la question des Woke, « les prétendus Éveillés », écrivez-vous[6], et que vous appelez « les Nouveaux cathares ». Prétendument éveillés, vous avez raison de le souligner, puisqu’ils n’ont d’autres vertus que de redécouvrir ce que l’on sait déjà : les discriminations, les inégalités, les injustices. Bref, rien de neuf sous le soleil ! Ils ont toutefois innové par rapport à notre génération, puisqu’ils refusent l’universalisme de la chrétienté ou des Lumières, au profit d’une nouvelle universalisation, celle d’une particularité : le sexe, la couleur de peau, le genre, etc. Vous écrivez à ce propos : « Cette fièvre que certains confondent à tort avec une nouvelle séquence de l’épopée moderne se présente [...] comme sa décomposition fulgurante. »[7] Or, j’ai deux questions : pourquoi dites-vous que ce sont les Nouveaux cathares ? Cette destruction, que ces gens confondent à tort avec une déconstruction, n’est-elle pas la destruction des valeurs de la modernité au profit de nouvelles valeurs, celles de la postmodernité ?
R. S. : Le XXe siècle était prométhéen, autoritaire, normatif, rationaliste, volontariste, impérialiste. Le XXIe siècle, par les wokes, est cathare, car ceux-ci, comme les hérétiques albigeois, sont révoltés contre la Création toute entière qu’ils associent non à une création divine destituée par la Chute mais à un piège du diable, sauf que le diable est devenu l’homme blanc de la modernité, celui qui a, en effet, organisé le monde globalisé d’aujourd’hui, avec toutes les injustices que l’on veut mais tout de même d’une manière moins inégalitaire et discriminante que s’ils avaient été hindouistes ou salafistes. Enfin, vous avez raison, les wokes attaquent les valeurs de la modernité au nom d’autres valeurs : l’ultra-subjectivité et la destruction de toute norme, par exemple, mais il n’est pas nécessaire d’être bien malin pour s’apercevoir qu’il s’agit de valeurs qui sont porteuses d’un insurmontable chaos. Sans le bouc émissaire que représente, par un étrange retournement de l’Histoire, l’homme blanc, qui fait tout à la fois figure de père œdipien à tuer, les wokes, dont les réflexes sont tous contradictoires et qui n'assument aucune valeur positive structurante sont voués à l’autodestruction. En attendant de se réjouir, il faut donc les taquiner et prendre patience.
M. A. : Arrivons à l’essentiel de votre ouvrage, me semble-t-il : rien ne peut sauver de la déconfiture de notre monde, sinon la dernière avant-garde, celle de la beauté, pas la « beauté cosmétique, divertissante ou confortable, contre son asservissement politico-scientifique, contre sa dégradation en rituel narcissique », écrivez-vous, mais la beauté « à la manière radicale et chrétienne d’un Dostoïevski » [8]. La beauté sauvera-t-elle le monde, cher Romaric ? Doit-on lire dans cette vocation de la beauté, le retour de la dimension du sacré dans l’art, comme dans notre manière d’habiter le monde ?
R. S. : Je le crois, cher Marc. La Beauté est garante d’un équilibre supérieur. Le Bon et le Vrai ont été autonomisés dans l’époque moderne et cherchés seuls, pour eux-mêmes, ce qui aboutit à des postures soit sentimentales soit cyniques, une recherche du Bien qui se retourne en charité prostituée et narcissisme humanitaire, d’un côté, et une quête du Vrai qui, de l’autre côté, tend à une objectivité impitoyable et réductrice. Emmanuelle Béart et Elon Musk, pour faire vite. Il n’y a qu’en restaurant la beauté, signe de la divinité de l’homme à aimer et du cosmos à connaître que l’on s’arrachera aux impasses actuelles. C’est pourquoi l’art doit retrouver une fonction cardinale.
M. A. : Vous laissez à penser, lorsqu’on lit ce très bel essai, que l’art contemporain est une sorte d’attentat, non à la pudeur, quoique, mais au bon goût et à la tradition, celle de la chrétienté et de la métaphysique. Je partage en partie votre avis, car je crois que l’on peut aussi apprécier l’art contemporain dans ce qu’il a de plus nouveau et de plus subversif, même si l’idéologie de gauche s’y cache très certainement[9]. Duchamp est pour moi un génie, et donc le premier des modernes, là où Picasso est un monstre de talent, et le dernier des classiques. Le vrai destructeur, c’est lui ! Pas Duchamp, qui propose une alternative à la destruction, en substituant l’idée au Beau. Mais ce que j’ai trouvé particulièrement riche dans votre analyse, c’est que cette beauté, qui sauvera le monde, et dont vous parlez abondamment, est une beauté neuve, la vraie beauté, « offensive, dispendieuse, manifestant l’étreinte humano-divine par des éblouissements inédits », dites-vous[10]. Cette dimension du sacré et du religieux, au sens de l’étymologie, religare / religere, nous laisse penser que le Christ peut être de retour. Pensez-vous que cela puisse être possible, peut-être sous la forme d’un art nouveau, ou sous je ne sais quelle autre forme ?
R. S. : Je l’espère. En tout cas, je ne suis pas passéiste en art. Simplement, j’observe que le temps des écoles, puis des avant-gardes successives, qui étaient aussi des genres d’écoles –enfin plutôt des laboratoires –, ce temps est clos. Il serait illusoire de croire qu’en publiant un manifeste ou en singeant une tradition éteinte on pourrait susciter spontanément un art nouveau, et un art avec l’ampleur nécessaire. C’est pourquoi je crois indispensable de revenir au germe métaphysique qui, selon moi a permis les grandes aventures artistiques et littéraires de l’Occident, par un point de vue crucifiant sur les choses, réaliste et transfigurateur, tout en remarquant la pertinence de certaines propositions artistiques actuelles. Tout a explosé, il faut donc reprendre les choses de plus loin, agréger ce qui brûle encore et redonner à l’art ses perspectives les plus hautes. Le reste viendra avec le Feu de l’Esprit Saint.
______________________________________________
[1] Paris, Léo Scheer, 2016, 2018.
[2] Paris, Pierre-Guillaume de Roux, 2015.
[3] Paris, Les éditions du Cerf, 2023.
[4] « L’humanité s’essouffle, rampe, colorie ses murs au lieu de les franchir ; elle est plus décevante que prévu. Des façades de béton affichent leurs fresques criardes, et l’on voudrait nous faire croire que la vulgarité des tags pourrait nous sauver de l’inhumanité des blocs. » La dernière avant-garde, op. cit., p. 12.
[5] « Sans cet arrière-fond prophétique, l’art, au lieu de poursuivre la Création, se contente de gloser, souligner des douleurs, savourer des nuances, délirer pour lui-même, ce qui n’est pas rien, certes, mais trop peu comparé à l’ancienne ampleur. Encore que la plupart du temps il soit un simple sédatif, comme cette musique d’ascenseur omniprésente, que ce soit dans les magasins ou les écouteurs des passants, et d’un ascenseur en chute libre, qui rend tous les regards vitreux. » La dernière avant-garde, op. cit., p. 14-15.
[6] p. 43.
[7] Idem.
[8] p. 143-144.
[9] Ce qui fait dire à certains conservateurs que c’est la fin de l’art, là où le philosophe y verrait plus certainement la fin du Beau.
[10] Idem.