Entretien avec Sarah Vajda « D’un oxymore à l’autre surgit le chaos de la pensée »

Entretien avec Sarah Vajda, pour la Presse Littéraire, l'auteur des deux biographies, une sur Maurice Barrès et une autre sur Jean-Edern Hallier, et d'un nouveau roman, sur l'histoire et sa grande hache, Amnésie. Nous avons mené ensemble un entretien sans concession, sans phare. Sarah Vajda s'y est montrée tantôt un peu agacée, tantôt un brin cynique. Mes questions avaient pour but de la repousser dans ses plus profonds retranchements. Pari réussi. Je vous propose un entretien, zéro filtre... Cet entretien a été réalisé pour la revue La Presse Littéraire, numéro 4, de mars 2006.
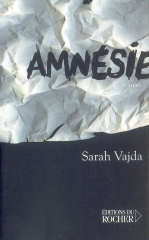 Sarah Vajda, j’ai envie de commencer cet entretien par cette question : Comment vous sentez-vous aujourd’hui en France ? Vous écrivez dans Amnésie, à propos de ce pays, que ce que l’on trouve sous les pavés, c’est le néant[1].
Sarah Vajda, j’ai envie de commencer cet entretien par cette question : Comment vous sentez-vous aujourd’hui en France ? Vous écrivez dans Amnésie, à propos de ce pays, que ce que l’on trouve sous les pavés, c’est le néant[1].
D’abord merci, Marc Alpozzo, de m’offrir la parole. Ensuite, et ceci n’est pas une précaution oratoire, la parole du romancier ne saurait, entière, se superposer à sa pensée. Amnésie est un premier roman, en partie échappé à son auteur, « dicté par une morte ». Aussi le moi n’y apparaît-il que fragmenté entre diverses figures qui, dans la nuit du sens, le chaos d’une après-guerre, cherchent des sens provisoires à opposer à la chose arrivée et à ses conséquences. La formule que vous relevez : « sous les pavés, le néant » moquait davantage l’espoir de 1968 qu’il ne prétendait établir un constat des lieux. Dans Amnésie, sous la terre de France, sous les pavés, au contraire, il reste de la vie et quelle vie ! des morts devenus lémures.
Je me sens en dissidence, pas seulement comme française d’origine juive, mais pour la cohorte de raisons, qu’à l’envie, tous tant que nous sommes – gens qui prétendons savoir notre monde – rachâchons[2] : le capital a joué aux dés notre royaume et l’a perdu, nous sommes nés, défaits dans un peuple défait, toute idée de grandeur de noblesse de qualité suspectée, dans un pays à la dérive hanté par une contradiction qui ne saurait se résoudre, croire à son exception en refusant l’élection, la sélection, tout en s’affirmant re-née, armée de pied en cap, mandragore, du sang d’un Roi etc. D’un oxymore à l’autre surgit le chaos de la pensée ! De guerre civile larvée en guerre civile active, sur fond de consumérisme et de tragédies, le pays semble mal en point ! Un vieux continent…
Envie d’exil, certes… En même temps, j’aime la langue de ce coin de terre où le hasard m’a fait naître et ce « cher vieux pays » m’offre une matière inépuisable.

“L’Hécatombe des fous” : 45 000 malades mentaux morts de faim sous le régime de Vichy
Avant ce premier roman, vous avez publié deux copieuses biographies sur les écrivains et pamphlétaires Maurice Barrès[3] et Jean-Edern Hallier[4]. Maurice Barrès c’est l’anti-dreyfusard, c’est le nationalisme traditionaliste, dans l’esprit de Maurras, mais en moins théorique, en plus lyrique, c’est le culte de la terre et des morts. Jean-Edern Hallier, c’est le pamphlétaire, bouffon du roi, l’escroc, l’agitateur, le négationniste aussi. Pourquoi le choix de ces deux écrivains, et comment les lieriez-vous ?
Vous m’aurez cher Marc, mal lu, je le crains ou bien me serais-je mal fait comprendre. Le Barrès fut écrit dans le but de faire cesser la consonance de deux S : établir que cette lettre, dix-neuvième de l’alphabet, était le seul point commun qui existât entre Barrès et Maurras ! L’un croyait au roi seul et à la grandeur hellène, l’autre adorait tous les dissidents du royaume, les ducs de Lorraine faisant trembler Richelieu, les chevaliers solitaires, les rônins montherlantiens, la langue de Saint Just… et se refusait à arracher au pays la moindre de part de l’héritage. Legs indivis ai-je répété à chaque page ! Politiquement Barrès se situait du côté de Bonaparte, du césarisme éclairé, de l’homme providentiel, inventant la syntaxe vide où le gaullisme se lova, quand Maurras rêvait de retour à une légitimité perdue. Barrès choisit le camp des anti-dreyfusiens, non par conservatisme, mais au nom de la nécessaire guerre à venir, au non de la patrie française, il le choisit pour les raisons mêmes qui font, à Péguy, choisir l’autre camp avant qu’il ne découvre, horresco referens, que ses alliés, à l’exception de Bernard Lazare, ne songeaient qu’à affaiblir la France. Le conservatisme se tient du côté du seul Maurras, qui conserve le nez yuppin de la statue déboulonnée par ses chers camelots dans son tiroir, à l’heure où Barrès inscrit les juifs morts pour la France dans Les Familles spirituelles de France. Il ne suffit pas de clamer haut le nom français pour être de mes amis, ce qui nous ramène à la figure de Jean-Edern Hallier dont vous tentez en vain de faire le ciment de notre entretien !
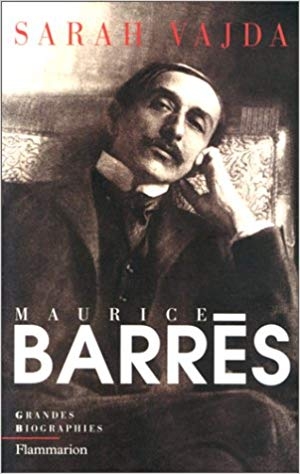 Si je noue aisément le travail des deux livres, la France, mon beau souci, je ne lie pas – loin s’en faut – les deux sujets ! Le Barrès était une « réparation amoureuse et savante » selon le mot de Dupré. Réparation, l’anti-dreyfusisme fut avant tout chez lui, comme chez d’autres d’ailleurs, fait mal connu, moins dicté par un anti-sémitisme que par une volonté de ne pas voir encore affaiblir la France, une habitude, mal en point, Alsace-Lorraine arrachées après la honteuse défaite de 1870, comme le dreyfusisme fut davantage dicté par le pacifisme, la peur de la guerre qui vient et le désir de déstabiliser l’état que par le philo-sémitisme. « Amoureuse », le Barrès se voulait un panégyrique : l’hommage à un écrivain dont l’art de placer le sensible et l’intellectuel en un geste littéraire unique, devait être salué. Il me fallait le remercier d’avoir inventé, à l’époque moderne, l’idée de la France où j’ai grandi en paix, certaine, sous la houlette du Général-Honneur, de marcher sous la lumière de « l’homme libre contre les barbares. » Savante, le mot est fort. Je savais être sans doute la dernière biographe de Barrès, et surtout le premier essai féminin sur un auteur qui n’avait souvent intéressé que des messieurs… Ce livre longe les rives de l’essai, donnant une part prépondérante à l’histoire des idées, revisitant les figures de Boulanger, Déroulède, Drumont, le Marquis de Morès et Gyp, la comtesse de Mirabeau, mère des fils Martel tous deux morts au service de la France.
Si je noue aisément le travail des deux livres, la France, mon beau souci, je ne lie pas – loin s’en faut – les deux sujets ! Le Barrès était une « réparation amoureuse et savante » selon le mot de Dupré. Réparation, l’anti-dreyfusisme fut avant tout chez lui, comme chez d’autres d’ailleurs, fait mal connu, moins dicté par un anti-sémitisme que par une volonté de ne pas voir encore affaiblir la France, une habitude, mal en point, Alsace-Lorraine arrachées après la honteuse défaite de 1870, comme le dreyfusisme fut davantage dicté par le pacifisme, la peur de la guerre qui vient et le désir de déstabiliser l’état que par le philo-sémitisme. « Amoureuse », le Barrès se voulait un panégyrique : l’hommage à un écrivain dont l’art de placer le sensible et l’intellectuel en un geste littéraire unique, devait être salué. Il me fallait le remercier d’avoir inventé, à l’époque moderne, l’idée de la France où j’ai grandi en paix, certaine, sous la houlette du Général-Honneur, de marcher sous la lumière de « l’homme libre contre les barbares. » Savante, le mot est fort. Je savais être sans doute la dernière biographe de Barrès, et surtout le premier essai féminin sur un auteur qui n’avait souvent intéressé que des messieurs… Ce livre longe les rives de l’essai, donnant une part prépondérante à l’histoire des idées, revisitant les figures de Boulanger, Déroulède, Drumont, le Marquis de Morès et Gyp, la comtesse de Mirabeau, mère des fils Martel tous deux morts au service de la France.
Le Hallier au contraire, d’abord ouvrage de circonstance, fut un livre de combat. J’ai désiré y conter la tragi-comédie que constitue dans la société du Spectacle la survie du mythe du grand écrivain, ses avatars télévisuels : comprendre comment une classe d’intellectuels en son ensemble avait accepté la dictature de l’audiovisuel, de l’audimat, cédé à l’esprit du temps jusqu’à s’y dissoudre. Hallier y tient le rôle d’un paradigme.
Dans un livre marquant, L’évangile du fou, Jean-Edern Hallier écrit un hymne à sa mère décédée et qu’il n’aimait pas[5] ; il écrit également un hymne à Charles de Foucault, ce nomade sublime, qui a été rayé des cadres de l’armée pour indiscipline, qui a étudié l’islam, qui a accompli un long voyage au désert, avant de prononcer ses vœux monastiques. Ce témoin de son temps, d’une époque qui chavirera bientôt dans la Première Guerre mondiale, Jean-Edern Hallier lui redonne ses lettres de noblesse, lui, l’écrivain déjà incompris et critiqué de toute part, qui écrit dans les décombres de sa bibliothèque partie en fumée après un énorme incendie, lui qui écrit également dans les catacombes de l’Occident qui est éteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce roman dénonce sa tragique vacuité, la comédie burlesque d’une fin de siècle où il faut faire le clown quand on est écrivain, si l’on veut être lu à défaut d’entendu. Il s’y appliquera d’ailleurs très bien dans ce début de postmodernité fondée essentiellement sur les apparences, la séduction, et le néant. Lui qui chante les montagnes du Hoggar, le vent de l’histoire, l’amour fou, la sainteté, n’est-ce pas finalement l’un des derniers voyants de la littérature française ?
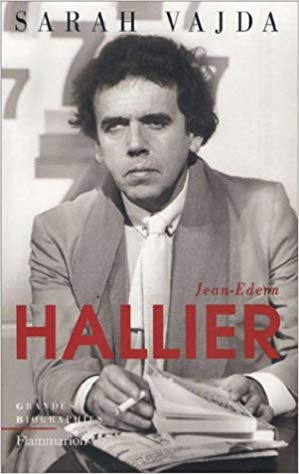 Soyez sérieux, Marc, Hallier ne fut pas un voyant, seulement une chambre d’écho où se dissout le monde contemporain. Vous évoquez la nécessité de « faire le clown pour être entendu ? » Est-ce là une posture efficace, précisément aujourd’hui où le couteau de la valeur est resté en coulisses. Hallier, hors du triangle d’or de Saint-Germain des Prés, n’intéresse plus personne… devenu, par son excès de zèle, un produit parmi d’autres « Vu à la TV». Qu’en sais-je ? Par un hasard incroyable – considéré le mésuccès de mon pauvre livre – il m’est donné de le contempler, semaine après semaine, dormant sur les rayonnages de la bibliothèque municipale que je fréquente. Il me plaît de l’y dépoussiérer, pauvre ouvrage gratuit, de la main qui le composa !
Soyez sérieux, Marc, Hallier ne fut pas un voyant, seulement une chambre d’écho où se dissout le monde contemporain. Vous évoquez la nécessité de « faire le clown pour être entendu ? » Est-ce là une posture efficace, précisément aujourd’hui où le couteau de la valeur est resté en coulisses. Hallier, hors du triangle d’or de Saint-Germain des Prés, n’intéresse plus personne… devenu, par son excès de zèle, un produit parmi d’autres « Vu à la TV». Qu’en sais-je ? Par un hasard incroyable – considéré le mésuccès de mon pauvre livre – il m’est donné de le contempler, semaine après semaine, dormant sur les rayonnages de la bibliothèque municipale que je fréquente. Il me plaît de l’y dépoussiérer, pauvre ouvrage gratuit, de la main qui le composa !
Refuser le spectacle en un monde à lui voué me semble plus congruent. L’ensemble que forment post mortem ses livres portera-il un jour le nom d’œuvre ? Sera-t-elle étudiée demain du point de vue du texte seul ? Qu’en lirons nos petits-enfants ? Hallier, sans cesse, a changé de point de vue, selon ses secrétaires et mulâtres ! N’avez-vous point remarqué comme l’Evangile suit de près sa conversion au chiraquisme, comme La Cause des peuples illustrait la posture gauchiste et Le Colin froid, la soumission à l’ordre rose, avant que la fleur ne le pique ?… La mère qu’il n’aimait pas représente peut-être la France qu’il rêvait de livrer aux sables du Hoggar... Toujours gauchiste au fond ce faux péguyste, ce garaudyste ! En ceci, Hallier me semble un parfait gentilhomme de sa caste et de son siècle ! Les catacombes de l’Occident n’ont point péri avec les morts de la petite guerre[6]. Ce qui périt appartenait à un ordre de valeurs inconnues à Hallier : la foi, l’espérance et la charité… l’honneur et la dignité virgilienne du travail. Hallier fut, c’est là sa haute gloire, un pirate. Hélas ce pirate, souvent, s’est voulu corsaire, quêtant sans cesse de nobles et moins nobles causes à servir. Posant à l’évangélisateur, au prophète, le bat a blessé. Il perdit le combat. Pour être un écrivain, deux conditions s’imposent : une langue unique, mélodieuse ou dissonante, terne ou corruscante – qu’importe ! – qu’aucun secrétaire, nègre ou mulâtre, jamais ne reprend, à l’exception de l’orthographe ou de quelques points de correction grammaticale, et un noyau dur, un réseau d’obsessions qui n’appartiennent qu’à lui, choses qui le font reconnaître en moins d’une phrase. Un écrivain jamais n’admettra recopier et signer des phrases empruntées, son ego, à tort ou à raison estimant que lui seul saurait assez bien dire…
Le Hoggar d’Hallier m’était connu et il ne m’en reste qu’une phrase, fort amusante d’ailleurs, « les gros derrières des jeunes filles de nos familles. »
Donc entre les deux biographies, un seul trait d’union, le visage de la France. Le premier lorgne du côté d’un Philippe de Champaigne et le second, du côté du cubisme.

Jean-Edern Hallier chez lui
Les ruines de la civilisation occidentale, vous les chantez également dans votre splendide roman Amnésie. Ce sont les ruines de cette Europe défunte durant la guerre, cette mort définitive d’une France qui a livré ses juifs à ses bourreaux. Cette France pourtant, vous l’aimez, mais vous ne cessez de lui dire qu’elle ferait bien de cesser de se défausser. Elle a commis l’irréparable, maintenant, elle feint l’amnésie. Pensez-vous seulement que ce puisse être possible ? Qu’un tel crime, reconnu par la France, lui permettrait de renaître de ses cendres ?
 Je chanterai les ruines ? Non, votre oreille vous aura joué des tours, je chante les textes… ma France est de papier et non de monuments ! Ce ne sont pas les « ruines » qui ont livrés mes pères et mes mères aux bourreaux, mais ce qui leur survit : l’administration française, l’institution en ce qu’elle pense selon Pierre Legendre, l’indifférence et le « j’m’enfoutisme », la gaudriole et la légèreté, qualités nationales, les valeurs prétendues subversives des révolutionnaires stipendiés par la TV. Mon livre chante l’oubli et non le devoir de mémoire. L’amnésie est un terme médical, le nom d’une maladie, d’un trouble auquel succèdent d’autres maux réels ou imaginaires, comme le retour des Lamies. L’irréparable n’est pas la déportation, mais le marchandage du bel été 1942. L’affaire des trains de la Relève accompagnés toujours par un wagon plombé. Je vous renvoie à l’entretien avec Raphaël Dargent[7], où je me suis longuement expliquée sur les thèmes de la tragédie des vies sauvées et de la paix civile dues aux morts au nom de la race.
Je chanterai les ruines ? Non, votre oreille vous aura joué des tours, je chante les textes… ma France est de papier et non de monuments ! Ce ne sont pas les « ruines » qui ont livrés mes pères et mes mères aux bourreaux, mais ce qui leur survit : l’administration française, l’institution en ce qu’elle pense selon Pierre Legendre, l’indifférence et le « j’m’enfoutisme », la gaudriole et la légèreté, qualités nationales, les valeurs prétendues subversives des révolutionnaires stipendiés par la TV. Mon livre chante l’oubli et non le devoir de mémoire. L’amnésie est un terme médical, le nom d’une maladie, d’un trouble auquel succèdent d’autres maux réels ou imaginaires, comme le retour des Lamies. L’irréparable n’est pas la déportation, mais le marchandage du bel été 1942. L’affaire des trains de la Relève accompagnés toujours par un wagon plombé. Je vous renvoie à l’entretien avec Raphaël Dargent[7], où je me suis longuement expliquée sur les thèmes de la tragédie des vies sauvées et de la paix civile dues aux morts au nom de la race.
Rien ne renaît jamais. La chose est arrivée, conditions requises. Le nihilisme a plus sûrement fait le lit d’Hitler et de Pétain que l’idéologie. Non, je ne donne pas de leçons à la France ou à quiconque, je lui demande seulement « Pourquoi elle s’est abandonnée » en s’avilissant. La vente des juifs, le maquignonnage de l’état 1942 n’est pas seulement un tort fait aux juifs, mais à elle-même : une insulte jetée à la face de Péguy, de Bernanos, des morts de la Grande guerre, des Lumières et de la grandeur ancienne.
Je ne chante pas les ruines. Les livres sont là. A portée de main dans ma bibliothèque et si d’aventure, ils venaient un jour à brûler, ils demeurent à l’Arsenal ou à la BBF, la déploration de Hallier quant à cet incendie de sa bibliothèque en sa place des Vosges demeure la marque de la caste, la cicatrice du fils de famille…
Pour finir, je n’appelle avec ce pauvre livre à rien, constate seulement le retour des lémures…
Vous êtes docteur ès sciences du langage, dans cette France amnésique, et dans le cadre du crime barbare récemment commis contre un jeune juif, le concept de « antisémitisme par amalgame », vous parle-t-il, dénonce-t-il une perversion du système de pensée de la France qui continue, en niant son passé, de dire aux juifs de France : « Juif tu n’es pas notre [8] » ?
La formule est curieuse, mais les Politiques doivent se montrer prudents. Evidemment, il s’agit de haine pure[9], mais le racisme anti-gaulois existe aussi, pour le moment moins actif, la France n’a pas de troupes en Irak. Israël se trouve au centre du dispositif, fanion, symbole du Grand Satan…
L’exemple de « caillera » me semble nettement plus drôle : il aurait suffit que le ministre parlât en verlan pour échapper « aux émeutes d’automne. »
Les juifs ont cessé d’être français le 3 octobre 1940, ont tenté de le redevenir le 8 mai 1945, pour découvrir en juin 1967 qu’il existait toujours un problème et qu’Israël n’en était pas la solution. Jean-Claude Milner a très bien vu cela.
Ceci dit dans cet assassinat, tous les ingrédients du cauchemar climatisé sont en place…

Étoile juive durant la Seconde guerre mondiale
Votre roman met en parallèle deux dérives barbares, liées à la mort de masse : le génocide et le meurtre en série. Personnellement je relie ce rapprochement aux excès de la technologie, à la puissance et la déviation du rationnel[10]. Vous ne cessez de dénoncer la « société festive », « société post-industrielle », « folie collective et individuelle [11] », certes derrière des écrivains américains majeurs comme Bret Eston Ellis, Chuck Palahniuk, James Ellroy, vous ne cessez de dénoncer combien ce monde féerique que l’on nous vend, où tout y faux et truqué[12], est dangereux. Mais votre thèse va plus loin, mettant en lumière ce terrible lien entre une société truquée, et son bouc émissaire qui sont les juifs, dans ce monde sans dieu. Peut-on être si manichéen dans le débat ?
Le tueur en série est d’abord un Narcisse tout puissant, un Hitler ou un bourreau du quotidien qui permet de tenter de saisir ce qui arrive en cas de guerre. Autrefois, il surgissait souvent dans des milieux privilégiés, Gilles de Rais ou la princesse hongroise Erzebeth qui prenait des bains de jouvence, des bains de sang. Que voulez-vous ? Au lait d’ânesses, la dame préférait celui des jeunes paysannes de son domaine. Un tueur en série n’est pas un soldat, mais un enfant gâté, un tyran. Je ne crois pas la technologie mauvaise en son essence, seul l’usage et l’Ubris font d’un outil ou d’un autre un instrument du mal du monde. Aucune activité ou invention humaine, en son essence, ne me paraît mauvaise, ni l’argent qui permet – abandonnant le troc – de se livrer aux joies de l’otium ni les machines qui nous libèrent de l’obligation de creuser la terre ou du dur travail… En revanche, les systèmes peuvent se révéler mauvais, le capitalisme arrachant à l’argent son potentiel libérateur et dévorant également les nantis et les miséreux ; le stakhanovisme en usant de même avec les machines. Vous m’aurez lu trop vite encore. Cette énumération que fait mon héros Morel est balayée par un mot : « les morts sont les auteurs des crimes affreux de notre siècle. » Quant au monde sans dieux, il me conviendrais parfaitement, si les hommes avaient atteint l’âge de raison, l’âge où les mythes cessent d’être considérés comme des realia, mais comme les structures, les colonnes où reposent des sens provisoires à renouveler à chaque aurore. Les juifs ne sont pas, par essence, mais par habitude seulement, des boucs émissaires. Encore un coup, relisez ou lisez les Penchants criminels de l’Europe démocratique[13] pour saisir la nature du mal théologico-politique qui agite l’Occident et maintenant l’Orient, depuis la mort du rabbin aux douze disciples.
Toutes ces choses dont nous parlons ont précédé la société post-industrielle. Sade, le principal de mes interlocuteurs en ce roman, a mis en lumière la Terreur à l’avance. Il la pré-voyait comme elle fut et serait, un pur escamotage. Aux lieux où Juliette fut torturée, aux camps, où les chambres à gaz fonctionnaient, il n’est rien demeuré… La muséographie, sottement militante, a comblé cette absence. Les termes « société post-industrielle, festive, narcissique »… choisissez Muray, je préfère Lasch, n’est pas une explication au tragique, mais une conséquence du capitalisme et de la terreur du monde qui vient. Nos Maîtres, dressant une barrière de protection, d’ entertainment, un écran de fumée, nous offrent ces plaisirs en compensation de leur impuissance à nous protéger. Enfermés devant la TV, vautrés à Paris-Plage ou heureux spectateurs de performances qui n’ont d’art que le nom, au fil de Nuits blanches, parqués à Disneyland ou en camps de vacances obligatoires, nous sommes conviés à nous divertir au sens pascalien : à sauter du navire où nous fûmes embarqués et où nos Maîtres périront avec nous.
Je préfère parler de tragique que de Mal, prétendant laisser la théologie à la porte plutôt que de faire croire que l’horreur ait un sens, un destinataire ou même une raison. L’Ubris suffit. J’ai fait des morts qui se vengent les dei ex machina du récit parce qu’à l’endroit où « Toulouse » (mon meurtrier) sévit il y eut un camp La Noé– la chose est vraie, que des gens y ont disparu en 1945 – ceci est encore vrai– et que le silence et l’amnésie ont recouvert ce fait, comme ils permettent de faire silence sur le marchandage de 1942.
Tous coupables, donc tous innocents…
Je songe encore que la manie commémorative est un leurre, un placebo, une arnaque… une manière de dire aux juifs, avec ce concept de « devoir de mémoire » individuel, instrumenté par l’Etat : cessez de pleurnicher, vous êtes des victimes reconnues. De la même manière, je m’insurge contre les juifs qui ont accepté l’argent du sang. La France aime à détruire ses archives, celles de la Fronde, le souvenir de l’Ormée bordelaise, celui de la Commune et de ses fusillades sauvages – pas de plaque au jardin du Luxembourg. De silence en silence, se composent d’étranges affaires, l’uniforme du fusilleur de la Commune porté par un officier traître par essence : « Dreyfus est coupable, je le déduit de sa race » écrivit mon cher Barrès faisant de ses disciples de « La Revue Blanche » les premiers sionistes… De la même manière, la République laisse aux Blancs le soin de commémorer la Terreur. Or, la mémoire devrait être totale et non partielle pour que le pays vive sainement. Je reviens à la loi de Solon, « en cas de guerre civile, seuls ceux qui n’ont pas participé devraient être inquiétés… »

Pierre Bonnard, La revue blanche, 1894
A la fin de votre roman, Marie écrit à Jean et lui révèle que son professeur d’histoire est mort, en compagnie de vingt personnes, dans les attentats du Manhattan. Pourquoi cette référence ? Pourquoi le professeur d’histoire ? Vous qui écrivez à propos de l’amnésie de la France, de l’Europe à propos de sa propre histoire, j’imagine que cela participe d’une symbolique forte. Les attentas d’un 11 septembre sont-ils pour vous le signe de la fin de l’histoire, des catacombes définitives de la civilisation Occidentale qui n’a su se sauver de la barbarie entre 1939 et 1945, et ne pouvant y faire face, a définitivement perdu son âme, dans l’attentat meurtrier et emblématique de Manhattan ?
Professeur d’histoire ? J’avais, pragmatisme oblige, nécessité que mon héroïne choisisse d’étudier l’histoire pour les besoins du récit… Il fallait simplifier, imaginez-vous Jehuda Frank commerçant ou ingénieur ?
Manhattan ? Fichtre, je n’y avais pas songé une seconde ! Ce n’était que le nom d’un cocktail, métaphore du seul pays où les juifs devraient vivre, l’Amérique où ils ne représentent qu’une communauté parmi d’autres, une idiosyncrasie parmi d’autres : le nom d’un bar branché, où d’ordinaire, les vieux n’entrent pas. Amoureux, donc perdu, Jehuda Frank y pénètre et en meurt. Cette mort absurde peut passer, je vous l’accorde, pour la triste punition de son égarement… Ceci est de l’ironie et non du symbolisme ! Les terroristes ne frappent pas encore les bibliothèques : la visibilité et le nombre de victimes seraient moindre !
Ce sont d’ailleurs souvent ce type de cafés que touchent les attentats ! Il convient de punir les faibles, la jeunesse, le plus souvent pacifiste, dont certains se rendent à Chypre pour épouser des Palestiniens ou celle qui, dans les boîtes gay, rêvent la paix des corps que nos ennemis choisissent de réduire en cendres. Aux enfants morts en première ligne de l’Intifada, nos ennemis répondent en tuant les nôtres, pas ceux que l’Etat enrégimente dès leur plus jeune âge, ( ils n’existent pas ), mais ceux qui, comme à Londres, à Paris, à Manhattan, dansent et baisent en attendant le jour…
La rencontre fictive entre une jeune fille juive et ce symbole du mauvais génie français, Robert Brasillach, qui ne parvient toujours pas à réaliser son crime, demandant au Général, une grâce, c’est le moment fort de votre roman, c’est le symbole même de cette France de Vichy largement antisémite qui ne parvient, non seulement pas à se regarder en face, mais oublie tout ses crimes au point de se sentir, durant cette période, complètement innocente. Avec les déclarations du chef de l’Etat en 1995, au moment de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, d’un repositionnement des médias français en ce qui concerne la guerre israélo-palestinienne, ne pensez-vous pas que cela change progressivement en France, et que de totale, l’amnésie n’est plus que partielle ?
 Le fond du problème n’est pas là. Brasillach représente la démission des élites, responsabilité illimitée. D’autres normaliens, Pierre Pucheu… ont servi Vichy ! Brasillach n’est pas un symbole, Drieu de la Rochelle aurait sans doute mieux convenu, mais Brasillach et moi avions une vieille querelle à régler : il a aimé les écrivains qui me sont les plus chers entre tous, Virgile et Corneille, il a commis une merveilleuse Anthologie de la poésie grecque, dans le temps où il a appelé les enfants de Pithiviers à se ranger sous la rosace de la cathédrale de Chartres, recommandé au pays « de ne pas séparer les petits des mères »… Brasillach avait été un enfant doux qui adorait sa jeune mère, un jeune écrivain qui, sans cesse, vers l’enfance, tournait ses pensées et sa plume… « marchand d’oiseaux », « voleur d’étincelles », il révérait le mythe de la virginité ! Aussi devais-je lui poser les questions que mon héroïne lui pose. Il parlait aussi un excellent français, signifiant avec ce mot « petits » l’animalité, la non-humanité des juifs. Ce fragment reste sans doute, avec le fragment consacré à Céline, la seule partie du livre où le « je » écrivain et la personne civile se recouvrent entièrement.
Le fond du problème n’est pas là. Brasillach représente la démission des élites, responsabilité illimitée. D’autres normaliens, Pierre Pucheu… ont servi Vichy ! Brasillach n’est pas un symbole, Drieu de la Rochelle aurait sans doute mieux convenu, mais Brasillach et moi avions une vieille querelle à régler : il a aimé les écrivains qui me sont les plus chers entre tous, Virgile et Corneille, il a commis une merveilleuse Anthologie de la poésie grecque, dans le temps où il a appelé les enfants de Pithiviers à se ranger sous la rosace de la cathédrale de Chartres, recommandé au pays « de ne pas séparer les petits des mères »… Brasillach avait été un enfant doux qui adorait sa jeune mère, un jeune écrivain qui, sans cesse, vers l’enfance, tournait ses pensées et sa plume… « marchand d’oiseaux », « voleur d’étincelles », il révérait le mythe de la virginité ! Aussi devais-je lui poser les questions que mon héroïne lui pose. Il parlait aussi un excellent français, signifiant avec ce mot « petits » l’animalité, la non-humanité des juifs. Ce fragment reste sans doute, avec le fragment consacré à Céline, la seule partie du livre où le « je » écrivain et la personne civile se recouvrent entièrement.
J’ai déjà répondu à la seconde partie de votre question : je ne crois pas que lâcher des ballons rue de Turenne en souvenir des enfants morts à Pitchipoï soit un geste important, il servira seulement à faire élire Monsieur Dieudonné. On ne commémore pas ces choses-là. D’ailleurs, les Français en ont marre de ces histoires de juifs - pourquoi auraient-ils le monopole de la souffrance ? -, ce sont aux Institutions, aux corps de l’état, aux législateurs que le devoir d’analyse, de critique incombe. Le reste est électoralisme, lobbying et compagnie.
Ce premier roman, comme vos précédents ouvrages biographiques, prouvent que vous êtes un réel écrivain, armé d’un style, d’une écriture forte et subtile. Cela rassure quand on observe à quel point la production éditoriale actuelle est généralement médiocre et sans intérêt. Votre écriture prend ses racines dans l’écriture d’un Bernanos, d’un Barrès, peut-être même d’un Céline - que vous n’hésitez pas à écorcher[14], à juste titre, d’ailleurs. Pour vous la force de l’écriture semble être partie tenante avec l’ensemble de l’œuvre. Comment réagissez-vous face au salut de quelques grands écrivains français pour l’écriture blanche d’un Houellebecq ? Est-ce pour vous le signe de la fin de la littérature ?
 Pas du tout, Modiano a du génie. Un écrivain se reconnaît à sa scansion, sa voix, sa musique… vive ou blanche, épique ou atonale là n’est pas la question. Modiano chantonne à voix basse en l’absence de père, Houellebecq est atone par nihilisme, ma narratrice, en deuil de l’idéal, n’ayant pas consenti à la disparition de la grandeur, choisit d’être plus lyrique. La fin de la littérature ? Quand à force de faire passer pour de la littérature des objets en ayant la forme et l’apparence, le public cessera d’acheter totalement la soupe aux cailloux qu’on lui vend. Pas avant.
Pas du tout, Modiano a du génie. Un écrivain se reconnaît à sa scansion, sa voix, sa musique… vive ou blanche, épique ou atonale là n’est pas la question. Modiano chantonne à voix basse en l’absence de père, Houellebecq est atone par nihilisme, ma narratrice, en deuil de l’idéal, n’ayant pas consenti à la disparition de la grandeur, choisit d’être plus lyrique. La fin de la littérature ? Quand à force de faire passer pour de la littérature des objets en ayant la forme et l’apparence, le public cessera d’acheter totalement la soupe aux cailloux qu’on lui vend. Pas avant.
Je ne suis pas théologienne, le règne des fins n’appartient pas à mon champ de pensée et « l’apocalypse n’est pas ma copine. » Il existe de bons et rares livres, des auteurs talentueux, des essayistes brillants. Dupré qu’à longueur de temps, je célèbre ; pas si lointain, nous avons Roland Barthes, un Christopher Gérard laisse entendre un son singulier, Jean Védrines, Rémi Soulié[15] ont du talent, de la rage et du cœur. Dans la bande de Tsimsoûm dont je suis, Bruno Deniel-Laurent montre une rare maîtrise de la chose écrite ; encore un peu rêche dans l’expression, la pensée et l’humour d’un Laurent Schang me semblent promesses. Ceci pour rester dans le seul domaine français et oublier la revue francophone Egards, les deux romans de Claude Marc Bourget[16] et la prose de combat et d’intellection de Jean Renaud, sans parler d’autres auteurs contemporains hors de nos frontières. Comment juger d’un siècle avant sa clôture ? Gageons plutôt que l’immonde climat du temps présent sera terreau propice à l’éclosion de la Littérature ! Qui pourrait affirmer l’infériorité du styliste Camus – maître de l’écriture blanche – et prétendre que Houellebecq en atteint l’élégance austère, hautaine et lointaine ? Que notre siècle préfère le second plus caustique, plus brutal, plus déniaisé, est une autre affaire. Vous parliez d’écriture. La littérature n’est pas morte avec l’irruption de l’Etranger au ciel de la littérature coloniale, pas plus que la Nouvelle vague n’a tué le cinéma, comme le croyaient nos grands-papas. Il ne faut pas confondre idéologie et chose littéraire, commerce et art, artisanat et génie, sociologie et pensée… Aussi Michel Houellebecq mérite-il une chaire de sociologie au Collège de France, aussi sûrement que l’immortalité littéraire !
Certains romans ont pour fonction d’embellir la réalité, d’autres de la dénoncer. Le vôtre - dois-je le dire ? - est plutôt du côté de la dénonciation. Pensez-vous néanmoins, qu’un roman puisse encore changer quelque chose aujourd’hui ?
Dénonciation ? Non. Amnésie est une lettre d’amour, page de colère à un pays qui a trahi sa grandeur et ses engagements.
La littérature, pas plus que le rock, ne change le monde. L’Histoire, la science, l’économie, la théologie le bouleversent, à pas de velours ou à coups de canon. La littérature, parfois, modifie le regard, l’être au monde, infléchit le cours des pensées, met l’accent sur un versant l’autre du Réel. Je ne dénonce pas, puisque rien n’est nouveau dans ce livre. Tout est arrivé, tout y est vrai. Je dispose simplement les parties du puzzle et conte l’émotion de chacune des voix du roman devant ces pièces. Il en manque toujours une : la France, qui demeure silencieuse. Á la porte de la taiseuse, sphinx avec ou sans mystère, qu’en sais-je ? Infiniment, ce livre prétend frapper.
Amnésie n’est pas un livre militant comme vos questions le laissent entendre : il se situe en Romancie, où les jeunes filles sont parfaites, les femmes, exceptionnelles d’intelligence, les flics, des hommes d’honneur, les profs, des épées ou des aigles. Dans la réalité les jeunes filles sont souvent futiles et les flics sans imagination, les criminologues, des disciples de Claude Bernard, les femmes, des hystériques et les profs, des dilettantes ou des cuistres. Nous sommes en Romancie, où s'entrelacent deux chants, deux champs, le réel invraisemblable et la littérature consolatrice
Hormis Barrès, Péguy, Bernanos, quels sont les écrivains qui vous inspirent ?
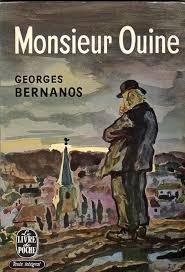 Ils ne m’inspirent pas. Proches ou contemporain des événements, je leur réponds au sujet de ces événements. Je rends grâce à Barrès d’avoir inventé la syntaxe vide du gaullisme, Péguy d’avoir célébré Bernard Lazare, fait de Jeanne la sœur de Judith, d’avoir commis l’œuvre immense qu’il a laissée et salue Bernanos pour avoir composé ce chef d’œuvre qu’est Monsieur Ouine, y gravant, sur la montagne morte de la vie, le visage de « la Paroisse morte » qui m’obsède.
Ils ne m’inspirent pas. Proches ou contemporain des événements, je leur réponds au sujet de ces événements. Je rends grâce à Barrès d’avoir inventé la syntaxe vide du gaullisme, Péguy d’avoir célébré Bernard Lazare, fait de Jeanne la sœur de Judith, d’avoir commis l’œuvre immense qu’il a laissée et salue Bernanos pour avoir composé ce chef d’œuvre qu’est Monsieur Ouine, y gravant, sur la montagne morte de la vie, le visage de « la Paroisse morte » qui m’obsède.
Qui m’a inspiré, formé, inventé ? Les poètes et les dramaturges, Virgile le mieux aimé, Corneille, le plus admiré, Baudelaire et Mallarmé… les moralistes avant tout, de Retz à Debord et de La Fontaine à Barthes, sans doute aussi, du moins en ce livre, l’oralité du psaume biblique relu par Port-Royal et le chant du chœur antique.
Votre roman appartient à la fois à la littérature policière, à la philosophie, au roman historique, et en même temps n’appartient à aucun genre, étant plutôt un hymne, je dirais derrière votre éditeur, à la littérature française, et je rajouterais, à la « grande » littérature française. Comment réagissez-vous face à cette époque qui n’a plus en tête de produire de grands écrivains ou de grandes œuvres, qui ne favorise plus l’accès à la philosophie, poussant les philosophes à penser au bord du monde, qui se désintéresse de la discipline historique ? Est-ce pour vous le signe de la victoire du nihilisme passif, tel que le dénonçait Nietzsche ?
Le silence de l’histoire… pas un fait récent
Et le nihilisme me semble fort actif !
Quant au reste…
Dernière question : ce qui rapproche Hallier de Houellebecq c’est qu’ils sont tous deux des écrivains iconoclastes, habiles pour se servir des médias et pousser tout le monde à plus parler de leurs livres qu’à les lire. Entre les deux, l’un appartient encore à cette race d’écrivains avec une force d’écriture sans pareil, l’autre nous introduit et décrypte pour nous l’ère de la postmodernité. Déplorez-vous cette situation, ou au contraire, selon vous, comme Hallier, Houellebecq, en Zarathoustra des classes moyennes, tel qu’il se nomme lui-même, et un de ces plus grands visionnaires de son temps, et tout le côté littéraire qui prévalait à un roman et que Houellebecq abandonne, n’est pas seulement un signe de désinvolture, mais la véritable marque d’un nouveau genre d’écrivains et de littérature qui fera autorité dans l’avenir ?
Aucun avenir pour la chose littéraire en ce monde, du moins sous nos latitudes ! 451 degrés Fahrenheit, nous retournons aux catacombes. Pourquoi devrait-il, à l’ère des masses, y avoir plus de gens qu’autrefois qui se délectent de la chose écrite ? Pourquoi obliger les humains à adorer les livres et les arts ? Pour ma part, je ne me rends guère au musée et la musique classique, vous l’avouerai-je, m’ennuie ! Dupré, Modiano… resteront, si quelque chose subsiste de l’Occident désert où nous nous ennuyons ! Houellebecq n’est pas davantage un visionnaire que votre Hallier. Le monde va si vite, le Meilleur des Mondes est venu. Houellebecq est un écrivain de l’apocalypse annoncée, un patient descripteur du réel, Hallier, un prophète de comptoir. Visionnaire ? Cela signifie voyageur du futur. Et le moyen de se rendre au-delà, quand la destruction paraît imminente. L’au-delà, les films de Carpenter, Assaut, ou encore Matrix, le montrent… Le futur antérieur : retour de la horde, désexualisation, fin de l’amour, non–coïncidence du sexe et du sentiment, aliénation du loisir après celle du travail, sont faits de société aujourd’hui, et notre Prozac la fameuse drogue de Huxley… Aucun Européen n’y atteint en l’absence de mythes. Et peut-être en l’absence de sentiment historique, la grande épopée sur la révolution française, Büchner l’a composée. De l’Empire, Christian Dietrich Grabbe von Detmold et non von Paris a chanté, déconstruit, analysé, célébré la geste.
Du silence de l’histoire dans la dramaturgie française, sujet pour un petit conte…
 Cet entretien a été réalisé pour la revue La Presse Littéraire n°4 de mars 2006.
Cet entretien a été réalisé pour la revue La Presse Littéraire n°4 de mars 2006.
________________________________________________
[1] Sarah Vajda, Amnésie, Le Rocher, 2006, p.79.
[2] Non il ne s’agit pas d’une coquille, mais de promouvoir le superbe verbe-valise forgé par Marguerite Duras dans son court-métrage, Les Enfants.
[3] Flammarion, 2000.
[4] Flammarion, 2003.
[5] « Le Manuscrit de ma mère morte » in L’évangile du fou, Albin Michel, 1986.
[6] 1914-1918 qualifiée de grande, comment qualifier la suivante dont le pays oublia de saluer les morts au champ d’honneur et accusa l’étranger pour les otages et les juifs par elle, pour son repos, livrée.
[7] Site Internet, Cercle Jeune France, entretien avec Sarah Vajda : http://www.jeune-france.org/Bibliotheque/selection2.htm.
[8] Op. cit., p.68.
[9] Conte de la barbarie ordinaire, sur le Stalker du chevalier Asensio (voir : http://stalker.hautetfort.com/archive/2006/02/24/conte-de-la-barbarie-ordinaire-par-sarah-vajda.html.)
[10] Voir dans ce numéro, Marc Alpozzo, Sarah Vajda, le contre-voyage.
[11] Op. cit., p.150.
[12] Op. cit., p.47.
[13] Editions Verdier, septembre, 2003.
[14] Op. cit., pp103-105.
[15] Stalag, paru l’an passé à la Table ronde du premier et Les Châteaux de glace de Dominique de Roux du second, ne sont pas des ouvrages à faire désespérer du jour !
[16] La Bataille des Alberti et le Sagittaire d’Evesham, Beffroi, Québec 1990 ; Les Immortels de Mathijsen, Humanitas, Montréal, 2000.