Alain Ehrenberg : Peut-on échapper à la fatigue d’être soi ?

L’homme contemporain souffre d’un mal sans précédent : la fatigue d’être soi. Avec le culte moderne de la performance, on assiste à une réelle montée en puissance des valeurs de la concurrence économique et de la compétition sportive dans la société française sommant les individus de se lancer à la conquête de leur identité personnelle et de la réussite sociale. Mais cette conquête s'accompagne inexorablement d'un souci inédit de la souffrance psychique. Souci exemplifié par la mise en scène de soi, ce qui entraîne à terme cette fatigue d'être soi que décrit Alain Ehrenberg dans un ouvrage portant le même titre, qui représente le moment où la médicalisation de la vie apparaît comme le phénomène général qui s'impose tout particulièrement à la psychiatrie.
Sans institutions de l'intériorité, il n'y a pas, socialement parlant, d'intériorité. Elle est produite dans une construction collective qui lui fournit un cadre social pour exister. La perception de l'intime change. Il n'est plus seulement le lieu du secret, du quant-à-soi ou de la liberté de conscience, il devient ce qui permet de se déprendre d'un destin au profit de la liberté de choisir sa vie.
Alain Ehrenberg
La fatigue d’être soi
Le soi et l’autre
L’autre n’est jamais aussi dissemblable que lorsqu’il est un autre qui n’est pas moi. Or, je ne peux avoir le sens de l’autre que si, précisément, j’ai le sens du propre, car c’est ce qui me donne le sens de l’étranger. D’où le problème : comment je transfère cette étrangeté comme alter ego ? Cette relation se met de manière latérale, c’est-à-dire, en pensant la relation au corps propre. Ainsi, la question sera comment je saisis l’autre comme chair. La fameuse chair du monde dont parle avec tant de justesse Maurice Merleau-Ponty. Ce sera la reconnaissance du corps de l’autre non pas comme objet, mais comme lui-même. Il faut donc avant toute réflexion, une réflexivité du corps propre. Il y a une synthèse passive : l’ego se dessaisit de lui-même, saisit de l’autre en personne qui s’effectue non pas de chair à chair, non pas selon un raisonnement, mais selon un implicite. La chair d’autrui s’annonce dans l’expérience par son comportement et, ici, j’ai un sens d’autrui par cela que je peux me mettre à sa place. Mais dans cette relation qui œuvre, c’est l’imagination, et donc c’est moi qui me mets là-bas à la place de l’autre. Cela dit, je ne serai jamais à la place là-bas, c’est-à-dire ici, comme lui. Je transgresse donc ma sphère du propre, sans me donner en original, le vécu d’autrui.
La cinquième méditation des Méditations cartésiennes nous conduisant à une impasse, nous apprend qu’aussi loin que j’aille dans une élaboration d’autrui, je ne peux fonder un sens d’autrui en propre. C’est précisément le problème de la reconnaissance comme autre en autre. On retrouve par exemple cette idée chez Merleau-Ponty et Sartre à partir de Husserl : je reconnais l’autre à partir du moment ou celui-ci me reconnaît : il y a donc une réciprocité de la reconnaissance, c’est-à-dire, une reconnaissance commune d’un nous.[1]
Être « étranger » à soi-même
Pour Merleau-Ponty, l’idée est la suivante : il faut inverser les choses. Je ne peux avoir le sens d’autrui que si j’ai en moi une altérité qui me déborde, et c’est parce que je me saisis de l’expérience du corps propre que je peux reconnaître en l’autre un lui-même. Pourtant, si nous n’étions pas étrangers à nous-mêmes, je ne saurais pas reconnaître l’étranger. Car l’être au même est ce sujet faisant partie d’un monde auquel il appartient : une appartenance au monde qui s’exprime dans mon corps, et qui fait que j’ai une expérience d’autrui. Mais c’est également parce que l’ipséité ne se ressaisit pas dans une singularité qui se possède.
Or, je n’ai jamais affaire à autrui comme à un objet. L’évidence d’autrui n’est possible que parce que je ne suis pas transparent pour moi-même. Il y a une différence entre mon étrangeté et celle d’autrui. Car il y aura toujours un écart non-inféré même dans une pré-réflexivité. Et il y a quelque chose dans cette donnée solipsiste. On ne peut surmonter cette relation qu’en surmontant l’invisible qui est toujours quelque chose qui appartient à soi comme à l’autre.
L’individu autonome ; désarroi du soi
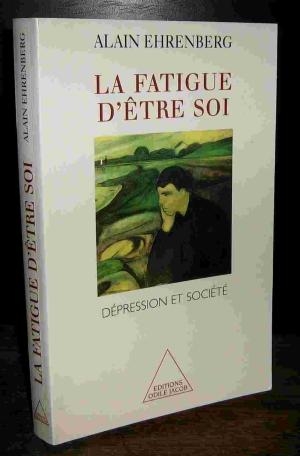
L'individu une question d'institution et non de subjectivité.
Alain Ehrenberg
La fatigue d’être soi
Cette reconnaissance de l’autre comme n’étant pas soi, cette « transcendance » de l’ego par le dépassement du soi, cette échappée au solipsisme, il semble que notre époque ne nous en offre plus les moyens. Qui est autrui ? Qui suis-je ? Ces questions essentielles qui furent, durant longtemps, sujets à débats pour les philosophes, sont noyées aujourd’hui dans un concept normatif, imposé comme une notion « naturelle » et sans appel : « l’individu ». « Plus nous vivons l'autre comme un semblable, plus nous devenons des individus. Si l'on veut comprendre l'expérience contemporaine de l'individu, il faut le penser comme une relation et non comme une substance. Il est placé à l'articulation entre souci pour soi et pour autrui, articulation qui relève d'abord de la responsabilité politique », écrit Alain Ehrenberg[2].
Le concept d’individu ne se saisit plus tant de la question de l’autre, que du problème de « soi ». Pur produit de la société, l’individu n'est pas une substance objective isolée. Et ce qui oppose le sujet d’hier à l’individu d’aujourd’hui, c’est cette incapacité à vivre la vie sur un mode « collectif ». Hier, « la vie était vécue par la plupart des gens comme un destin collectif, elle est aujourd'hui une histoire personnelle », nous dit encore Alain Ehrenberg[3]. Cette approche très personnelle de la vie, incapable de porter ses yeux au-delà de soi, fait courir deux risques majeurs à l’individu : la dépression nerveuse et une incapacité à se saisir de la dimension énergétique de la politique.
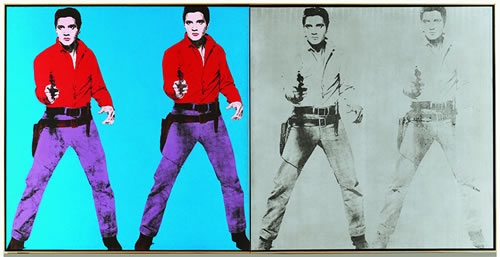
Tableau d'Andy Warhol
D’ailleurs, ce désarroi de l’individu que l’on nous promet est bien une réalité présente, pour une raison simple : il ne peut plus avoir le sens de l’autre aux prises d’une société sans projet collectif, qui lui ressasse, telle une injonction impitoyable, d’« être lui-même », laissant ainsi ce dernier à son autonomie. Aussi, seul « l'effritement des frontières entre le privé et le public » témoigne apparemment du fait que, par le recul du politique, la subjectivité est devenue une question collective. Il nous faut en réalité retenir que l’individualisation rejoint la contractualisation dans la sphère productive. De fait, le devoir de production de soi précède sa nécessité pour une civilisation hyper-technicienne qui exprime sa nouveauté dans des significations déjà là dont elle épouse les formes. On s’aperçoit alors combien les mots : contractualisation, individualisation, personnalisation, autonomie ne sont que le résultat d’une lutte idéologique intense.
De fait, nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous réduisons notre recherche au simple confort individuel. On refuse d’en savoir trop sur son être intime. On refuse de s’ouvrir à l’autre, happés que nous sommes, par le modèle dominant de l'économie libérale qui prétend élargir les libertés subjectives, alors qu’il les limite terriblement, transformant le sujet en une individualité biologique à laquelle il réclame performance et productivité, ce qui arrange d’ailleurs le système social. Un principe que Lefort explique bien : « La division du social conditionne l'unité de la société, le conflit permet de faire tenir un groupement humain sans qu'il n'ait besoin de justifier son sens en se référant à un ailleurs et sans qu'un souverain décide pour nous. C'est là le noyau du politique en démocratie. » En contrepartie, le système abolit toute réflexion sur soi. Il s’agit pour l'homme moderne de l'économie libérale d’être lisse et sans conflits. Semblable à un ordinateur, il ne doit jamais offrir le spectacle d'une quelconque défaillance.

Wall Street
Problème : peut-il obéir en permanence à une telle injonction ? Élisabeth Roudinesco répond par la négative, prétendant que ne pouvant obéir à un tel mot d’ordre, l’individu a le choix entre devenir dépressif à force de refouler son angoisse ou devenir victime à force de rechercher les causes de son malheur dans l'agressivité venue de l'extérieur. D’où précisément sa dépression.
Certes, en suivant le sociologue Alain Ehrenberg, on peut dire que la dépression nous instruit sur notre expérience de la personne, car elle est la pathologie d'une société où la norme n'est plus fondée sur la culpabilité et la discipline, mais sur la responsabilité et l'initiative : « L'individu est confronté à une pathologie de l'insuffisance plus qu'à une maladie de la faute, à l'univers du dysfonctionnement plus qu'à celui de la loi : le déprimé est un homme en panne. » En dépit des quelques accointances avec la plus classique et très ancienne mélancolie, la dépression — le trouble mental aujourd'hui le plus répandu dans le monde — a une histoire tout à fait récente, que le sociologue retrace dans son ouvrage La fatigue d'être soi[4]. Notre dépression prend la suite, sans s'y confondre, de la première maladie à la mode, la neurasthénie, dont on ne pouvait pas ne pas souffrir si l'on était homme (et surtout femme) vivant pleinement son temps, entre la fin du siècle dernier et le début du nôtre. Mais quand Freud interprétait la névrose comme résultat d'un conflit entre le désir et la loi, et symptôme d'une culpabilité, Pierre Janet y voyait déjà le signe d'une déficience, d'un manque d'énergie du sujet, bref, d’une dépression. De la névrose à la dépression, de la difficulté de l'identification aux troubles de l'identité, sur fond de revanche posthume de Janet sur Freud, cette généalogie de l'individu contemporain qu'esquisse Alain Ehrenberg a le mérite de nous apprendre combien la souffrance actuelle d'être soi-même pèse sur notre psychisme, et altère, voire atomise notre bonheur quotidien et notre bien-être.
Le choix des armes
Tout se passe pourtant aujourd’hui, nous dit le journaliste Eric Dupin, dans son ouvrage Une hystérie identitaire[5], comme si le désir d'être « comme les autres » avait progressivement, mais fondamentalement, été remplacé par celui d'être « différent des autres » : l'obsession de cette hypocrisie qu’est l’égalité semble avoir définitivement cédé la place à un concept moins illusoire : « l’identité. » Dupin et le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans son Invention de soi, une théorie de l'identité[6] partent du même constat : jamais on n'a autant parlé d'identité : « Placez le mot dans un intitulé de colloque ou de thèse universitaire, vous obtenez immédiatement un supplément d'âme », dit même Jean-Claude Kaufmann. Reste à savoir comment chacun d'entre nous s’accommodera de ce nouveau « mot d’ordre ». Or, pour exister aujourd'hui, explique-t-il, nous disposons du choix des armes.
Solidarité et communautés ouvertes sur le monde
Mais quelles sont ces armes ?
D’abord, soyons clair : l’individualisme moderne n’a jamais été autre qu’une pure idéologie dont les bases matérielles ne peuvent que sombrer à terme dans l’abêtissement généralisé, et dans le vieux refrain du « rien n'est possible » qui sert en grande partie l'entrepreneur. Car il n’existe pas plus forte supercherie que le concept d’individu. Pour masquer l’hypocrisie, on fait comme si l'individu ne dépend plus des institutions. Comme si l’effacement de la religion n’est pas en un certain sens une étape datée, à partir de laquelle l’homme doit se construire lui-même, et se dépasser. L'individu n'a aucune consistance en soi et s'il ne peut plus se fonder sur la relation directe à Dieu ou à l'empereur, il doit retrouver la solidarité avec les êtres et les choses, trouver sa reconnaissance dans l'amour, qui est la confiance en soi, le Droit, qui est le respect de soi et le travail, ou l'activité sociale qui apporte l'estime de soi, nous dit Axel Honneth.
Que le concept, la fiction de l'individu autonome et responsable, ne fonctionne plus de nos jours, précipitant l’homme, on l’a vu avec l’ouvrage La fatigue d’être soi, dans toutes sortes de dépendances, telles que les sectes, les toxicomanies, ou le plus souvent la dépression, est chose certaine, cela laisse d’autant plus penser l’intérêt pour quelques-uns de s’inscrire dans des mouvements alternatifs qui cherchent à reconnaître nos dépendances et solidarités effectives afin de construire l'autonomie de chacun à l'intérieur d'un projet collectif. Le but : s'engager dans le développement humain et l'investissement dans l'avenir. Mais surtout, re-découvrir l’autre. L’alter ego. Faire un pas en dehors de soi. Faire un pas vers le tiers pour mieux revenir vers soi. Un retour au concept de « solidarité ». Voire de fraternité[7]. Concepts véritablement d’avant-garde.
Le culte de la performance
Cette démarche néo-contemporaine, c’est-à-dire, rassembler, travailler et vivre ensemble, écouter l’autre, participe d’une volonté alternative de donner le change à la logique du consumérisme, de l’individualisme borné, de la compétitivité et de la rentabilité qui divisent plus qu’elles ne rassemblent. C’est une démarche qui s’inscrit dans la démarcation de soi avec le groupe. Dans l’identité. Dans la volonté active d’« être soi » sans pour autant se replier sur « soi-même ». Ainsi dans notre rapport au monde, désormais, par le sens du concept de « solidaire », autrui se retrouve réintroduit.
Dans cette logique, par exemple, on trouve des personnes de tout horizon qui veulent « prendre leur vie en main ».[8]
Ainsi, n'avons-nous aucun intérêt à feindre une autonomie des individus encore à conquérir, mais surtout beaucoup nous conseillent à présent de refuser l'autonomie de l'économie qui, pour être purement idéologique, n'en a pas moins des effets criminels. Abandonnant ainsi les prétentions d'être cause de soi, l'écologie introduit un nouveau holisme non-religieux, la négation de la séparation et de l'autonomie des différents champs sociaux, qui trouve sa légitimité dans l'avenir préservé et non plus dans le passé originel bien que son souci du global renoue en partie avec la prudence des sociétés traditionnelles. Nous devons quitter le monde du roman et de l'enfance irresponsable pour une communauté adulte maîtrisant son destin collectif.
La solidarité trouvée, le partage s’exprime dans l’initiative altruiste, dans l’échange et l’écoute de l’autre, dans l’investissement actif sur le terrain. C’est parce qu’il est mal dans sa vie, mal dans son être que l’individu, dont l’autonomie et la focalisation sur « soi » étouffent, peut désormais s’embarquer avec force et courage dans une nouvelle aventure des temps modernes : la solidarité alternative. Une ouverture de soi vers l’autre, un rapport à l’autre tranchant avec les injonctions contemporaines, qui repose l’Homme au centre de la problématique, et qui nous fait revenir dans le débat à repenser le vrai problème : l’autre.
Bibliographie indicative :
Béatrice Barras - Moutons rebelles - Ardelaine, la fibre développement local, Editions Repas
Alain Ehrenberg :
L'individu incertain, Pluriel, Hachette, 1995
La fatigue d'être soi, Poche, Odile Jacob, 1998
Jean-Claude Kaufmann, L'Invention de soi, une théorie de l'identité, Armand Colin
Eric Dupin, L’hystérie identitaire, Cherche-midi éditeur
Emmanuel Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Le livre de poche
____________________________________________
[1] A ce propos on peut également penser à Lévinas et sa dialectique du même au même.
[2] L’individu incertain, p. 311.
[3] L’individu incertain, p. 18.
[4] Editions Odile Jacon, 1998.
[5] Editions du Cherche Midi, 2004.
[6] Armand Colin, 2004.
[7] Voir à ce propos de l'ouvrage de Jacques Attali, Fraternités, Une nouvelle utopie, Fayard, 1999.
[8] C’est le cas du réseau Repas, par exemple, dont le « compagnonnage alternatif et solidaire consiste en l'apprentissage dans l'itinérance, c'est-à-dire, partir à l'aventure, à la rencontre et s'enrichir d'expériences et de travail dans un réseau », pouvons-nous lire sur leur site Internet.