Ici ou Ailleurs ? Combattre nos illusions

En cherchant dans le dictionnaire l’opposition à la notion d’Ailleurs, je vois que la langue française nous propose celle d’Ici. Je suis soit Ici, soit Ailleurs. C’est logique. Et lorsque je rêve d’un ailleurs, j’imagine que je rêve forcément d’une sorte d’Eldorado à conquérir ou à retrouver. L’Ailleurs se vit sur un mode nostalgique, ou romantique, et contient cette dimension rétrospective d’un retour à l’origine, ou d’une expérience de dessaisissement. Cette longue étude est parue dans le numéro 3, de Special Philo, en août 2013. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
« La paix c’est un chemin, c’est un devenir » J.-Y. Le Loup
Désirer partir Ailleurs, c’est certainement exprimer le désir d’aller à la rencontre d’une altérité, quelle qu’elle soit. Et il y a mille façons de penser l’Ailleurs. Mille façons de rêver d’un Ailleurs, idéal, sans souffrances, adapté à nos besoins et à nos désirs. Sûrement rêvons-nous d’un Ailleurs parce que le lieu où l'on vit ne nous suffit plus, ou parce que cela correspond à une soif d’absolu, une sorte d’Ici inversé, au service des âmes romantiques, afin de se consoler de la difficulté à vivre et s’épanouir dans le monde présent. On peut aussi dire que le besoin d’Ailleurs est nourri par le désir du dialogue, ou de la découverte. La curiosité d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte là-bas plus qu’ici, ce qui suscite certainement le besoin de partir.
I/ Ici et Ailleurs
Partir ailleurs
C’est un fait : nous avons besoin de rêver. Combien d’entre nous peuvent prétendre n’avoir jamais fermé les yeux pour s’évader, imaginer un ailleurs à leur guise, et faire un voyage immobile. On rêve devant un tableau, en lisant un roman, en écoutant une symphonie, ou sur une carte. Le voyage est de plusieurs ordres, et le désir d’Ailleurs peut être satisfait de multiples manières. En étudiant les grandes structures philosophiques durant mes jeunes années, j’ai voyagé à ma façon, en éprouvant intellectuellement les intensités immobiles dont parle si bien Deleuze dans son Abécédaire. Il rajoute également quelque chose de très intéressant à mes yeux. Deleuze cite l’idée de Proust : Voyager, c’est partir vérifier ses rêves. Et il rajoute qu’un bon rêveur sait qu’il faut aller vérifier. Il doit s’assurer qu’une couleur, ou odeur, ou tout autre chose dont il a longtemps rêvé est en adéquation avec la réalité. Deleuze regrette d’avoir tant voyagé. Il y voit des signes de fausse rupture. Pourtant, le mauvais rêveur, rajoute-t-il, c’est celui qui ne part pas, et qui ne va pas ailleurs pour vérifier ses rêves.
Partir chercher quelque chose, c’est aux antipodes du tourisme de masse qui parcourt des circuits organisés, ou reste proche de la piscine de l’hôtel. Voyager, dirais-je, est un état d’esprit bien spécifique, qui met en jeu le voyageur lui-même. On prend des risques lorsqu’on part. Et le premier risque encouru, c’est la déception même que va nous apporter le voyage.
On peut bien se laisser porter par ses rêveries des années durant. Mais un jour, la nécessité de concrétiser ses rêves devient une urgence que l’on n’arrive plus à ignorer. J’ai ressenti cette urgence. Partir vers un ailleurs fantasmé, physiquement, pour aller y vivre les émotions et les sensations que le lieu, et le réel vont m’imposer sans que mon imaginaire ne puisse rien contre cette violence. Partir voir ailleurs, c’est sortir de soi. C’est cesser de vivre à l’intérieur, replié, comme un fœtus, qui refuse de sortir du ventre de la mère, et de se confronter à l’extériorité.
Nous avons besoin de rêver, mais nous avons tout autant besoin de confronter ce rêve à la singularité du monde. Le voyageur, celui qui se confronte, est un homme curieux, avide de nouveautés, et de singularités. Il n’a pas peur de la déception, ou de la différence. C’est un individu qui est prêt à abandonner armes et bagages, et qui ne nourrit aucun sentiment de supériorité. Il va à la rencontre des autres peuples, des autres cultures et des pays, sans préjugés, lâchant avec ses opinions, ouvert à l’altérité. C’est donc un homme prêt à se dépouiller, à se laisser bousculer et remuer, voire transformé. Car nécessairement, le voyage transforme.
À l’inverse du sédentaire, qui a investi un lieu, et qui se refuse à le quitter, tel un « assigné à résidence », l’homme qui part, le voyageur, est un être en marche. Il avance sans cesse. Il peut parcourir le monde une fois, dix fois, cent fois. Il peut avoir fait le tour de la planète autant que nécessaire. Il a cette tendance à ne pas se fixer, à ne jamais investir un lieu précis en occultant le reste de la planète. Il marche sans s’attacher. Je vois deux types de non sédentaires : les errants et les nomades. Les premiers n’ont pas de but, pas de lieux d’origine, ils sont sans amarres, et se cherchent en recherchant ailleurs un lieu où se trouver, au hasard des rencontres. Ce sont généralement des gens qui souffrent, et qui sont en quête, mais ils ne savent pas exactement de quoi. On a autrefois vanté les qualités des errants, mais je suis intimement persuadé que l’errance est un état qui devra, tôt ou tard, être dépassé. On ne peut raisonnablement demeurer errant. L’errance se perd à l’endroit même où elle prétendait se trouver.
Les nomades en revanche ne sont pas en quête. Ils ont une tendance comportementale à ne pas se fixer. Ils ne désirent s’attacher à rien : ni goût, ni culture, ni idée, ni lieu géographique. Dans son livre L’Esprit nomade, Kenneth White nous dit à propos du nomade, qu’il « ne suit pas une logique droite, avec un début, un milieu et une fin. Tout ici, est milieu. Le nomade ne va pas quelque part, surtout en droite ligne, il évolue dans l’espace et il revient souvent sur les mêmes pistes, les éclairant peut-être, s’il est nomade intellectuel, de nouvelles lumières ». Le nomade ne cherche pas l’imprévu, il n’explore pas de lieux inhabituels à ses yeux. Il détient un itinéraire qu’il connait, et il est un homme prévoyant, à l’inverse du vagabond, que peut être l’errant. Il n’est donc pas hors du monde. Il n’est même pas mobile, si j’ose dire, puisqu’il emporte avec lui sa propre maison. Il est donc animé d’un lieu fixe, et il détient un ancrage solide, même si le sédentaire ne le voit pas. C’est probablement même toute la force du nomade : posséder ainsi un ancrage à un espace immobile, tout en demeurant d’une mobilité extrême.
Il n’y a pas moins contre-nature que de demeurer toute une vie à la même place, sur un lieu unique. Le non-mouvement, c’est le signe de la fin du voyage, de la mort, d’une absence de vie. Je crois que je n’exagère pas en disant que le mouvement, c’est la vie. Spinoza employait le terme latin de conatus qui est le mouvement perpétuel des êtres vivants, toujours tiraillés entre déploiement de puissance et manque de déploiement de puissance. Le sédentaire est donc quelqu’un qui s’est fait violence, en réglant ainsi sa vie, se rassurant grâce à cette installation dans un rythme sans surprise, stable, et à l’opposé de la vie aventureuse. Ne bougeant plus, il semble comme mort.
Pour mieux comprendre le sédentaire, j’ai recouru à l’étymologie. Cela nous vient de seder, être assis, dans une routine certainement, des habitudes qui ont réglé la vie au hasard, l’imprévu, et l’imprévisible. Je n’ai rien contre les sédentaires, mais j’ai comme l’impression qu’ils ont choisi de s’asseoir dans leur vie, pour ne pas avoir à s’affronter. Cet attachement à un lieu n’est pas nécessairement une anomalie, mais elle relève plutôt d’une peur : peur de ressentir des émotions négatives, comme par exemple la peur elle-même. Ce serait probablement même la peur de la peur que le sédentaire chercherait à fuir, il me semble.
Celui qui fuit n’est pas mieux loti. Le voyageur impénitent, qui ne reste jamais en place, est un autre type de peureux, animé par la peur, et qui instrumentalise le voyage. Il se sert du voyage pour se guérir, ou du moins le croit-il fermement. Il ne voyage pas par amour du voyage, mais par crainte de ne pas se perdre. En voyageant, il ne part pas à la découverte des autres, et ainsi de lui-même, il tente coûte que coûte de n’avoir pas à s’affronter en s’oubliant dans ses nombreux périples. Courant sans cesse, ces globe-trotters fuient toute possibilité d’introspection, puisque cela demande que l’on se stabilise un instant.
Revenir d’ailleurs
Tout départ implique son retour. Le touriste revient d’ailleurs, où il a eu droit à quelques secondes de liberté, d’euphorie, de dépaysement afin de retrouver sa routine mortelle, les obligations et les devoirs qui l’aliènent à longueur d’année. Lorsqu’il y pense, il est tout de même amer de voir que le voyage n’a pas changé grand-chose à son quotidien asphyxiant, et il attend avec impatience ses prochaines vacances pour reprendre une bouffée d’air frais.
L’autre type de voyageur qui rentre, l’aventurier, le sans attache, qui ne cherchait ni à fuir ni à rester, qui est parti pour découvrir, aller à la rencontre d’un rêve qu’il voulait vérifier, revient de son long périple bariolé, transformé, définitivement dépouillé de ses certitudes. Il était parti à la conquête d’une vérité, et c’est bardé de mille vérités à présent qu’il rentre chez lui. Il n’est plus de ce pays qu’il a quitté pour en visiter des centaines d’autres. Il n’est plus d’une seule nation. Il appartient à mille nations, dix mille, cent mille. Il est citoyen du monde. Lorsqu’on lui demande sa nationalité, il vous répond qu’il est international.
L’Ailleurs lui a appris une nouvelle bouleversante : il n’y a pas de vérité universelle. Chaque peuple, chaque culture, chaque pays, chaque endroit détient sa propre vérité, ses propres valeurs, et ses propres convictions. Il est parti ailleurs pour vérifier son rêve, et il en est revenu dépouillé du rêve, désarçonné, avec une leçon qu’il n’est pas prêt d’oublier : partout où vous irez, la vérité sera différente, et en même temps, les êtres humains seront les mêmes. Certes, la leçon est intéressante, mais il suffisait de parcourir sa famille, son quartier, sa ville pour recevoir la même leçon ! Alors qu’est-ce qu’on va chercher ailleurs ? Qu’allons-nous chercher là-bas qu’il n’y a plus qu’ici si ce n’est un idéal, une illusion de vérité, ou mieux un Eldorado ? Et le voyage n’en sera qu’un plus profond traumatisme, au point qu’on en reviendra déçu, désillusionné, se demandant s’il n’aurait pas été plus sage de ne pas partir. D’un autre côté, on est sûrement parti pour comprendre qu’il n’a servi à rien de partir. Le serpent se mordant ainsi la queue, il est urgent désormais de sortir de ce paradoxe. Je vous propose une solution.
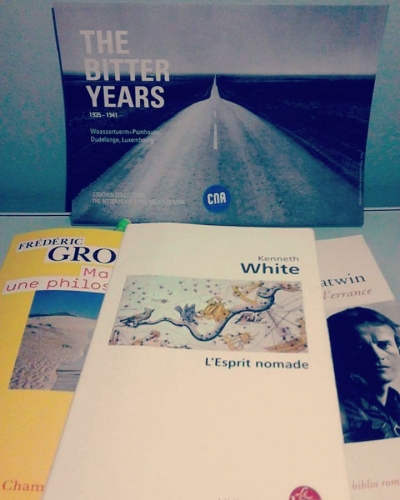
Photographie prise en 2015 sur la route
(Collection personnelle)
II/ Ici et Maintenant
Combattre nos illusions
Souvent nous regardons ailleurs, parce que nous avons peu conscience de ce qui se passe ici, là, dans l’instant présent. Nous sommes pétris d’Ailleurs, autrement dit de promesses de bonheur. Nous cherchons au loin ce que nous pensons ne pouvoir trouver ici, là, dans ce qui est familier, proche de nous, voire en nous. Nous partons très loin, aux confins du monde, chercher ce qui était tout près, au plus proche. Nous ne refusons pas de vivre dans l’instant présent. Plus précisément, nous n’y pensons pas. Ça n’appartient pas à nos mécanismes. Nous nous projetons systématiquement en arrière, dans la nostalgie du passé, ou nous anticipons sur l’avenir, en fantasmant des auspices meilleurs ou des tragédies à venir. Bien que le pire ne soit jamais certain, nous vivons dans la crainte d’une catastrophe, ou la souffrance d’une attente. Nous ne vivons donc jamais. Nous ne survivons pas non plus. Nous sous-vivons. Nous avançons dans l’existence comme des vaisseaux dans la nuit, sans prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, sans vivre intensément chaque instant de notre vie. Un jour, nous nous réveillons, mais c'est bien tard. Trop tard pour certains. L’existence s’est étirée jusqu’à sa proche fin, il ne nous reste que quelques instants à vivre, et le regret d’être passé à côté de sa vie, et surtout de soi étreint ces pauvres personnes qui n’ont jamais pris conscience de chaque instant de leur vie, voire de leur être.
Prenons un souvenir au hasard : celui d’une expérience amoureuse de jeunesse, par exemple. Qu’en retenons-nous à quarante ans. Quelques images, des sensations, et un souvenir plus ou moins agréable. De quoi ce souvenir est-il véritablement fait ? Saurions-nous le dire ? Souvent, un souvenir est constitué de quelques images éparses, et d’une intensité plus ou moins forte, émotionnellement parlant. Mais savons-nous que rien de ce souvenir n’est réel, au sens ou, ce souvenir, en réalité, n’est qu’une reconstitution plus ou moins très imparfaite, dont notre imagination et nos esprits ont constitué ce qu’il nous reste de l’événement vécu. On dira qu’on a cristallisé les bons ou les mauvais moments, au hasard de nos sentiments actuels, et de l’idée que nous nous sommes fait de cette expérience. Rien n’est donc réel à propos de cet événement, si ce ne sont le souvenir et les perceptions fondés sur une représentation purement imaginaire des choses. Vivre donc dans le passé, c’est se condamner à ne pas vivre. C’est-à-dire qu’on se maintien sciemment dans la nostalgie ou le regret, donc dans la souffrance. Si le mot « amour » par exemple génère en nous regrets ou frustrations dès que nous aurons activé le bouton mémoire, nous nous rappellerons des images de notre amour de jeunesse en convoquant en nous des sensations et des émotions négatives que nous associerons à ces perceptions. Mais rien de tout cela ne sera réel, et nous n’aurons pas fait face à une réalité présente ; pis, nous n’aurons pas même vécu au moment où nous aurons fait appel à ce souvenir douloureux ou heureux. Nous nous serons mis entre parenthèses, nous laissant glisser dans des rêveries ou des perceptions illusoires. Nous n’aurons pas non plus revécu cette réalité, nous l’aurons simplement fantasmée, perdus dans nos propres illusions.
Pris dans le flux du temps et du moi, nous ne voyons plus clairement les choses, et nous rêvons alors d’un Ailleurs, une sorte d’échappatoire au moi, où nous y serions nous-mêmes, mais sans souffrance, sans peine. Ce rêve vain peut nous conduire, une vie entière, à nous fuir, et à fuir notre propre être, à ne pas voir que les choses se déroulent ici et maintenant, c’est-à-dire dans le présent. Je dirai l’instant présent, celui qui se déroule au moment même où j’écris ces lignes. Mais pris par le flux de ma pensée, et l’aspiration à publier très rapidement cet article, je ne prends pas véritablement conscience de ce que je fais : j’aligne des mots presque mécaniquement, et je ne considère pas ce qui est là en train de se passer. Je ne suis pas éveillé à ce que je fais, pour dire les choses comme le feraient les bouddhistes.
Cesser de souffrir
Que savons-nous d’hier ou de demain ? Seul ce que nous mettons dans nos projections répond véritablement à cette question. Pour cesser de souffrir, il nous faut rendre le sens aux choses du présent. Voilà ce que j’en ai déduit après m’être, moi-même, beaucoup perdu dans toutes ces fuites. La méditation et la respiration m’ont appris à regarder le monde autrement. Cesser les projections, les constructions illusoires du moi, la souffrance et les idées noires peut être possible si nous nous attachons à nous concentrer sur « ce qui est ». Prenons deux exemples : nous avons perdu un être cher, ou nous comptions aller à la plage, mais il fait un très mauvais temps. Dans les deux exemples, dont l’intensité de la souffrance n’est en rien, comparable, nous avons une seule et même chose : nous pouvons nous laisser prendre par notre rêverie et nous imaginer cet être cher toujours en vie, ou la plage sous un soleil magnifique, ce qui nous fera irrémédiablement souffrir, une fois que nous aurons été reconduits vers la réalité, ou accepter le fait tel qu’il est, malgré la peine, malgré notre désir impuissant de changer les choses. Dire : « C’est ainsi » et considérer l’instant présent seulement dans ce qu’il nous offre, plutôt que de nous emprisonner, comme on pourrait le croire, ou de lui donner notre assentiment, nous libère de nos illusions, de nos désirs, et de notre souffrance face à notre impuissance de changer quoi que ce soit. Les stoïciens nous conseillaient, à juste titre, de nous attacher à ce qui dépend de nous et de nous déprendre de ce qui ne dépend pas de nous. Les bouddhistes nous proposent de pratiquer de manière régulière, chaque matin et chaque soir la méditation assise. Le tantrisme cachemirien nous conseille de nous concentrer sur notre respiration et de prendre conscience de celle-ci, afin de réaliser que nous sommes ici et maintenant. Ce dont je suis sûr, c’est que nous ne sommes maîtres que de ce qui dépend de nous. Nous sommes impuissants face à un événement extérieur sur lequel nous n’avons pas de prise, comme la mort d’un être cher, ou un ouragan qui va dans cinq minutes emporter notre maison et l’essentiel de nos souvenirs. Ce dont je suis sûr aussi, c’est que nous nous perdons dans les constructions mentales comme les rêves ou les illusions, nos aspirations à trouver une herbe plus verte ailleurs, et nos désirs, généralement vains et douloureux.
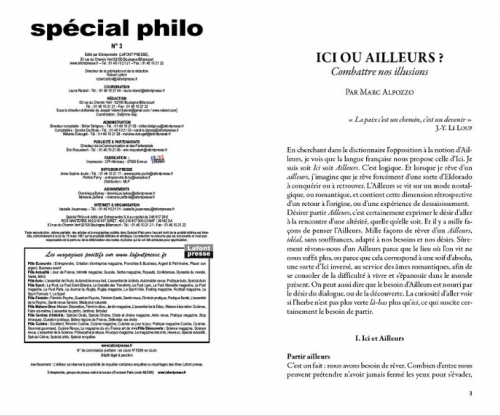
Extrait de cet article, paru dans la revue Spécial Philo, n°3, août-oct. 2013
Le bonheur
Se défaire de ses désirs ainsi que de ses illusions, ne plus se laisser enfermer dans ses pensées, et dans ses regrets et ses peurs face à l’avenir devient possible si nous considérons que la porte de la libération se trouve dans la prise de conscience de l’ici et maintenant.
Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour les Occidentaux, l’ici et maintenant, ou la voie, est assez peu compréhensible. Nous avons fondé notre valeur première sur l’action, et que ce soit Socrate, Jésus ou encore Descartes, tous les grands représentants de la libération de l’homme ont valorisé l’agir. Or, agir, c’est tendre vers l’avenir, c’est être en devenir. On peut donc difficilement comprendre les notions d’ici et maintenant, qu’il n’est pas inepte d’opposées à celles de l’ici et de l’ailleurs. Souvent, je rencontre des gens qui pensent que l’ici et maintenant, c’est rejeter le devenir, nier l’avenir, ou tout simplement refuser de s’occuper de demain. En fait, cela me parait à la fois bien plus simple que cela, et plus complexe.
On va donc cibler, s’attacher à des désirs ou des choses précises, dire non à ce que l’on croit inacceptable ou indigne. Nous sommes là encore et toujours dans la projection. On va se dire que cet endroit est indigne et on va chercher à le fuir ou à le quitter, que cette situation n’est pas acceptable et on va mettre toute son énergie à la changer. Et pendant ce temps, si les choses semblent bouger un petit peu, on n’est pas en phase avec soi-même ; on se met volontairement dans une situation inconfortable.
En prenant conscience de l’ici et maintenant, on trie ses désirs, surtout les plus inutiles et les plus illusoires. On cesse de croire que notre seule volonté est suffisante pour changer les choses, et maîtriser notre vie. En lâchant avec le jugement, vous vous libérez des dogmes, des opinions, des savoirs tout faits et des illusions. En vous ouvrant à l’instant présent, en laissant filer toutes les pensées qui passent, en ne vous attachant plus à elles, vous accueillez enfin l’instant présent ; vous vivez en phase avec votre être, et l’être de l’instant.
Maître Eckhart parlait du détachement, qui était principalement une expérience de l’intime. Sans rentrer au fond de la pensée du sage mystique, je dirais que le détachement se résume à demeurer impassible à tout ce qui nous arrive : « On devrait attacher moins d’importance à ce que l’on va faire qu’à ce que l’on est ». Autrement dit, l’esprit ne doit rien vouloir ; il accepte, sans se résigner, ce qui lui arrive, que ce soit agréable ou douloureux, comme si c’était un présent de Dieu lui-même. Et, si ce détachement impassible amène l’homme à la pureté même de Dieu pour Maître Eckhart, on retrouve une formule semblable sous la plume de Marc-Aurèle, lorsqu’il écrit dans ses Pensées pour moi-même : « Le propre de l'homme de bien reste de chérir et d'accueillir de bon cœur la trame de sa destinée, de ne pas perturber, en le mêlant à une foule d'images, l'Esprit qui l'habite… »
On voit donc que l’ici et maintenant n’est pas si éloigné de notre culture occidentale, et de notre sagesse antique. Être attentif à ses pensées sans jugement, ni désirs, accepter ce qui est sans vouloir rien changer, prendre conscience de l’instant présent en l’habitant de tout son être est la clé de la libération. Vivre en conscience, c’est-à-dire vivre dans l’ici et maintenant, c’est se détacher du rêve ou de la fuite vers l’ailleurs. C’est vivre dans le non-attachement aux images mentales, aux désirs illusoires, et aux projections. C’est revenir à la proximité avec son être et l’être lui-même. Voilà, donc, il me semble, ce que l’Occident a encore quelques difficultés à comprendre.
Accepter ce qui est n’est pas se résigner. Comme dans la philosophie antique, accepter signifie ne pas perdre ses forces ou son temps à se battre contre un monde qui ne se préoccupe pas de nous. Ne pas se laisser happer par l’illusion de maîtrise. Se détourner de l’événement sur lequel je n’ai pas de prise, ou des désirs illusoires, des images mentales qui se répètent en boucle sans que je n’y puisse rien, et se rendre plus attentif à ce qui est : mes émotions par exemple, qui sont un bon moyen d’être informé de ce qui se passe en moi.
C’est donc un exercice spirituel qui demande une pratique au quotidien. Au commencement, cela pourra sûrement paraître difficile, et les tourments ne seront jamais bien loin, ce qui vous amènera à rechercher encore, de manière mécanique, à fuir cet ici insupportable. Puis, au fur et à mesure, expérimentant cette attention, vous lâcherez avec ce besoin de contrôle, et vous cesserez de croire qu’ailleurs, les choses sont plus douces, plus harmonieuses. Vous cesserez surtout de croire que le bonheur n’est jamais là où vous êtes. Vous fiant à l’ici et maintenant, vous atteindrez même, j’en suis sûr, la libération complète.
Ce qui veut précisément dire pour moi, que le bonheur n’est jamais bien loin. Il est en nous, tout simplement.
Le voyage intérieur
Dès lors, si l’on considère ce que je viens de dire plus haut, il nous reste à accepter de nous ouvrir à l’instant présent. C’est ainsi que tout ce qui est autour de nous va changer. Nous cessons de continuer aveuglément dans notre fuite en avant, pour enfin nous ouvrir au monde. En cessant, désormais, de nous battre contre le monde, cherchant systématiquement à lui opposer notre volonté, pris dans les fers de la dualité, nous pouvons enfin nous réconcilier, en premier avec nous-mêmes. Car nous ne saurions être une individualité au bord du monde, ou en-dehors du monde, mais comme le disait Spinoza, je pense que nous sommes un élément du monde, et que nous devons rechercher à retrouver notre juste place dans ce monde. En se fiant à l’ici et maintenant, on peut parfaitement retrouver cette unité. L’unité originelle avec le monde.
Je dirais personnellement que c’est là accomplir une véritable révolution. La seule qui vaille. Mais c’est une révolution intérieure. Cette révolution, considérez-la comme un voyage. Le seul qui vaille. Ça n’est pas un voyage de conquête extérieur, prétendument initiatique ou ouvert sur le monde, avec pour seul but, d’aller vérifier sa maîtrise du réel, toujours illusoire. C’est un voyage de libération de nos aliénations, de nos illusions, de la scission qui s’est opéré en nous depuis le début, et qui nous éloignait de nous-mêmes. C’est un voyage qui nous fera aussi comprendre, que l’ailleurs n’existe pas, que c’est une pure illusion de notre esprit, et que seul ce qui est en nous peut être vaincu et transcender. Qu’est-ce que j’entends par là ? Je dirai une chose finalement assez simple : nous pourrons comprendre nos émotions, nos obsessions, ou encore nos habitudes et les réformer ou les améliorer si besoin était. C’est finalement l’enseignement des écoles de sagesses antiques plus près de nous, ou bouddhistes plus loin de nous. Mais au final, malgré les différences entre ces écoles, on peut retenir que la force dans l’attention sera toujours supérieure, voire plus efficace, que tous nos vains désirs de contrôle ou de pouvoir sur le monde. « Plutôt réformer nos désirs que l’autre du monde » écrivait Descartes, qui était assez stoïcien. Je dirai qu’il faut cesser avec la force et le désir, en effet, et apprendre à se connaître intérieurement, pour pacifier nos tensions, et ainsi pacifier le monde extérieur.

Paru aux éditions le Littéraire en octobre 2017
Dessin de couverture : Le voilier de Ladislas Kijno, dessin original 2003
 (Paru dans le n°3 de Spécial Philo, août-sept-oct. 2013)
(Paru dans le n°3 de Spécial Philo, août-sept-oct. 2013)
En couverture : Michel CIRY - Le bateau échoué, eau-forte originale signée.
Commentaires
Well...Longue, copieuse, riche et déliée lecture...Complexe complète..."On " a le temps de s 'arrêter et de se voir réagir à certaine des propositions...La fin du texte n'est pas annoncée dans la proposition de départ: " le voyage ": elle surprend...Une pensée a fait le pont, le joint, en moi, évidente: en voyage, sans repères ( ni repaires ), mais quand on se sent à l'aise, c 'est juste " ça " qui se produit: on a lâché, sans le vouloir, et ce qui arrive ( ou simplement ce que l'on croise, et qui " est " ), on le vit " directement ", tout neuf, " sans autre " (comme disent les suisses ) : tout entier dedans, ici-maintenant, présent, ouvert, fluide et sans attente: on prend, "c" est libre...Un contact au présent qui se renouvelle, auquel on adhère, par sensations, vibration, intensité tranquille...Cette pensée m'a consolé d'avoir quand même à me compter parmi les relatifs " sédentaires "...Cette pensée, et celle que, peut être, c 'est aussi affaire de nature profonde ( et peut être de """" karma """, de stade d 'évolution individuel et passager... ... ... ) Et aussi ( encore ), le souvenir de quelques pages du grand livre de la vie de Bouvier et de son ami voyageurs ( tous deux si " doués " en la matière ( et solidement suisses, structurés, organisés, courageux, volontaires, etc...): Nicolas, seul sur une route improbable et perdue de son premier Japon, marchant sans but, tout à coup absolument perdu pour lui-même, douloureusement poreux, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'angoisse et la souffrance, déboussolé en profondeur: bref, dépaysé juqu'au trognon, fragile, au bord de se dissoudre...Comment ne pas craindre, alors, nous, les plus vulnérables, les plus " à coquille " ?...La " sédentarité " physique n 'est parfois qu'une nécessité de survie, pas une honteuse reculade....Me suis dit ça, et tant de choses !!! Merci, donc, pour ce texte, ce " travail " !!!