Qu’est-ce qu’une vie réussie ? (Épicure, Sénèque, Spinoza, Hadot & co.)

Qu’est-ce que réussir sa vie ? C’est-à-dire : qu’est-ce qu’une vie accomplie ? Et qu’est-ce qu’une vie réalisée en conformité avec soi et les autres ? À la fois anthropologique, sociale, éthique et presque métaphysique, cette question nous concerne tous. Pourquoi ? Parce que précisément, c’est une question qui pose le problème du bonheur. Sommes-nous heureux ? Pouvons-nous aspirer au bonheur ? Et surtout qu’est-ce qu’une vie heureuse ? Cet article est paru dans le numéro 22 des Carnets de la philosophie, en septembre 2012. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
“Je suis d’accord en cela avec les stoïciens, concernant la nature des choses : ne pas s’en écarter, se former sur sa loi, voilà la sagesse. La vue heureuse est donc celle qui est en accord avec sa nature”, Sénèque.
On associe aujourd’hui le bonheur à la réalisation de tous ses désirs et de tous ses besoins. Mais la poursuite en question parait vaine, d’emblée impossible car comment faire pour parvenir au bout de cette recherche. Or, si l’on ne parvient pas à tout réaliser, nous ne serons pas heureux. Aucune lueur d’espoir de bonheur. C’est Michel Houellebecq qui dit : « N’ayez pas peur du bonheur ; il n’existe pas. »[1] Le bonheur est étymologiquement ce qui est de l’ordre de la chance ou du bon augure… Sommes-nous nés ou non sous une bonne étoile quand la vie nous sourit ? Et nous sourit-elle tout le temps ?
Peut-être faudrait-il distinguer d’abord les divers types de réussites. Luc Ferry tente cette classification que je reprends ici :
1. Réussir, une affaire personnelle dans l’esprit de conquête ?
2. Réussir, s’engager et s’investir dans notre relation aux autres ?
3. Réussir, s’en tenir à la sphère privée, et à l’amour pour les siens (amitié, famille ?
4. Réussir, se perfectionner et se dépasser pour soi et non pour les autres ?[2]
Je vais ainsi démontrer que le bonheur est accessible à tous. Qu’il est certes fragile et simple, mais que nous pouvons tous réussir nos vies, et donc être heureux, si nous prenons juste le temps de changer notre regard.
1. Qu’est-ce que réussir aujourd’hui ?
Le culte de la performance et le bonheur
Commençons par un constat : le désarroi de l’individu que l’on nous promet depuis longtemps est bien une réalité présente, pour une raison simple : il ne peut plus avoir le sens de l’autre aux prises d’une société sans projet collectif, qui lui ressasse, telle une injonction impitoyable, d’« être lui-même », laissant ainsi ce dernier à son autonomie. Aussi, seul « l'effritement des frontières entre le privé et le public » témoigne apparemment du fait que, par le recul du politique, la subjectivité est devenue une question collective. Il nous faut en réalité retenir que l’individualisation rejoint la contractualisation dans la sphère productive. De fait, le devoir de production de soi précède sa nécessité pour une civilisation hyper-technicienne qui exprime sa nouveauté dans des significations déjà là dont elle épouse les formes. On s’aperçoit alors combien les mots : contractualisation, individualisation, personnalisation, autonomie ne sont que le résultat d’une lutte idéologique intense.
De fait, nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous réduisons notre recherche au simple confort individuel. On refuse d’en savoir trop sur son être intime. On refuse de s’ouvrir à l’autre, happés que nous sommes, par le modèle dominant de l'économie libérale qui prétend élargir les libertés subjectives, alors qu’il les limite terriblement, transformant le sujet en une individualité biologique à laquelle il réclame performance et productivité, ce qui arrange d’ailleurs le système social. Un principe que Lefort explique bien : « La division du social conditionne l'unité de la société, le conflit permet de faire tenir un groupement humain sans qu'il n'ait besoin de justifier son sens en se référant à un ailleurs et sans qu'un souverain décide pour nous. C'est là le noyau du politique en démocratie. » En contrepartie, le système abolit toute réflexion sur soi. Il s’agit pour l'homme moderne de l'économie libérale d’être lisse et sans conflits. Semblable à un ordinateur, il ne doit jamais offrir le spectacle d'une quelconque défaillance. Cette absence de défaillance, on appelle cela aujourd’hui le bonheur.
Le souci narcissique du pouvoir illimité
Selon les antiques, le bonheur, c’est ce qui oriente et détermine les actions humaines. Il s’agit tout d’abord pour Platon de s’opposer aux sophistes dont il résume les positions dans plusieurs de ses dialogues. Pour eux, le bonheur dépend de la fortune (au double sens du hasard et de la possession des biens matériels). Étymologiquement, la signification du mot « bonheur » n’est pas étrangère à celle qui nous vient du latin Bonum augurium qui signifie « bon présage ». Les sophistes, comme en témoigne Calliclès dans le Gorgias, affirment que le bonheur est tributaire de ce que la nature a conféré à chaque homme ; est heureux celui chez qui, par nature, existe un équilibre entre les désirs et les facultés. En effet, le bonheur ne se goûte qu’à condition que les désirs n’aillent pas au-delà des possibilités de leur satisfaction. Selon cette optique, sera le plus heureux celui qui aura les désirs les plus grands et le plus de moyens de les assouvir (un tyran par exemple). Le bonheur est donc inséparable du plaisir (on l’appelle hédonisme) et, plus encore, se mesure à l’intensité de ce plaisir. Dans le Philèbe, Socrate s’oppose à Calliclès en affirmant que les désirs ont quelque chose d’incontrôlable et qu’ils tiennent en leur pouvoir celui qui s’adonne à la jouissance sans limites, le « débauché ». Le plaisir, dit-il, appartient au genre de l’illimité, ce qui implique qu’il ne possède pas une nature propre et ne peut par conséquent pas être un bien en lui-même. En effet, jouir ne va pas sans le sentiment de la jouissance, anticiper ou se remémorer un plaisir ne va pas sans la pensée de ce plaisir, etc. D’autant que la « vie de plaisir » est marquée du sceau de l’incomplétude. Et elle peut facilement conduire à terme à la dépression…

Le sophiste Gorgias durant ses cours
La fatigue d’être soi
En suivant le sociologue Alain Ehrenberg, on peut dire que la dépression nous instruit sur notre expérience de la personne, car elle est la pathologie d'une société où la norme n'est plus fondée sur la culpabilité et la discipline, mais sur la responsabilité et l'initiative : « L'individu est confronté à une pathologie de l'insuffisance plus qu'à une maladie de la faute, à l'univers du dysfonctionnement plus qu'à celui de la loi : le déprimé est un homme en panne. » En dépit des quelques accointances avec la plus classique et très ancienne mélancolie, la dépression — le trouble mental aujourd'hui le plus répandu dans le monde — a une histoire tout à fait récente, que le sociologue retrace dans son ouvrage La fatigue d'être soi[3]. Notre dépression prend la suite, sans s'y confondre, de la première maladie à la mode, la neurasthénie, dont on ne pouvait pas ne pas souffrir si l'on était homme (et surtout femme) vivant pleinement son temps, entre la fin du siècle dernier et le début du nôtre. Mais quand Freud interprétait la névrose comme résultat d'un conflit entre le désir et la loi, et symptôme d'une culpabilité, Pierre Janet y voyait déjà le signe d'une déficience, d'un manque d'énergie du sujet, bref, d’une dépression. De la névrose à la dépression, de la difficulté de l'identification aux troubles de l'identité, sur fond de revanche posthume de Janet sur Freud, cette généalogie de l'individu contemporain qu'esquisse Alain Ehrenberg a le mérite de nous apprendre combien la souffrance actuelle d'être soi-même pèse sur notre psychisme, et altère, voire atomise notre bonheur quotidien et notre bien-être. Elle nous montre également que nous n’écoutons jamais nos vrais besoins, trop accaparés à satisfaire tous nos désirs.
2. Peut-on distinguer entre vrais et faux besoins ?
De la souffrance à l’ennui
Schopenhauer montre bien le lien du désir au besoin et au manque[4]. Ainsi, écrit-il, le fait de vouloir est toujours engendré par le manque, celui-ci étant identifié immédiatement à la souffrance. Le désir étant infini, cela empêche la plénitude de la satisfaction d’un désir particulier, puisque celle-ci ne peut être complète dans la mesure où complète cette satisfaction empêcherait un autre désir de se réaliser. À cela se rajoute la durée de cette plénitude, très partielle, dont le seul but est de laisser place à d’autres désirs. C’est pourquoi le désir ne saurait promettre ni bonheur ni repos. Il n’y a pas de satisfaction totale des désirs, au sens où la plénitude ou à la tranquillité permettrait à l’homme le repos : selon le philosophe allemand, toute satisfaction conduit à l’ennui, donc, à la nostalgie du désir. La souffrance est le lot de chacun, soit parce que les hommes ne savent pas faire sans le désir ; soit parce qu’en son absence, ils s’ennuieraient trop. Dans le mouvement sans fin qui mène les hommes de la souffrance à l’ennui, l’instabilité et l’intranquillité est au centre de la volonté, mère de toutes les souffrances chez Schopenhauer. La seule issue serait de nier la volonté et de remonter dialectiquement vers le monde de la contemplation, mais seuls quelques esprits supérieurs en sont vraiment capables selon le philosophe le plus pessimiste de l’histoire de la philosophie.
Des désirs essentiels
Comment sortir de cette spirale ? Ne faut-il pas s’en référer à la catégorisation des désirs d’Épicure qui dresse une frontière entre les désirs naturels et les désirs vains : différenciant les premiers comme nécessaires au bonheur, les deuxièmes comme bons pour le bien-être du corps, les troisièmes comme strictement vitaux. Par une telle catégorisation des désirs, on peut alors se protéger de la souffrance et du tourment. Au centre de cette recherche, bien sûr, on trouve une philosophie hédoniste qui pose le plaisir comme le premier des Biens. Ici, le plaisir ne sera pas la recherche effrénée de tous les plaisirs, mais le plaisir au sens de tranquillité de l’âme, et d’absence de souffrance du corps.
On pourrait tout autant dire qu’il nous faut distinguer les désirs dont la réalisation dépend de nous de ceux dont la réalisation ne dépend pas de nous.
1) Ce qui dépend de nous
C’est Pierre Hadot qui a cette formule pour décrire la pensée stoïcienne, il parle de « Citadelle intérieure » afin de décrire nos représentations, nos désirs et nos pensées. D’abord, le désir ne dépend pas de nous. Nous ne sommes jamais à l’origine de nos désirs ; en revanche, nous sommes responsables de ce que nous faisons de ces derniers. Souvent, de manière totalement aveugle, nous cherchons à les satisfaire sans jamais nous arrêter, au moins un instant, sur leur origine. Incapable de les satisfaire tous, nous courrons sans cesse, sans jamais vraiment nous demander ce que notre esprit peut face à ces désirs. Qu’est-ce qui dépend de nous ? C’est ce que se demandent les stoïciens. Pouvons-nous être heureux alors que le cours du monde et la réalisation de nos désirs, souvent, ne dépend pas de nous ? Jamais à l’abri de l’infortune ou d’un coup du sort, comment répondre à la perte d’un être cher ou à un revers ?
2) « Changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde »
Les stoïciens placent la réponse dans nos représentations. Nous devons travailler sur la manière dont nous accueillons les événements et sur nos jugements. Un mot d’ordre, celui que reprendra à son compte Descartes : « changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde » !
Quelle méthode ? Accepter les événements tels qu’ils arrivent. La seule chose qui dépende entièrement de nous, ce sont les représentations que nous nous faisons des choses. Les représentations ne sont pas dans les événements eux-mêmes. Elles viennent de moi. L’illusion est de croire que ce qui vient de moi vient de l’événement. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu’ils portent sur les événements.

Pierre Hadot
3. La métamorphose des désirs
Le désir comme essence de l’homme
Pour Spinoza, le désir (ou plus généralement le conatus comme effort pour persévérer dans son être) est la nature de l’homme. La valeur des choses n’existe pas « en soi » : c’est parce qu’elles sont désirées que les choses sont jugées bonnes, non l’inverse. De plus, une raison qui ne s’appuierait pas sur le désir serait profondément impuissante. C’est au cœur même du désir que peut prendre place une morale ou une éthique. Aux passions, il faut substituer des affects actifs : le désir devient ainsi affirmation de soi.
1) L’individu passionné
Il faut se questionner sur la passion. Car si nous avons montré comment Spinoza réhabilitait cette dernière, posant la Joie comme la finalité de toute action humaine animée par le conatus donc la puissance d’agir et de persévérer dans son être.
Ce qui caractérise concrètement la passion, ce sont la servitude et la souffrance. En faisant de la passion, non plus une simple modalité de la connaissance [mais] essentiellement une modalité du Désir, il apporte une modification importante à la passion qui, jusque-là, était comprise comme une action essentiellement passive.
Par le conatus, la passion peut conduire à la passivité de la Tristesse, ou à l’activité de la Joie. Une fois cette distinction fondamentale qu’il intègre dans la notion de passion, qu’il réhabilite et refonde, il oppose à la servitude, jusqu’ici associée à la passion, la liberté. On a coutume de dire, à juste titre, que Spinoza conteste à l’homme toute forme de liberté ou de libre-arbitre.
La liberté est constituée pour l’individu quand son action est conforme aux idées adéquates. Le vrai nom de la liberté spinoziste est l’action adéquate, c’est-à-dire l’action autonome et personnelle, même si ces deux termes n’existent pas littéralement chez Spinoza. Cette conception nouvelle de la liberté nous permet de mieux comprendre en quoi, la conception de servitude selon Spinoza est moderne.
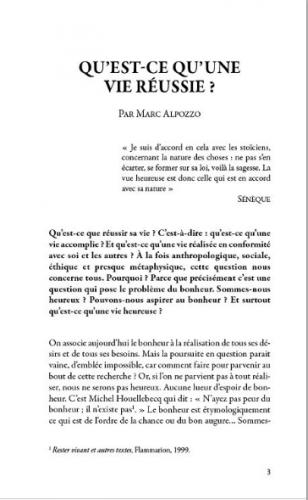
Un extrait de cet article paru dans Les
Carnets de la philosophie, n°22, d'oct. 2012
La servitude résulte d’une modalité de l’action produite de l’extérieur. Si donc, l’action est adéquate, c’est-à-dire produite de l’intérieur, selon une connaissance adéquate des causes de notre action, nous pouvons alors réaliser notre sortie hors de la servitude, sans pour autant condamner toutes les passions qui ne sont pas, rappelons-le, affects passifs. Afin de mieux saisir cette part innovante de Spinoza, il nous faut d’ors et déjà en appeler à d’autres notions qui sont l’imagination, l’ignorance, et l’illusion.
Que désirons-nous quand nous désirons ? Quelles sont les causes qui animent nos actions ? Première cause, l’imagination qui joue un rôle prépondérant dans notre course aux biens désirés, exerçant sur nous une action coercitive, nous menant à confondre l’objet de notre désir avec notre désir de l’objet. Pour comprendre la mécanique de la servitude. C’est cette imagination qui, le plus souvent, produit les buts désirés, c’est-à-dire les biens et les valeurs que l’individu croit connaître et découvrir alors qu’il les invente confusément sans savoir qu’il le fait et donc sans savoir ni pourquoi ni comment il le fait.
Cette par-là de l’imagination, affective et passive, introduit alors les illusions trompeuses : richesse, gloire, honneurs, plaisirs qui sont de « faux biens » n’ayant aucune valeur objective, mais qui asservissent l’homme et le soumettent à la douleur et à la tristesse. Ça n’est donc plus le corps qui est source de souffrance pour l’âme, mais l’esprit, et précisément, l’imagination qui, étant source de « connaissances inadéquates », inspire des « actions inadéquates ». Nous savons que Spinoza n’implique pas la volonté. C’est l’imagination qui est ici en cause. Elle nous pousse à confondre réalité et imaginaire. Elle pousse l’esprit à désirer des biens imaginaires. Il convient donc d’établir une éthique qui repositionne fondamentalement les notions de Bien et de Mal, en séparant ce qui est bon, pour le déploiement de la puissance de l’individu, et ce qui ne l’est pas.
Il s’agit donc selon Spinoza de combattre la vie passionnelle, non parce qu’elle serait pécheresse, mais parce qu’elle serait aveugle, douloureuse, et asservissante.
2) L’individu libéré
Spinoza a montré que lutter contre les passions n’implique ni la volonté ni la connaissance du Bien et Mal, mais le Désir qui est le moteur même de la « libération », car il est son énergie. Entendant instaurer la liberté plus que le Bien, Spinoza fait intervenir la connaissance qui, par le Désir, permet d’échapper à la passivité. Or, la passivité est, nous le savons, ce qui constitue la servitude.
La connaissance est capable de transformer les affects passifs en affects actifs, c’est-à-dire les passions en actions. Mais il faut encore pour Spinoza établir la possibilité de la connaissance. Il va, pour ce faire, recourir à sa théorie de l’affectivité, c’est-à-dire des affects. En d’autres termes, qu’ils soient actifs ou passifs, actions ou passions, toujours l’affect est un contenu de conscience, et ce, même s’il demeure relié au corps. L’essence de l’homme est Désir, c’est-à-dire conatus, effort pour persévérer dans son être. La connaissance libératrice est alors le passage de la conscience à la connaissance. L’esprit pouvant se prendre pour objet de connaissance permet ce passage de la conscience à la connaissance. Et c’est l’examen qui permettra le passage de la conscience inadéquate et trompeuse à la connaissance adéquate. Par cette connaissance réflexive, un Désir de joie se transforme en Désir de liberté, et se réalise comme liberté et comme joie.
Ce que l’on peut alors retenir : c’est que la vie de l’homme libre est la conséquence directe d’une doctrine de l’homme comme unité, comme désir, et comme réflexion. Ça n’est plus le puritanisme ou l’autorité qui régulent les comportements de l’homme, mais l’unité des puissances du corps et de celles de l’esprit, qui leur permet un accroissement équilibré et réfléchi.
Être de désir et de raison, l’homme libre bénéficie de la force intérieure, n’est pas en conflit avec autrui, et fait montre de générosité et de fermeté.
L’homme libre est donc épris de joie vitale, se préoccupant à la fois de la joie d’autrui et de la sienne propre, et fuit la mortification du néant.
La morale spinoziste est une morale de la joie véritable. Qu’est-ce à dire ? Cette morale de la joie est la conséquence directe de l’unité du corps et de l’esprit dans la doctrine de Spinoza.
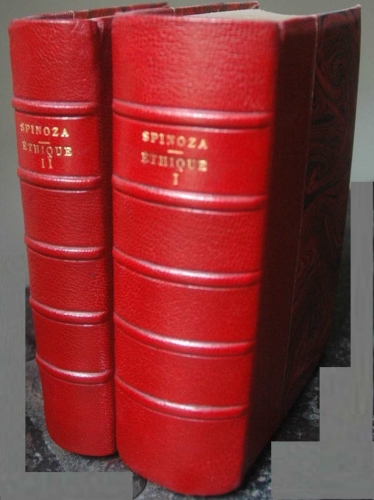
Les Oeuvres complètes de Spinoza
4. De la joie à la béatitude
Le bonheur de Sisyphe
C’est Philippe Delerm qui écrit ce texte assez fort philosophiquement : « Tous ces petits bonheurs si simplement gagnés parce que le temps peut s'arrêter, et mesurer l'effort avant de repartir, tous ces petits bonheurs comptent dans une vie, font la terre plus douce, le plaisir meilleur, et Sisyphe va s'arrêter. Tant pis pour la malédiction des dieux. Le vent souffle sur son visage un air de liberté, comme la terre est belle ! Comment avait-il pu ne pas la regarder ? Le monde est un spectacle, le bonheur ne se compte pas. La pierre a dévalé la pente, peu importe. C'est un matin de plein été, et l'air comme l'eau, juste avant le soleil de la journée. Il faut imaginer Sisyphe heureux.»[5]
Que nous dit-il ? Le bonheur est souvent représenté comme passé à venir. Lui cherche à saisir le bonheur présent, il décrit celui de la contemplation à l’effort.
Le sage, c’est cet homme qui n’attend rien
Le sage n'espère rien, ne craint rien. Il se laisse en effet surprendre. Mais par-dessous tout, il accepte l'événement, il l'accueille tel qu'il vient, sans le juger ; qu'il soit bon ou mauvais, il sait le mettre à profit, il sait en tirer son parti. C'est le seul homme à être véritablement heureux, tandis que les autres comme des funambules semi-éveillés tentent autant qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent sur ce mince fil tendu qu'est le chemin de la réalisation des désirs (entre peur, inquiétude, souffrance, déception et frustration). Cette troisième voie, nous pouvons l'atteindre. Probablement devons-nous tout d'abord, nous défaire de nos projections et apprendre à vivre en conscience. Autrement dit, il nous faut nous éveiller à l'instant présent...
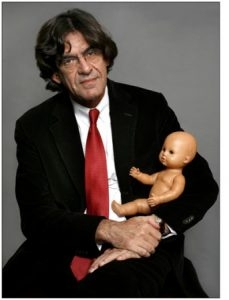
Luc Ferry
 Paru dans les Carnets de la philosophie, n°22, du 11 septembre 2012)
Paru dans les Carnets de la philosophie, n°22, du 11 septembre 2012)
En ouverture :
Sandro Botticelli, Vénus et Mars, datant de 1483 environ, conservée à la National Gallery à Londres (détail).
Commentaires
Le bonheur est un sentiment de bien -être
L'accomplissement est de sentir que la vie passée, si difficile ait elle été, a été bien "investie" et correspond à ce l'enfant en nous aspirait. S'être senti utile, avoir progressé dans les simples projets quotidiens ou exceptionnel donne un sentiment de bonheur
Les deux sont liés, mais pas toujours.
Merci marc pour cette analyse
D'après Steiner (La Philosophie de la Liberté), on commence à être libre quand on fonctionne (objectivement, pas facile !) selon ce qui est bon et juste pour le monde, et non pas selon nos désirs et opinions ...
Ce qui est juste pour l un peut être injuste pour l autre le monde est parsemés de conflits de ce genre. C'est très dure d être libre cela demande beaucoup de Sacrifices
Merci, Marc. Je relirai le texte sur grand écran, le portable porte bas…
Dans l’ordre de l’attente (et sa métaphysique), le travail de Nicolas Grimaldi (découvert grâce à toi) me fascine.
passionnant, je retrouve Hadot qui m'a ouvert des portes
Magnifique. C'est, jusqu'ici, la lecture la plus intéressante que j'aie pu entreprendre dans cet Ouvroir. Merci !