Franca Maï, le spectacle de la cruauté, note de lecture

Nourri d'une forte amitié à la ville pour la personne, et d'une grande admiration pour l'auteur, qui propose une oeuvre originale et ahurissante, j'ai réalisé en 2007, une longue analyse des romans de Franca Maï, qui est parue dans le Magazine des livres, et qui a, selon les mots de l'écrivain, convaincu son éditeur de publier son prochain roman, L’Amour Carnassier, qui paraîtra l'année prochaine, en librairie. Aussi, si l'on en croit Le Cherche midi, Franca Maï aurait une voix « proche du blues ». Cette très célèbre forme musicale que l'on doit aux noirs d'Amérique, et qui caractérise d'une part une formule harmonique constante, un rythme lent à quatre-temps, d'autre part, le cafard et la mélancolie. Mon long article désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
Dire la souffrance indicible
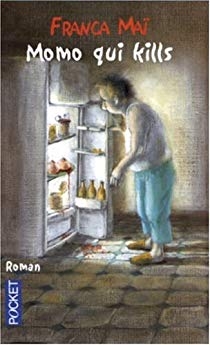 La voix de Franca Maï est une voix cassée : cassée par la violence des comportements sociaux, la barbarie de nos sociétés modernes, cassée par cet idéal humaniste qui ne semble jamais pouvoir se réaliser dans le monde des hommes. La voix de Franca Maï est une voix qui fait de l'apnée en milieu brutal.
La voix de Franca Maï est une voix cassée : cassée par la violence des comportements sociaux, la barbarie de nos sociétés modernes, cassée par cet idéal humaniste qui ne semble jamais pouvoir se réaliser dans le monde des hommes. La voix de Franca Maï est une voix qui fait de l'apnée en milieu brutal.
Depuis 2002, Franca Maï nous a offert déjà quatre romans : un roman par année. Des romans courts. D'une rapidité incroyable. Une célérité qui se révèle à chaque texte, brutalement meurtrière. Car, de quoi traite chacun de ses récits ? De la folie meurtrière des hommes, tout simplement. De leur difficulté à endosser toute leur humanité. Certes, Franca Maï n'innove pas dans ce domaine. La violence urbaine, la brutalité de la guerre, la déshumanisation silencieuse du travail à l'usine et des banlieues, la pédophilie rampante qui sévit dans les caves de nos sociétés civilisées : tous ces thèmes[1] ont été maintes fois et maintes fois abordés dans la littérature fin de siècle. Siècle de décadence, dont les pages les plus sombres dépassent en horreur ce que l’humanité a connu jusqu’ici.
Alors, quoi de neuf dans l'œuvre naissante de Franca Maï ? Le ton. Le regard. Un regard sur le monde qu'on comprend au départ, lors d'une première lecture à la fois superficielle et rapide : désabusé. Un regard sur les comportements, les psychologies, et la nature humaine. Un regard sur la cruauté de tout un chacun. Un regard proche de celui d’Antonin Artaud. Ce regard qui ne se détourne, pas même légèrement, de la cruauté, de la dureté du réel. Théâtre de la cruauté[2], au sens d’Artaud, qui introduisit le terme pour désigner la forme dramatique à laquelle il travailla. Une cruauté qui se retrouve dans l’œuvre de Franca Maï et que nous pourrions définir par ces mots mêmes d’Antonin Artaud : « ce mot de cruauté doit être pris dans un sens large, et non dans le sens matériel et rapace qui lui est prêté habituellement. » Spectacle de la cruauté au sens même donné par Artaud avec le « théâtre de la cruauté » : un art qui saura frapper au cœur de la manière la plus profonde et la plus violente le spectateur.
Prenons par exemple, son tout premier personnage[3] : Momo. Avec ce dernier, nous sommes jetés brutalement dès l'incipit, dans le cerveau d'un violeur : « Ça y est, voilà que ça me reprend. Il faut que je viole une femme. » Une approche de la violence plutôt originale. Le ton donné au texte, quel sentiment ressentons-nous suite à ces deux premières lignes ? Un sentiment de malaise. Un sentiment d’angoisse et de dégoût. Momo est un violeur qui, dès le commencement de ce premier roman, ne montre pas le moindre complexe par rapport à son état. Il vit son vice sans mauvaise conscience. Il est d'un cynisme désarmant ! Combien de lecteurs vont d'emblée mal réagir, laissant tomber ce livre aussitôt, et passant ainsi sans transition à une autre occupation ? La griffe de Franca Maï est bien là : induire dans nos esprits un réel malaise. Nous placer sans fard, face au réel. Un réel terrible, cruel avec chacun, mais bien réaliste. Un malaise à la fois physique et métaphysique. Et il est difficile de prendre connaissance avec ce mal qui, certes, est identique à tous ces maux quotidiens, banalisés par la télé, le spectacle ordinaire d'une folie ambiante, que l'on ne voit presque plus, qui meurtrit nos vies, et dans laquelle nos sociétés contemporaines s'abîment. Un malaise dans l’œuvre de Franca Maï qui est d'autant plus suscité par une écriture dénuée de toute fioriture, ou de tout regard esthétisant à outrance qui nous donnerait là l'occasion de nous élever au-dessus de cette réalité afin d'en réchapper. Le regard de Franca Maï n'a qu'un objectif : se poser de façon insistante sur le spectacle quotidien de notre cruauté.
Et chacun des quatre romans est comme quatre voix qui dialectisent, communiquent, se parlent et se répondent. La cruauté dont elles traitent, est cette férocité des egos recherchant bien souvent inconsciemment à provoquer en l'autre une souffrance indicible, mais captable par l'esprit, afin de pallier sa propre souffrance. Une façon récurrente, mais chaque fois originale de traiter du sadisme des caractères.

Franca Maï
Défier les règles de l’art
L’angoisse et le mal-être qui nous étreignent au commencement de Momo qui kills, nous suivent durant toute l'œuvre, et les suivantes. Ces sentiments sont la conséquence d'une vision réaliste, délibérément sans recul sur les petites cruautés ordinaires, sur la dureté des relations humaines, la rudesse d'un système déshumanisant, l'atrocité de certaines périodes de notre histoire, où, les hommes, en jachère libre, sont autorisés à se livrer sans limite à leur bestialité.
Subissant une barbarie froide et ininterrompue de la part de la société dans laquelle il existe, et sans disposer d'assez de rationalité ni d'assez de mots pour y répondre, Momo par exemple, sombre progressivement dans une folie meurtrière qui n'épargnera pas même son enfant qu'il finira par assassiner. Cette violence, racontée sur le fil tranchant d'une prose-scalpel, se réédite dans Jean-Pôl et la môme caoutchouc, ou encore dans Speedy Mata.
Les personnages sont tous en proie à la barbarie des hommes, des sociétés contemporaines. Une brutalité telle, que rapportée par la plume de Franca Maï, elle agresse férocement, choque sauvagement les règles d'usage du bon goût, du politiquement correct. Voilà donc toute l'habileté de son œuvre naissante : défier les règles même de l'art qui nous proposent une catharsis en nous portant loin du réel pour mieux nous y habituer. Les romans Franca Maï, par révolte des conventions, de la bienséance, de la barbarie des bavardages vaporeux de certains ouvrages qui se contentent de constater sans proposer de solution à notre mal-être, à nos souffrances, nous jettent froidement dans la férocité humaine.
Une férocité humaine qui se traduit par un autre thème récurrent dans l'œuvre de Franca Maï : la sauvagerie sexuelle. Barbarie quotidienne à laquelle les femmes sont les premières exposées. Mais également les enfants[4]. Dans le premier opus de Franca Maï, Momo est un violeur de femmes. Des femmes presque fatalistes par rapport à leur sort : par exemple cette victime qui ne veut pas serrer son vagin, comprenant instinctivement, comment échapper à la tyrannie du sexe érigée, qui, par la violence du rapport, veut la transformer en une chose-exutoire[5].
L’impossible dialogue
Le viol chez Franca Maï : un autre thème récurent. Il est physique dans ses deux premiers opus. Puis, dans Speedy Mata, et L’ultime tabou, il devient psychologique. Mental. À la lire, on croirait presque que ce viol-là est bien le pire…
Ce qui devient alors frappant si l’on étudie quelque peu les personnages de Franca Maï, c’est l’absurdité indépassable dans laquelle ils s'empêtrent, cette illusion de liberté à laquelle ils se cognent, cette quête éperdue de liberté semblant être bien plus la peur du vide qui les pousse à s’y jeter à corps perdu : folie de l’individualisme moderne et sans pitié, individualisme paradoxal dans lequel ils finissent tous par s’engouffrer. Désespérant de désespérer des hommes et de la communauté, on voit tous ses êtres chercher à se désolidariser du groupe, qu’ils finissent d’ailleurs par haïr, et dont ils ne sauraient ressortir indemnes. Incapacité pour chacun d’entrer en communication avec les autres : l'impossible dialogue. Quels mots utiliser pour faire face à la cruauté d’autrui ? Par quel langage peut-on faire front contre l’oppression du groupe, du système, contre la folie des hommes ? Ce langage existe-t-il d’ailleurs quelque part ? Cette difficulté met en lumière son impuissance : l'impuissance des mots à exprimer l'indicible. L’impuissance de certains à trouver les mots, les périphrases, pour exprimer leurs émotions, les mettre à jour, leur donner du sens, exprimer les frustrations, les angoisses, pour les éloigner de soi, se donner les moyens de prendre de la hauteur avec sa souffrance, avec la folie ambiante. Impuissance du langage qui nous enferme dans des corps, ses secousses, ses convulsions. Le corps devient une prison de l’âme, la souffrance du corps est d’ailleurs si forte que le spectacle de la cruauté devient pour le lecteur lui-même, un réel supplice. Aucun moyen pour lui de se désolidariser de ce spectacle, de prendre de la distance. Le spectacle est, à son corps défendant, un spectacle d’un réalisme troublant. Le langage dans lequel sont décrites les scènes d’horreur, de violence, de torture, est un langage délibérément simple, sans esthétisme, comme si Franca Maï voulait nous dire que le langage n’avait plus assez de force pour dynamiter le réel, pour le transformer. On pourrait en effet se demander si le langage a encore le moindre pouvoir de freiner la course folle de nos sociétés modernes. Les mots peuvent-ils encore être des bombes ? Des catalyseurs ? Tout semble absorbé et dissout dans le spectacle de la cruauté moderne…
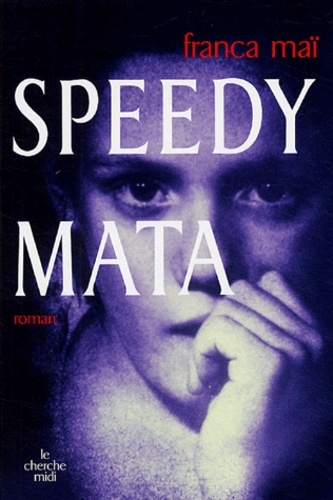
Speedy Mata (2004)
Si Dieu n’existe pas…
Que ce soit la déshumanisation par la violence sexuelle, par la guerre, ou par la société-marchande, on ressent dans les récits de Franca Maï une sorte d'inversion de la fameuse proposition de Dostoïevski : « si Dieu n’existe pas alors tout est permis », en un : « si tout est permis alors Dieu n’existe pas »[6]. Et puisque Dieu n'existe pas pour nous sauver, il ne reste plus que les armes et la violence pour le faire. Une violence salvatrice qui viendra tout emporter, nous enlever de cette cruauté existentielle dans laquelle nous sommes enfermés sans espoir de retour. Les personnages secondaires, et parfois principaux (Momo, par définition) de Franca Maï, se livrent à toutes sortes de barbaries, de sauvageries, orphelins de toute grandeur, de toute transcendance. Ignorant toute morale, toute éthique, devenus sans foi ni loi, les militaires français, dans Jean-Pôl, organisent l'interrogatoire musclé d'une jeune indochinoise, en la mutilant et la violant de nombreuses fois. Une violence insoutenable qui nous est contée par l'auteure dans des mots simples, un phrasé court, et direct. Dans Speedy, le système et le patronat sont sans pitié, sans complaisance avec les faibles, les sans-grades, ceux qui triment à l’usine, qui croupissent dans des cités-dortoirs, et qui, un beau jour, se retrouvent jetés dehors comme des pions : « Quand un porc licencie et met des milliers de travailleurs dans la rue, ce n’est pas violent !... Il garde les mains propres. Les suicides à la chaîne, les antidépresseurs ou la fuite dans l’alcool, ce n’est plus son problème… Il a fermé l’usine, il s’en lave les mains… »[7] Que reste-t-il des utopies ? De ce désir de façonner pour nous et nos enfants, un monde meilleur ? Comment réguler un système aveugle, sans transcendance, une civilisation de plus en plus violente avec les bas salaires, et les sans-grades ? Toutes ces questions se posent à travers les comportements des personnages, les histoires minimalistes, mais fortes d'une singularité à attraper et retranscrire la démence moderne, le nihilisme contemporain de certains hommes.
L’enfant-sacré de la société postmoderne
Ce nihilisme, cette démence moderne se retrouve une fois de plus dans le nouveau roman[8] de Franca Maï, bâti autour du douloureux sujet de la pédophilie. Un sujet qui semble tabou tant la moindre parution d’un roman sur le sujet déclenche un véritable raz-de-marée. Naturellement, tout le monde se souvient de la parution en 2003, d’un roman au titre évocateur : Rose bonbon[9]. Son objet : la dérive d’un pédophile. Écrit à la première personne du singulier, généreux en détails, ce livre de littérature générale créa un tollé avant de disparaître dans un oubli bien déconcertant.
Alors, devant une telle censure symbolique (je rappelle que des « biens pensants » ont tout essayé pour faire interdire ce livre en librairie, voire se livrer à un « autodafé ») la question que l’on DOIT se poser, est bien celle-ci : pourquoi tant de tapage ? La pédophilie fait-elle si peur ? Certainement : OUI ! Et pourtant ! Elle est à notre porte. Dans tous les journaux. À longueurs de JT. Le raz-de-marée d’Outreau, suite à la « cabale » injustement menée par un juge indigent et mégalomane, ne fait que nous le rappeler. Partout dans le monde, partout en France, partout dans votre région, et peut-être pas loin de votre porte, l’enfance est volée, bafouée, violée, assassinée !
Drôle de drame pour un acte qui, dans son étymologie même, est celui de « l’ami des enfants »
Alors pourquoi la littérature rechigne-t-elle à en parler ? Est-ce parce que l’enfant dans nos sociétés postmodernes, est devenu le nouveau « sacré » ? Est-ce parce que l’acte, ultime sacrilège, rendrait la parole impossible, la douleur et la peine indicibles. Rares sont ces écrivains qui, à l’instar de Nicolas Jones-Gorlin - qui n’incitait d’ailleurs pas à la pédophilie, contrairement à ce que purent dire quelques « pisse-froid » incapables de comprendre que la littérature sert aussi à dénoncer les excès et les vices de nos sociétés contemporaines -, et aujourd’hui Franca Maï, à s’emparer de ce thème brûlant par tous les pores.
Le roman de Franca Maï est épuré de tout ce qui pourrait nous éloigner des deux voix qui cousent le récit. Celle de cette mère déchirée, dépossédée. Celle du professeur, Bernard, accusé d’abord à tort, avant d’être libéré, qui vient la rencontrer, et qui lui raconte son histoire sans fard. Le dialogue est pudique, loin du voyeurisme de bazar qui remplit de plus en plus la littérature indigente de notre époque récente. Le dialogue est pudique, mais sans pour autant se refuser à aborder le fond du problème : l’amour ! L’amour pour l’enfance ! Les enfants ! Bernard est le plus proche de l’étymologie : il est l’ami de cette fillette avec qui, il va consentir à être l’amant. La question que Bernard pose à cette mère de famille : suis-je un pédophile ? Il serait bien incapable de tuer un enfant, pas plus pourrait-il leur faire le moindre mal. Mais qu’en est-il de l’amour qu’il accepte d’une pré-adolescente à son endroit ?
La mère tranche : Bernard est coupable. Car l’enfance est sacrée. L’enfant est notre nouveau sacré. D’abord intouchable, car de l’enfant émane la pureté, mais pis, intouchable car innocent. Or, qu’est-ce qu’il y a de pire que de « déposséder » l’innocence. De la piétiner. De la mastiquer jusqu’à sa cruelle extinction dans les jeux pervers de l’amour conjugués avec le sexe. Franca Maï a voulu tenter le pari, le pari de l’introspection d’un « pédophile » qu’elle a mis en parallèle avec un assassin. Les deux sont des lâches ; ils se sont attaqués à ce qui est fable, fragile, innocent. Ils se sont attaqués à l’enfance.
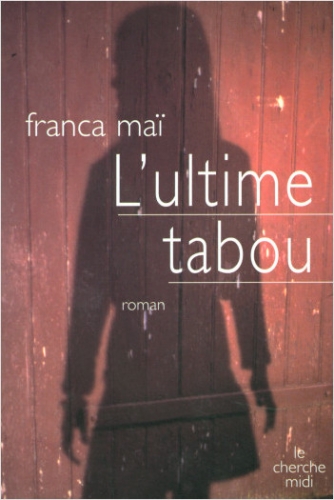
L'ultime tabou, 2005
Un roman, presque entièrement brodé par les deux voix qui se rencontrent et se nouent, est écrit selon des procédés propres au roman américain. Sans psychologisme. Les phrases sont bien souvent courtes. Hachurées. Comme pour mieux souligner l’abrupte violence de cette histoire. Son excessive démence. Son insupportable virulence. C’est sur fond de colère, contre soi-même, contre l’extrême cruauté de la nature humaine, que s’exprime le narrateur, mère de cette petite Betty, retrouvée morte, mutilée, la bouche pleine de terre.
C’est bien sûr sur fond d’horreur que se déroule le dialogue, le récit. Haletant. Dur. Enragé. Franca Maï se dispense d’un trop-plein de détails qui risqueraient de nous laisser manquer l’essentiel : l’innocence dépossédée ! Telle qu’elle l’écrit dans son épigraphe à ce roman, vif, brutal, coléreux !
Certes ! De Lolita à Rose bonbon, le sujet est évidemment traité sur différents modes ! Reste que l'enfance volée, l'innocence brisée, la pédophilie déguisée ou assumée est un fléau non pas grandissant, simplement repoussé comme une mauvaise maladie. Voilà en quoi ce roman est fort dans un premier temps. Bien sûr ! Un roman ne jouit pas du privilège de changer le monde. Il peut donner à voir sur un mode subjectif, et peut créer une empathie nouvelle ! Un roman par sa liberté avec le réel peut évidemment sensibiliser d’une autre manière, donc changer le regard sur la question. Nous donner à voir !
Dans ce nouveau roman, comme dans toute injustice faîte aux innocents, un écho, une résonance hurle au loin : celle-ci est cette troisième voix étouffée, qui prend part à la conversation, qui sans cesse couvre les deux voix ; cette autre voix, celle de la petite fille Betty, qui hurle, du fin fond de son caveau, dans les fins fonds de la société qui se consterne, mais continue de vivre comme si ces échos-là n'étaient que bruits, parasites inintelligibles. Cette voix qui vient, en même temps, donner une humanité profonde au texte. On n’oublie jamais les victimes. Elles n’ont jamais été aussi vivantes que par la voix de ceux qui les pleure, de ceux qui souffrent de leur absence. Pas de méprise !
De la sociabilité absente
Car, ne nous y trompons pas : la prose de Franca Maï n'est pas totalement désespérée. Il ne faut en effet pas en rester à une lecture superficielle qui ne retiendrait que la violence entre les êtres. Ce n’est pas une littérature d'un pessimisme sans appel. Ce dont l'auteure parle avec tant d'insistance, c'est de ce que Kant avait appelé, en un autre temps : l‘insociable sociabilité. Cette formule presque paradoxale qui pose comme principe que : d’une part, les hommes sont sociables, car cette sociabilité sert leurs ambitions personnelles, puisque celles-ci ne trouvent satisfaction que dans une société où chacun commande aux autres et tire profit de cette coopération. D’autre part, qu’ils sont insociables parce que leur appétit de domination engendre une rivalité souvent impitoyable. Le paradoxe de la formule traduit ainsi la situation paradoxale et contradictoire dans laquelle se trouve chaque homme face à un tiers. Et précisément les personnages de Franca Maï de souffrir de ne pouvoir trouver en l’autre cette sociabilité nécessaire, rendus à leur seule insociabilité…
Momo est un salaud. Il viole des femmes. Il organise le crime à grande échelle d'une société qu'il méprise, et contre laquelle il n'a pas les mots pour lutter. Mais il souffre de ne pas trouver face à lui assez d’humanité pour le sauver de son désarroi, de son nihilisme. Et lorsqu'il assassine son enfant, voilà que son geste est commandé par sa seule charité humaine : « Je l'ai embrassé tendrement. Mon petit bout de chair innocent qui croyait encore à l'humanité. Je ne voulais pas qu'il vive la désillusion. […] Alors, j'ai pris l'oreiller et j'ai appuyé de toutes mes forces. […] Et je vous jure que c'était douloureux de commettre un tel acte, mais je ne pouvais cautionner ce que l'existence lui réservait, fatalement. Il fallait que je la sauve. Et c'est ce que j'ai fait. »[10] Jean-Pôl, comme sa mère prostituée, sont deux figures bouleversantes, qui, contre tous ceux qui les oppressent, qui tentent de les niveler à leur agressivité, à leur fureur, cherchent un peu de lumière dans ce monde qui semble voué aux ténèbres. Mata, révoltée par le suicide de sa mère qui lui portait tant d'affections, prend les armes pour assassiner ces patrons, responsables de ce suicide. Chaque fois, les personnages principaux de Franca Maï ont un cœur rempli de sang. Ils sont des êtres humains, à part entière, spoliés, déçus d’avoir été jetés dans un monde déshumanisant, désinhibant, où la violence, l'utilisation de l'homme par l'homme, la rancœur et l'aigreur, manoeuvrent toutes les subjectivités. Face à la décadence contemporaine, face au nihilisme moderne, demeurons tout de même optimistes, semble nous dire la littérature de Franca Maï ; il reste quelques rebelles : Momo, Jean-Pôl, Mata, Bernard, la mère de Betty. Chacun, à sa manière, avec son intelligence et ses moyens, va lutter contre l'oppression du groupe, la violence de la collectivité, la barbarie à visage humain. Et c'est ainsi que se cache une belle leçon de vie, sous la plume abrupte de Franca Maï, plume alerte, sans rémission sans compromission, nous livrant un réel brut de décoffrage, sans appel, décrivant avec un réalisme trash, et dans un langage ultramoderne, celui du XXIème siècle, - siècle de toutes les turpitudes ? Siècle sans Dieu ? – qu'il n'est pas utile de chercher désespérément à changer le monde : l'essentiel est de se changer soi-même…

Franca Maï (1959-2012) in Fascination de Jean Rollin
Bibliographie de Franca Maï:
Momo qui kills, Le cherche-midi éditeur, 2002
Jean-Pôl et la môme caoutchouc, Le cherche-midi éditeur, 2003
Speedy Mata, Le cherche-midi éditeur, 2004
L’ultime tabou, Le cherche-midi éditeur, 2005
En couverture : Brigitte Lahaie et Franca Maï dans Fascination (Rollin, 1979)
________________________________________
[1] Hormis peut-être celui de la pédophilie.
[2] Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Folio-essai
[3] Momo qui kills, Cherche midi éditeur & Pocket
[4] L’ultime tabou, Le cherche-Midi éditeur, 2005.
[5] « Elle le faisait exprès, la garce de s'élargir comme une voie de garage. Elle refusait de coopérer… », Pocket, Paris, 2004, p.16
[6] J’emprunte cette inversion à André Glucksman, Dostoïevski à Manhattan, Grasset, 2002.
[7] Speedy Mata, Le cherche midi éditeur, Paris, 2004, p.60
[8] L’ultime tabou, Le cherche midi éditeur, Paris, 2005.
[9] Nicolas Jones-Gorlin, Rose bonbon, Gallimard, 2003.
[10] Ibid., p. 107