John Brunner : Une histoire secrète du vingt-et-unième siècle

Pendant longtemps, on a classé la littérature d’anticipation comme une sous-littérature. C'était avant que celle-ci ne passe de sous-genre à genre total. La raison en est très simple, et je l'expose dans ce billet. Cet article a été écrit en janvier 2006. Je le retrouve avec bonheur dans mes tiroirs et le remets aussitôt en ligne dans ces pages.
« Nous appelons ’’plateau’’ toute multiplicité connectable avec d’autres par tiges souterraines superficielles, de manière à former et étendre un rhizome[1]. » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, tome 2 : Mille plateaux, Ed. de Minuit, 1980, p. 33).
 Pendant longtemps, on a classé la littérature d’anticipation comme une sous-littérature, avant que celle-ci ne passe, non seulement à cause d'une déliquescence certaine d'une littérature dite "blanche" dans laquelle elle s’enferme progressivement depuis déjà vingt ans. Vers les années 2010, la SF, comme le roman policier, ou même la B.D., est passée de sous-genre à genre total. La raison en est très simple : depuis de nombreuses années, le roman policier et la SF abordent de thématiques très contemporaines, plutôt brûlantes, et dotées d'un champ de liberté suffisant pour exploiter des questions politiques et métaphysiques, que la littérature générale aujourd'hui, est forcée de négliger, au regard du formatage actuel, et du politiquement correct.
Pendant longtemps, on a classé la littérature d’anticipation comme une sous-littérature, avant que celle-ci ne passe, non seulement à cause d'une déliquescence certaine d'une littérature dite "blanche" dans laquelle elle s’enferme progressivement depuis déjà vingt ans. Vers les années 2010, la SF, comme le roman policier, ou même la B.D., est passée de sous-genre à genre total. La raison en est très simple : depuis de nombreuses années, le roman policier et la SF abordent de thématiques très contemporaines, plutôt brûlantes, et dotées d'un champ de liberté suffisant pour exploiter des questions politiques et métaphysiques, que la littérature générale aujourd'hui, est forcée de négliger, au regard du formatage actuel, et du politiquement correct.
Par exemple, avec Maurice G. Dantec (qui nous gratifiait en 1996 d'un polar futuriste, ou d'un roman d'anticipation en 1998, prenant racine dans notre époque contemporaine, il nous est possible de balayer les décombres du siècle dernier sans censure ni tabous), avec Michel Houellebecq, qui publie dans la collection blanche, un roman clairement d'anticipation (La possibilité d'une île, 2005), on peut réfléchir à une société sans travail, où les hommes deviennent des monades repliées sur elles-mêmes, dont la vie sociale est essentiellement numérique et virtuelle. On s’en aperçoit rétroactivement, en observant toutes les excellentes œuvres parues durant la seconde moitié du vingtième siècle, que la SF ne décrit pas (ou plus) le futur, mais bien notre présent, dans sa plus cruelle réalité.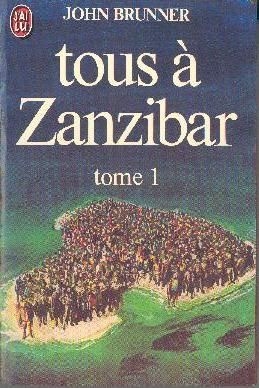 Prenons donc l’œuvre majeure de John Brunner Tous à Zanzibar. Ce qui choque alors, c’est l’actualité de ce roman : son entière dévotion à un présent total, réaliste, contemporain. Quand observe le monde occidental de ce début de 21ème siècle, c’est sa passivité, son conformisme, sa tranquillité, sa sérénité artificielle, toute entière fidèle à son bien-être et sa consommation quotidienne. Comme dans le Stalag, où il était interdit moralement de parler de la mort, de la nourriture, ou d’une vie qui aurait eu lieu avant ces terribles camps (voir à ce propos Le devoir de mémoire de Primo Levi), on ne doit pas trop déprimer nos contemporains, il ne faut surtout pas parler de l’époque que décrit John Brunner, sans revenir sur soi, sa famille, son indigence. Voilà pourquoi des livres sans substance, traitant de la télé-réalité, de sa famille de trisomiques, de son bébé, etc. sont les coqueluches du moment. Et que fait-on de nos peurs, certes refoulées dans notre inconscient collectif. De ce pacte sino-soviétique fort probable qui risque de notablement changer la donne. C’est ce dont parle Brunner : la guerre en Chine, la surpopulation, la violence urbaine qui l’accompagne, les drogues, le conditionnement des esprits par les États et les grandes corporations. Terrorisme, pollution, recherches génétiques, dont la politique eugéniste des États a plutôt intérêt à être intelligemment gérée si l’on ne veut pas courir à une catastrophe !
Prenons donc l’œuvre majeure de John Brunner Tous à Zanzibar. Ce qui choque alors, c’est l’actualité de ce roman : son entière dévotion à un présent total, réaliste, contemporain. Quand observe le monde occidental de ce début de 21ème siècle, c’est sa passivité, son conformisme, sa tranquillité, sa sérénité artificielle, toute entière fidèle à son bien-être et sa consommation quotidienne. Comme dans le Stalag, où il était interdit moralement de parler de la mort, de la nourriture, ou d’une vie qui aurait eu lieu avant ces terribles camps (voir à ce propos Le devoir de mémoire de Primo Levi), on ne doit pas trop déprimer nos contemporains, il ne faut surtout pas parler de l’époque que décrit John Brunner, sans revenir sur soi, sa famille, son indigence. Voilà pourquoi des livres sans substance, traitant de la télé-réalité, de sa famille de trisomiques, de son bébé, etc. sont les coqueluches du moment. Et que fait-on de nos peurs, certes refoulées dans notre inconscient collectif. De ce pacte sino-soviétique fort probable qui risque de notablement changer la donne. C’est ce dont parle Brunner : la guerre en Chine, la surpopulation, la violence urbaine qui l’accompagne, les drogues, le conditionnement des esprits par les États et les grandes corporations. Terrorisme, pollution, recherches génétiques, dont la politique eugéniste des États a plutôt intérêt à être intelligemment gérée si l’on ne veut pas courir à une catastrophe !
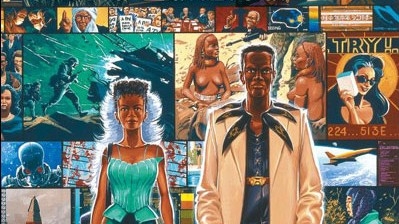
Tous à Zanzibar
Tous à Zanzibar en fait son thème de prédilection. De quoi est-ce que je parle ? Eh bien, précisément du retour à l’« animalité » pour l’espèce humaine. Pas de surhumain dans cette civilisation, qui étouffe les instincts primitifs des hommes. John Brunner décrit une société post-hobbésienne. Lorsque le contrat passé entre tous les garde d'une tendance à la violence innée sur leurs congénères. Nous sommes, à présent, déterminés par un système pensé au détail près, qui annihile nos instincts naturels, instincts à l’origine de cette guerre de tous contre tous, dont parle Thomas Hobbes. La défiance, la rivalité et la violence entre les hommes, se sont effacées au profit d’un jeu social dissimulant chacun, ne réjouissant personne. Or, qu’en est-il de l’homme, à présent ? La question mérite d’être posée, surtout au sein d'un état social qui semble répondre à tous les besoins, tous les désirs, et qui prétend aligner toutes les têtes sur le même plan, afin de rendre tout un chacun l’égal de chacun. John Brunner répond lui-même à cette question, en grand garçon, reposant l’ensemble des névroses induites en nous, par notre environnement, que nous aurions défait de son hostilité naturelle, pour enfin bâtir une identité nouvelle, - mais est-elle unique ? Pouvons-nous créer une espèce supérieure de singes (les sur-singes ?) Sugaiguntung est l’un des personnages auquel Brunner donne un visage des plus humains. Il est un généticien génial, chargé du programme eugéniste "yatakangais". Faire des orangs-outangs, les égaux des hommes. Résultats des courses : quatre sur cinq se suicident. S’ils sont, en effet, génétiquement modifiés, il demeure toutefois, qu’on ne donne pas à l’animal un visage humain.
 Sur cette planète, si proche de nous, en termes scientifiques et techniques, ainsi, qu'en ce qui concerne l’année, 2010, toutes les peurs les plus irrationnelles, émeutes raciales, terrorisme, citoyens ordinaires (les « muckers ») ne supportant plus soudain, la pression, et le monde qui les entoure, se mettent à tuer au hasard, jusqu’à ce que la police les abatte. Les êtres vivants, génétiquement modifiés, etc. sont présents, comme pour nous rappeler, que la jungle que nous avons voulu fuir, en créant le corps social, s'est reproduite de manière plus subtile et plus effrayante encore. La SF, comme les mythes grecs, nous parle de nous. Elle nous projette dans un futur onirique, allégorique, pour nous dresser un tableau (supportable ?) de la modernité. Elle donne à voir, rend visible le sombre tableau contemporain de notre misère, de nos sociétés les plus décadentes. Elle vomit un panorama dérangeant, de notre nature humaine, que l’on peut si difficilement chasser.
Sur cette planète, si proche de nous, en termes scientifiques et techniques, ainsi, qu'en ce qui concerne l’année, 2010, toutes les peurs les plus irrationnelles, émeutes raciales, terrorisme, citoyens ordinaires (les « muckers ») ne supportant plus soudain, la pression, et le monde qui les entoure, se mettent à tuer au hasard, jusqu’à ce que la police les abatte. Les êtres vivants, génétiquement modifiés, etc. sont présents, comme pour nous rappeler, que la jungle que nous avons voulu fuir, en créant le corps social, s'est reproduite de manière plus subtile et plus effrayante encore. La SF, comme les mythes grecs, nous parle de nous. Elle nous projette dans un futur onirique, allégorique, pour nous dresser un tableau (supportable ?) de la modernité. Elle donne à voir, rend visible le sombre tableau contemporain de notre misère, de nos sociétés les plus décadentes. Elle vomit un panorama dérangeant, de notre nature humaine, que l’on peut si difficilement chasser.
Car Tous à Zanzibar traite évidemment de la « nature humaine ». Vous savez, cette fameuse nature, que Hobbes voulait régler, que Rousseau saluait (« L’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt ».) Ah ! Quelle belle farce ! Les deux personnages principaux de ce roman culte, se retrouvent devant une humanité encore si déterminée par sa propre nature. Houellebecq nous parle du post-humain, avec un regard avisé. Pas de néo-humain, à peine des « non-humains ». Car vers quoi allons-nous, si ce n’est un inhumanisme moderne, lorsque nous oublions que manipuler la nature, toucher à la conscience humaine, et vouloir jouer à l’ange, nous conduira à jouer à la bête.
John Brunner nous décrit un monde où l’Union soviétique aurait été rayée de la carte géopolitique depuis longtemps, et où la Chine aura émergée avec des États-Unis toujours aussi déliquescents, et se cherchant un nouvel ennemi, afin de persévérer dans leur vision binaire du monde, et de projeter leur névrose sur une partie du monde (nous n'en sommes pas si loin n'est-ce pas ?)…

Extrait de « Matrix revolution » de Andy et Larry Wachowski, 2002
Je voudrais dire que tout le génie de la littérature de Science-fiction est là. Que notre monde aseptisé, endolori, déliquescent devrait aller se nourrir de cet art de haute qualité, au lieu de reproduire, bien souvent, avec une indigence molle, ce que la littérature française a produit autrefois, mais sans le génie d'hier, et sur un ton si monotone. De nos jours, en 2016, combien sommes-nous à raconter nos vies sur le réseau, ne serait-ce que par Facebook, Instagram, Twitter, des vies finalement indigentes ? Que pourrais-je donc dire, si ce n’est d’arrêter de céder au dictat du moment, en se repliant faiblement sur son nombril, et de se jeter dans le bain de l’époque contemporaine ; de se battre une bonne fois pour toutes, contre les vrais problèmes, au lieu, sans cesse, de s’en prendre à des moulins à vent, de mener de vains combats, bien risibles souvent, bien confortables, destinés à quelques aigris, qui n’ont plus rien à faire, intégralement livrés à l’ennui, et au divertissement de ce début de millénaire.

John Brunner (1934-1995)
(Article écrit en 2007, relu, augmenté et corrigé en novembre 2016)