Entretien avec Franca Maï, une littérature douloureuse

Cet entretien a été réalisé en 2006, pour La Presse Littéraire. Franca Maï est l'auteure énigmatique de plusieurs romans parus aux éditions du Cherche-midi. De Momo qui kills au dernier Crescendo Franca Maï aura privilégié le malaise qui se perche aux tripes, sans jamais oublier la lumière qui somnole en chacun d'entre nous.
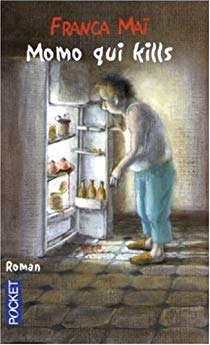 Comment êtes-vous entrée en littérature ?
Comment êtes-vous entrée en littérature ?
Fin de l’année 2000, j’ai opéré un virage radical dans ma vie de femme. Dans ce chemin à défricher et purement initiatique, un beau jour, j’ai écrit une lettre d’amour à un homme sous forme de « conte cruel et métaphorique ». C’était la nouvelle : « avec ma permission » diffusée depuis en free littérature sur la toile. Il ne l’a pas comprise. Etonnée et abasourdie par ce rejet violent, j’ai pris mon téléphone, j’ai composé le 222 et j’ai demandé au hasard, l’adresse de dix éditeurs. J’en ai choisi cinq. Leurs sonorités me plaisaient. J’ai envoyé la nouvelle par voie postale. Au bout de quinze jours, une jeune femme, emballée, m’appelait en me demandant si j’écrivais un roman. J’avais dans mon tiroir, une trentaine de pages de Momo qui kil qui dormait, pondue dans mon ancienne vie lorsque j’étais encore productrice de films alternatifs et poétiques et que je me cassais les dents, en toute innocence, avec la mère maquerelle « Télévision ». Cet appel téléphonique a été le talisman et comme elle se reconnaîtra, je la remercie ici. Une semaine plus tard, je recevais une lettre du Cherche-Midi qui me parlait de cette nouvelle particulière en me demandant également si j’écrivais un roman. J’ai donc plongé avec frénésie dans ce qui était pour moi, un encouragement et un signe du destin. Pendant que j’achevais Momo qui kills, en parallèle, j’imaginais d’autres nouvelles que j’envoyais aux deux éditeurs respectifs. Ca me reposait la tête et me faisait prendre un peu de distance avec le personnage principal Momo qui était parfois, très obsédant. Et puis… J’ai rencontré mes interlocuteurs en chair et en os et j’ai senti que mon nid était au Cherche-Midi, en la personne de Pierre Drachline, écrivain, critique et directeur littéraire. La qualité d’écoute et le respect du travail de l’écriture sont exceptionnels chez cet homme d’une autre époque. Son intégrité également. J’ai conscience de vivre un moment mythique et rare.
Vos romans sont de courts récits, vifs, et très durs. Pourquoi cette brutalité ?
L’écriture est avant tout un rituel jubilatoire. Quelquefois, c’est juste une première phrase ou un mot qui vous fait décoller. Je travaille sans plan. Juste une idée un peu abstraite ou un bout de situation et puis j’accompagne mes personnages au fur et à mesure qu’ils se présentent dans ma boîte crânienne. Une fois qu’ils sont là. Je suis eux. Je sais intuitivement comment ils respirent, comment ils s’habillent, comment ils vont réagir. Je peux entendre leur souffle. Ca relève de l’empathie. Ils me poursuivent même dans mes rêves. J’ai écrit quelquefois des chapitres entiers évadés directement de mes nuits agitées. L’écriture est une alchimie curieuse entre l’inconscient, le vécu fantasmé, les fêlures et la rêverie facétieuse.
Je crois que ma littérature trouve son haleine dans un rythme musical. D’ailleurs, j’accouche toujours des mots en osmose avec la musique poussée à son extrême. Les tympans remplis de Led Zeppelin, Patti Smith, P.J Harvey, Léo Ferré ou Wagner… tout dépend de l’humeur.
Vous dîtes de courts récits ? J’ai horreur du gras, des fioritures et des phrases creuses qui comblent un vide créatif.
Quant à la brutalité… Mes personnages sont sur le fil du rasoir. L’animalité leur sert de carapace mais ce sont des êtres profondément blessés et trahis. Ils portent une tendresse sous-cutanée, invisible à l’œil nu.
Vos romans s’écrivent sur un mode désenchanté, mais aucun de vos personnages ne le sont. Je veux dire, à côté des personnages d’un Houellebecq, cyniques, désespérés, les vôtres rêvent de grandeur. Pensez-vous qu’à l’aube de ce nouveau siècle cette utopie-là est encore possible ?
Si on ne préserve pas l’utopie, on peut se tirer une balle dans la tête. Rien ne sert de vivre une vie, gris peau de souris. Le monde a évolué grâce aux chimères et aux rêves de quelques illuminés. Une société stagne et sombre dans le pourrissement lorsqu’elle décapite le feu. Croire que l’inaccessible est possible le rend à terme, possible.
La chair chez Houellebecq est triste, inodore et industrialisée, celle de mes romans est carnassière, sensuelle et jubilatoire.
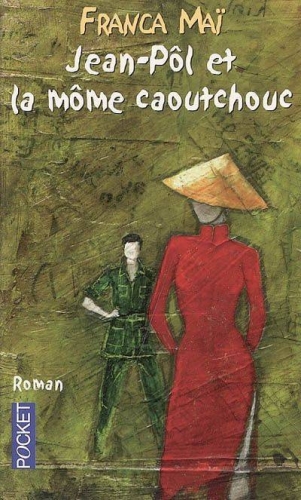 Dans tous vos romans, vous jouez avec les nerfs de votre lecteur. Je veux dire que vous exprimez cette part de violence et de cruauté extrême que vous abordez à vif, sans nuances. Pourquoi ce choix d’être au plus prêt de cette « barbarie » humaine qu’elle soit au sein de la société avec Momo le violeur, ou dans le processus déshumanisant de la guerre avec Jean-Pôl et ses comparses militaires ?
Dans tous vos romans, vous jouez avec les nerfs de votre lecteur. Je veux dire que vous exprimez cette part de violence et de cruauté extrême que vous abordez à vif, sans nuances. Pourquoi ce choix d’être au plus prêt de cette « barbarie » humaine qu’elle soit au sein de la société avec Momo le violeur, ou dans le processus déshumanisant de la guerre avec Jean-Pôl et ses comparses militaires ?
Je vous rassure, je joue avec les miens également.
Momo n’est pas né violeur. A la suite du départ de sa femme et de sa fille, il côtoie le lent processus de la dérive et développe par réaction, une haine implacable de la femme, dans toutes ses déclinaisons. Car même si son équilibre affectif était, somme toute précaire, il reposait tout de même sur la trinité : couple et enfant de l’amour. Seulement, lui ne le savait pas. C’est lorsque Mata, sa femme, le quitte entraînant dans son sillage leur fille, Buni, qu’il commence à avoir des crampes d’estomac maudites. Les crampes du manque infernal.
Souvent, à la suite de la publication de Momo qui kills, lors de salons littéraires, des lecteurs s’adressaient à moi en me disant : « nous étions persuadés que ce roman avait été écrit par un homme et que vous agissiez sous pseudonyme »
Comme s’il existait une écriture dite féminine et une réputée masculine.
A la fin, je répondais que j’étais un travesti. Ca réglait le problème.
Il est aussi troublant de constater que personne n’arrive à détester Momo qui commet pourtant des actes détestables. Certains hommes me confiaient qu’ils se reconnaissaient dans un chapitre ou au travers quelques traits de son caractère. Et ils m’étaient reconnaissants d’avoir détecté des sentiments inavouables.
Les femmes, par contre, ont une approche différente. Traiter du viol leur provoque une répulsion épidermique. Je précise que Momo qui kills ne fait absolument pas l’apologie du viol- comme j’ai pu le lire sous la plume d’une main aigrie et assassine. Soit elles rejettent d’emblée le roman sans en lire une seule ligne, soit elles dépassent leurs craintes et m’en parlent avec passion.
C’est la force de ce roman. Vous n’avez pas à faire à un monstre ou à un psychopathe mais à un homme blessé dans sa viande. Un homme sincère. Un homme qui dérape dans les eaux troubles du mal. Pour ne pas rater son autodestruction.
Pour Jean-pôl et la môme caoutchouc, je voulais traduire l’idée qu’à un moment donné, la victime prend toujours le dessus sur le bourreau. Même si ce n’est que pour quelques secondes. Et résister, c’est rester vivant même au-delà de la mort. Le bourreau ne supporte pas la résistance. Elle le fragilise. Je souhaitais aussi montrer qu’un groupe d’hommes lâchés en meute dans une guerre ou ailleurs est une mine explosive de dangers et de pleutreries. Alors que les mêmes individus pris séparément peuvent se révéler doux comme des agneaux.
L’influence du groupe se révèle fatale et démasque les bas instincts de l’humain. Et quand l’alcool est également de la partie !… La spirale glauque est difficilement contrôlable. Une soldatesque enivrée illustre l’apothéose du mal.
La schizophrénie tolérée et encouragée au nom de la guerre, de la défense d’un pays ou d’un match de foot, est une hypocrisie asphyxiante.
Et puis…
J’ai un quart de sang vietnamien. On dit que les bridées sont cruelles. Je ne déroge pas à la règle…
Houellebecq laisse entendre dans sa prose que les asiatiques sont les meilleures amantes du monde. Je ne déroge pas à la règle, non plus…
Donc, ce mélange de doux et de cruel me convient tout à fait. (sourires)
Votre nouveau roman s’intitule L’ultime tabou. Pourquoi un tel titre ? Pensez-vous que c’est un tabou « ultime » car notre société ne sait pas regarder en face ?
Parce que parler de la pédophilie est un sujet tabou qui rend les humains, autistes et fuyants.
Cette société non seulement regarde ce tabou en face mais le consomme cyniquement et activement via des voyages organisés dans des pays exotiques ou du tiers monde, en s’arrangeant avec sa conscience. Mais elle ne s’épanche jamais sur ses tares.
Votre titre me fait penser à cette réflexion du philosophe Bernard-Henri Lévy qui dit que peut-être le vrai courage est de penser ; penser par soi-même ; penser à contre-courant et surtout penser le mal en le regardant en face. Qu’en dîtes-vous ?
« Veux-tu avoir la vie facile ?
Reste toujours près du troupeau, et oublie-toi en lui »
Friedrich Nietzsche/ Ainsi parlait Zarathoustra
Je préfère regarder le mal en face plutôt qu’il ne me prenne en traître. Apprivoiser sa part d’ombre est déjà lui faire plier le genou à terre.
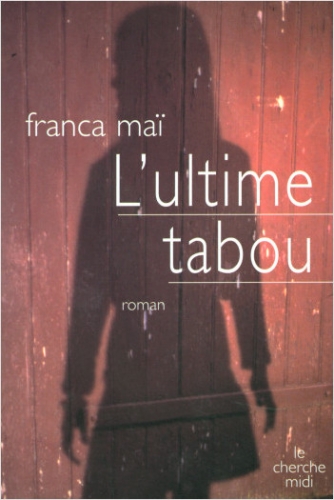 Votre dernier roman L’ultime tabou traite du « délicat » sujet de la pédophilie. Pourquoi le choix de ce thème ? Et surtout ne craignez-vous pas les réactions de rejets. Vous abordez un sujet qui va droit dans les noirceurs de l’âme. C’est la question du mal psychologique et métaphysique que vous mettez en problème ?
Votre dernier roman L’ultime tabou traite du « délicat » sujet de la pédophilie. Pourquoi le choix de ce thème ? Et surtout ne craignez-vous pas les réactions de rejets. Vous abordez un sujet qui va droit dans les noirceurs de l’âme. C’est la question du mal psychologique et métaphysique que vous mettez en problème ?
J’entretiens un lien bizarre avec l’ultime tabou. C’est un roman que j’ai écrit en trois mois en 2004. J’ai entamé l’écriture avec ce questionnement précis : comment peut-on survivre à la mort d’un enfant ?... C’était mon fil conducteur. Après, j’ai été dépassée par mes personnages. J’avançais réellement dans le noir, à tâtonner, à douter, à vomir avec eux. Je ne savais pas où ce voyage allait me mener, mais j’avançais. Je voulais trouver la brèche qui me mènerait vers la lumière. C’était vital.
Je n’ai rien relu et j’ai envoyé le manuscrit à mon éditeur.
Nous nous sommes rencontrés quelques jours plus tard autour d’un bon repas et j’avais dans ce laps de temps rédigé une autre fin.
Nous avons opté pour celle-ci.
Après, à chaque fois que je lisais le roman, j’étais en pleurs. C’était la première fois que cela m’arrivait. Je n’arrivais pas à contrôler mes larmes. J’avais les nerfs à fleur de peau. Incapable d’en parler avec des amis. Incapable de m’exprimer. Flirtant avec le silence. Déstabilisée. J’ai compris que cela réveillait certaines blessures que j’avais jusqu’ici occultées. Et je n’ai toujours pas trouvé la clef.
Donc, je peux dire que je n’ai pas choisi le thème de la pédophilie mais qu’il s’est imposé à mon esprit, tel un venin insidieux.
Le fait d’avoir également sculpté une fille et d’être maman me permet d’exorciser avec ce roman des angoisses intrinsèques inhérentes à l’avenir d’une femme en devenir qui, elle aussi, un jour mènera sa vie autonome dans une société très malade où les rencontres ne sont pas toujours celles que l’on souhaite.
Lorsque je remplis mes pages blanches, je ne pense jamais aux réactions de rejet ou d’amour. C’est vraiment à l’antipode de mes pensées.
Maintenant que ce roman est achevé, j’ai la trouille. Je ne sais toujours pas pourquoi je l’ai écrit. Il me dépasse. C’est à la fois vertigineux et déroutant.
Mais pour en revenir à la pédophilie, je marquerai tout de même une différence entre :
- les réseaux structurés qui fonctionnent comme des entreprises mercantiles et perverses en exploitant la misère humaine et en l’instrumentalisant
- les violeurs d’enfant
- les psychopathes
- et l’être humain amoureux attiré par des corps jeunes.
Cet être-là différent, qui fonctionne hors normes, que recherche-t-il dans cette quête de l’innocence ? Aime-t-il réellement ou veut-il simplement posséder une pureté à jamais perdue, en parfait égoïste ? Cherche-t-il au travers cette demande une réponse ou une résistance qu’il n’a pas su apporter lorsqu’il était lui-même enfant, victime d’attouchements ? Se venge-t-il ou partage-t-il un amour réel - incompris de la norme- en zone interdite ? Est-ce une dépendance comme la drogue ou l’alcool ?
Qu’un enfant soit troublé ou éveillé par une sexualité précoce me semble un cheminement d’ordre naturel. Qu’il exerce son pouvoir de séduction est normal. C’est à l’adulte d’indiquer la frontière à ne pas franchir même si l’enfant qui se trouve en face de lui est en recherche ou en curiosité sur sa sexualité. Là, réside le véritable amour. Outreau a été un carnage judiciaire. Des enfants ont menti pour protéger leurs géniteurs bourreaux. Qui peut en vouloir à ces enfants ? … Ils ont souffert dans leur chair et dans leur âme et ont tenté de transformer la réalité car leur quotidien était innommable. Les spécialistes de l’enfance avaient pour rôle de décrypter leurs appels désespérés. Ils ont failli à leur mission. Doit-on face à cette carence ne plus croire à la parole des enfants, nier leur malaise et leur difficulté à s’exprimer ?... Non… Il faut entendre et traduire avec la distance nécessaire.
Tous vos personnages souffrent. Ils souffrent en silence. Mais ce silence se tourne régulièrement en des actes cruels envers leurs congénères, d’où le qualificatif de « spectacle de la cruauté » que j’ai employé pour définir vos ouvrages. Pensez-vous que dans une société aussi individualiste que la nôtre à présent, celle que vous décrivez précisément, ce recours à la cruauté déshumanisante, est au final irréversible ? A voir vos personnages, il semble qu’ils soient pris dans une spirale infernale, sans espoir de retour ?
La folie meurtrière est la seule réponse « visible » à la barbarie d’une société. Elle percute l’apathie ambiante. Lorsque cette société - dite « démocratique » - donnera l’exemple au travers une éthique politique, elle avancera d’un grand pas. Ce qui n’est absolument pas le cas actuellement. Nos représentants s’arrangent avec leurs compromis, leurs projets avortés, en engrangeant les dividendes qui ne servent que leurs intérêts. Lorsque des banlieues explosent spontanément, on nous parle de manipulation et de « racaille » pour nous vendre du tout sécuritaire et pousser à la délation civique et poisseuse. Dans quel monde vivons-nous ? A quand les caméras de surveillance dans les vagins des femmes pour mieux mâter leur future progéniture ? On ne parle jamais du manque d’amour. A force de répéter que tu n’es rien, tu deviens rien. L’individualisme poussé à l’extrême n’autorise plus l’échange convivial et désintéressé. Il engendre des êtres froids, calculateurs perclus d’esprits compétitifs, robotisés. Leur sésame étant le « Dieu-Argent » . Les humains se noient dans la course glacée d’une solitude forcée. Où s’enterre la chaleur humaine ?...

Vendredi 13, (série de films de 1980 à 2009)
Contrairement à vos précédents romans, celui-ci se concentre autour de dialogues entre deux voix, alternés de quelques descriptions brèves et rapides. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Dénouer le nœud. Je voulais que Madame Alvy, victime blessée dans sa chair par le meurtre abject de sa fille, et Monsieur Bernard, bourreau d’autres chairs, se rencontrent et se parlent. Casser le mur du silence et du non-dit. J’étais curieuse d’imaginer et de découvrir l’évolution et l’échange de ces deux naufragés. Je voulais qu’ils réchauffent leurs os au soleil.
Tout artiste, si j’ose dire, écrit sous influences. Quelles sont les vôtres ?
Lorsque j’avais dix ans, j’ai dévoré Germinal de Zola et Histoire d’O de Pauline Réage. Ces deux romans ont certainement influé sur mon tempérament en déposant leurs graines indomptées. A treize ans, j’ai découvert l’écriture ulcérée et marginale de Violette Leduc. Plus tard, mes rencontres avec Hubert Selby junior, Gabrielle Wittkop, Ingeborg Bachmann, Jean Genet, Camus et bien d’autres errants … m’ont procuré un réel plaisir intellectuel. J’avais la sensation d’avoir des amis qui me comprenaient et avec lesquels je pouvais évoluer en toute confiance. Nous parlions la même langue. Je n’étais plus seule. J’avais ma tribu et je m’y sentais à l’aise.
Vous publiez votre quatrième roman chez le Cherche-Midi. Puis-je vous demander ce que vous pensez de l’état de la littérature aujourd’hui, et votre avis sur la nouvelle configuration éditoriale de ce début du siècle ?
Lorsque j’ai signé mon premier contrat avec le Cherche-midi, c’était encore une maison d’édition indépendante. Depuis, elle est passée entre les mains du baron Seillières et de ses actionnaires. Donc, l’avenir immédiat est un jeu de roulette russe, orchestré par des personnes aux rétines rivées sur des résultats et des chiffres. Lisent-ils seulement les mots ? …
Or, il faut bien comprendre qu’il faut du temps à la littérature pour atteindre les esprits sans cesse sollicités par des leurres, des mirages ou des impostures.
Le cas de Breton qui n’a touché des droits qu’un an avant son départ avec la Grande faucheuse illustre le quotidien des écrivains.
Etant donné que la tendance est aux gros groupes industriels - qui font main basse sur toutes les maisons d’éditons à l’aura libre - la littérature se retrouve sous le joug désormais de marchands de canon ou de scories du Medef, je crains qu’elle ne se métamorphose en leurs sortilèges plongeant les derniers mohicans dans un coma éternel.
J’espère me tromper. Naviguer dans l’erreur d’interprétation.
Puisque nous parlons de l’écrit, essayons de prolonger le débat vers la question des supports de l’écrit. Vous êtes la rédactrice en chef avec Di2 du webzine E-torpedo.net. Une Revue électronique, très novatrice, dont les lignes éditoriales voire idéologiques sont très marquées, et qui semble trouver un public. Comment voyez-vous ce nouvel outil multimédia dans le paysage culturel ?
C’est un super bébé vorace qui nous apporte beaucoup de bonheur. Le E-torpedo, webzine sans barbelés, envahit énormément notre temps, mais comme il est destiné à la communauté des internautes, nous nous faisons un plaisir de le nourrir avec une acuité redoutable et une intuition cohérente.
Il a été également le terrain de rencontres importantes puisque des collaborateurs spontanés sont devenus non seulement des amis virtuels mais ont offert leur sensibilité, leur regard, leur différence, leur temps de liberté, leur analyse sur un monde en déroute.
Toute cette énergie altruiste a porté ses fruits puisque la beauté du « NON » à la constitution a été époustouflante. Ce n’est pas la presse officielle rampante qui a insufflé ce sursaut démocratique mais bel et bien, les réseaux alternatifs du Net en réalisant un travail de fourmi, basé sur le bénévolat, l’échange, le partage, le dialogue et l’écoute.
Pensez-vous Internet comme une révolution possible de l’écrit et des filtres ? Je veux dire, pensez-vous que l’Internet pourrait voir dans un avenir proche ou à moyen terme, de nouvelles plumes apparaîtrent sans en être passé par le filtre de l’institution éditoriale ?
Tout est envisageable et possible. C’est au lecteur de comprendre qu’Internet peut lui offrir un choix illimité, en toute autonomie. Mais désire-t-il cette alternative ou préfère-t-il se gaver au formatage du tout publicitaire, englué dans une paresse passive ?
Il faut - pour que cette échappée soit viable - une génération de lecteurs actifs, animés d’une curiosité dévorante. La littérature est un voyage singulier. Il y a ceux qui optent pour les voyages organisés et les autres. Mais après tout, les voyages effectués sont ceux que l’on mérite. Seul, le lecteur détient le pouvoir de donner le signal à cette révolution culturelle en changeant ses réflexes et en explorant allègrement.
Pour l’instant le Net, est synonyme de joyeux bordel. Des écrits fleurissent sur des blogs ou des revues en ligne. Il y a des instants de grâce mais aussi de véritables inepties. Qu’importe ! L’important est, que des gens s’expriment et échangent.
La possibilité de pouvoir découvrir des auteurs en ligne par le biais de nouvelles en copyleft, permet également de mesurer son attrait pour une forme de littérature testée en ligne et qui sait ?... être épinglé par une révélation.
Pour clore, une dernière question : Quel est, selon vous, le défi que devra relever la littérature du 21ème siècle ?
Apprendre à lire.

Brigitte Lahaie & Franca Mai (1959-2012)
En couverture : Franca Mai et Boris Schreiber, après l'émission Nocturne, de France-Inter.