Philosophia perennis : Platon, Spinoza, Descartes, Malebranche, Foucault

Pour mes lecteurs qui désireraient s'initier à quelques premiers éléments de philosophie, je remets ici en ligne, à toute fin utile, cinq chroniques parues dans des magazines aujourd'hui disparus. Ce sont bien sûr, quelques précisions élémentaires, à propos de doctrines fondamentales dans l'histoire des idées. Je vous renvoie, dans le corps du billet, par liens hypertextuels, à des articles, cette fois-ci, plus élaborés, si, à tout hasard, vous souhaitiez prolonger la lecture de ces quelques pistes, demeurant volontairement superficielles.
 Comment se porte la République de Platon ? Dans une époque qui, à tort ou à raison, porte un grand mépris pour la chose publique (Res publica en grec), quoi de plus salvateur qu’un retour à l’un des pères de la philosophie : Platon ?
Comment se porte la République de Platon ? Dans une époque qui, à tort ou à raison, porte un grand mépris pour la chose publique (Res publica en grec), quoi de plus salvateur qu’un retour à l’un des pères de la philosophie : Platon ?
Reprenant, selon le mythe, l’enseignement à la lettre de son maître Socrate, Platon, dont la vocation politique a été durant toute sa vie contrariée, établit un programme politique pour une cité juste, dans son texte La République. Qui n’a d’ailleurs jamais entendu parler du mythe de l’anneau de Gygès, ou de la célèbre allégorie de la caverne ?
L’articulation antique de la morale et du politique, au centre même de ces deux livres de La République, le livre 6 & 7, que la collection Folio+ a l’excellente idée de reprendre et d’agrémenter de commentaire à la fois éclairants et rigoureux, est d’autant plus intéressant à lire de nos jours, que la disjonction entre la morale et le politique est, très probablement, à l’origine de la grande désaffection de l’électorat qui ne saisit toujours pas d’un très bon œil, le visage moderne de la politique depuis Machiavel.
Qu’est-ce qu’une cité juste ? Comment établir et conserver la proportion, la mesure et l’harmonie dans la cité qui est l’ordre même du monde ? La seule réponse pour Platon réside dans l’articulation étroite entre morale et politique. Car, dans sa définition athénienne, la politique n’est autre que la recherche de bonne fin. Et quelle fin véritable, selon Platon, pour la Cité, que la vertu ?
D’où les livres 6 & 7 : l’un traitant à la fois du juste et de l’éducation des dirigeants de la Cité qui, ne pouvant être des hommes aux ambitions personnelles, ou aux intérêts éloignés de ceux du bien public, doivent être éduqués en philosophes. (A lire la très éclairantes analyses de Fulcran Teisserenc sur l’articulation entre justice, philosophie, éducation et dialectique.)
Le très célèbre livre 7 vient alors à point nommé pour faire le tri entre réalité et vérité : erreurs, opinions, illusions et vrai. Que vise à nous faire comprendre Socrate grâce à sa fameuse allégorie de la caverne si ce à cerner que le niveau de connaissance de l’homme suivant qu’il a été ou non éduqué, l’éloignera ou le rapprochera bien entendu du juste. Le juste comme vérité et comme justice. On pourra, dans une traduction mise à jour, suivre le périple d’un prisonnier de la caverne, enchaîné comme ses amis depuis des années, et plongé dans l’ignorance que symbolise la vie dans la caverne, franchir toutes les étapes du savoir en sortant de la caverne et découvrant les choses réelles.
Cette distinction entre l’apparence, ce qui se voit et semble être, et l’essence, ce qui est, est une première démonstration des erreurs et illusions que l’ignorance recèle. La montée vers la lumière du soleil, et la redescente dans la caverne, est un enseignement fondamental pour la pensée et la liberté de penser.
Comment assurer notre bien et notre liberté si, durant notre si longue histoire, nous persistons à vouloir nous accrocher à nos illusions, nos opinions non vérifiées par un esprit critique neutre et libre, et nos dogmes ?
 Faut-il douter de tout comme Descartes ? L’une des phrases les plus célèbres en philosophie est bien celle de Descartes : « Je pense donc je suis ». Extraite de son fameux ouvrage le Discours de la méthode, elle demeure l’une des références fondamentales pour la pensée moderne. Reprise dans ses Méditations métaphysiques, toutes les grandes notions cartésiennes viennent, dans ce texte, soutenir et propulser le cheminement cartésien dans son ambitieuse entreprise d’agrandir son champ du savoir de le soustraire au moindre doute.
Faut-il douter de tout comme Descartes ? L’une des phrases les plus célèbres en philosophie est bien celle de Descartes : « Je pense donc je suis ». Extraite de son fameux ouvrage le Discours de la méthode, elle demeure l’une des références fondamentales pour la pensée moderne. Reprise dans ses Méditations métaphysiques, toutes les grandes notions cartésiennes viennent, dans ce texte, soutenir et propulser le cheminement cartésien dans son ambitieuse entreprise d’agrandir son champ du savoir de le soustraire au moindre doute.
La collection Folio+ reprend les trois premières méditations de René Descartes, portant sur le cogito, le dualisme entre l’âme et le corps, et la preuve ontologique de l’existence de Dieu.

La postérité de Descartes est absolument impressionnante. Ayant entrepris d’interroger les conditions de possibilité du savoir et de revisiter tous les savoirs afin d’en tirer des connaissances vraies et indubitables, Descartes est parvenu à introduire en philosophie la première certitude qui se délivre du doute : Cogito ergo sum« je pense donc je suis. » Qu'est-ce à dire ? Dès lors que je pense, et au moment même ou je pense, j’ai en même temps la nécessaire conscience d’exister. Ainsi, l’entreprise philosophique de Descartes consiste essentiellement à se défaire de toutes les croyances reçues, des erreurs ou des savoirs erronés, et permet à la conscience d’acquérir un véritable droit de citer.
Cette entreprise, philosophique par excellence, a certes connu un échec retentissant en enfermant le sujet pensant dans un solipsisme cruel et certain. Il n’en demeure pas moins pour la pensée de Descartes, qu’elle est à l’origine de nombreuses lectures et relectures et d’interprétations diverses.
Il serait même plutôt utile de relire aujourd’hui, la première méditation qui pose le « je pense, j’existe » cartésien, c’est-à-dire l’unique certitude qui résiste au doute, comme l’une des premières certitudes en philosophie, si ce n’est, chez Descartes, la seule, comme preuve indubitable qu’au moment ou je pense je ne saurais en même temps ne pas penser que je suis.
Certes. Si le fait que je n’existe pas n’implique aucune contradiction, la conscience que j’ai d’exister est elle par contre nécessaire. De fait, la conscience se pose comme la condition de possibilité de la remise en question du savoir. Dans cette splendide et première méditation, on découvre alors un Descartes amener la pensée au stade de la conscience même. Pour ce rationaliste français, la pensée est la conscience. Si mon existence en elle-même n’est nullement nécessaire, ne pas exister n’impliquerait en effet aucune contradiction, le fait même que j’existe est parfaitement contingent. Or, la pensée même « je n’existe pas » est parfaitement impensable. Tenter de vous imaginer ne pas être, et aussitôt vous penserez le concept plus que le fait lui-même. Pourtant, si le fait que j’existe est à présent indéniable, hors de doute, ce fait là ne me dit pourtant pas qui je suis. Et si par le cogito, je sais que je suis, cette certitude porte bien sur mon existence mais pas sur mon essence. Je sais que je suis, pas ce que je suis.
Cette base ainsi posée, tout lecteur quelque peu perspicace aura enfin compris la logique des deux autres méditations suivantes. A partir de cette vérité, Descartes pensera les vérités extérieures à soi : Dieu, le monde, le corps, autrui, etc.
Aussi, pour les amoureux de la vérité, dans un monde englouti qui ne cesse de l’insulter, pour les amoureux de l’intelligence, je ne saurais que trop recommander ces trois premières méditations qui donnent et re-donnent un vrai désir de philosopher dans une époque qui ne doute plus de rien.
Le Mal selon Spinoza. Qu’est-ce que le mal ? Dans quelle perspective pouvons-nous entrevoir le mal à partir de Dieu et de la liberté humaine ? Voilà les grandes questions développées dans la très célèbre correspondance qu’eut Spinoza avec Blyenbergh, et qui fut publiée sous le titre Lettres sur le mal.

 Le 26 décembre 1664, Spinoza, auteur du TTP (Traité théologico-politique), reçoit une lettre d’un inconnu. Homme qui se dit « amoureux de la vérité », donc philo-sophe, Guillaume de Blyenbergh, connaissant aussi bien l’œuvre de Descartes que celle de Spinoza, pose cette question qui intéresse directement les travaux de Spinoza : Dieu est-il cause de tout ?
Le 26 décembre 1664, Spinoza, auteur du TTP (Traité théologico-politique), reçoit une lettre d’un inconnu. Homme qui se dit « amoureux de la vérité », donc philo-sophe, Guillaume de Blyenbergh, connaissant aussi bien l’œuvre de Descartes que celle de Spinoza, pose cette question qui intéresse directement les travaux de Spinoza : Dieu est-il cause de tout ?
Cette question philosophique et théologique n’est certes pas nouvelle. Pourtant, essentielle, elle doit être systématiquement posée et reposée pour questionner et problématiser le champ de a liberté humaine. Derrière cette dernière se cache bien entendu la grande question métaphysique de la liberté de l’homme. La volonté humaine est-elle libre ou déterminée ?
Lecteurs de génialissime Ethique de Spinoza, il est impossible que vous ayez manqué que la liberté humaine n’est qu’une illusion !
Soyons clair : Dieu chez Spinoza EST la nature. C’est-à-dire qu’il n’est autre que le monde même. Et les hommes, en tant que modes de la substance (« Dieu » en langage spinoziste), sont eux, soumis à l’enchaînement naturel des causes. Ils ne font donc pas exception aux lois universelles de la nature. De fait, n’ayant pas conscience des causes qui les déterminent physiquement et psychologiquement, ils se préoccupent plus aisément de satisfaire leurs désirs, grassement ignorants de ce qui les déterminent vraiment. Ils ont bien conscience des fins de leurs actions mais non des causes. D’où l’illusion de liberté. Victimes du préjugé finaliste, ils renoncent à connaître la véritable cause de leurs désirs, et croient à leur liberté comme une évidence incontestable. Cette illusion les conforte dans l’idée qu’ils sont les maîtres. Premier problème : l’homme ne saurait être au sein de la nature comme « un empire dans un empire ».
Héritier de la tradition philosophique cartésienne, le Spinoza qui parle dans ces lettres, est un « homme libre » ayant subi un attentat perpétré par un intégriste juif, ayant été excommunié de la synagogue pour athéisme, et ayant refusé une chaire de philosophie à Heidelberg, où enseignera Hegel quelques siècles plus tard ; également grand cartésien, Spinoza s’inscrit dans la veine matérialiste de Descartes tout en amenant une sensible évolution à son propre matérialisme : l’homme est un corps dans le continuum de la nature. Et ainsi, en tant que partie formant le tout de la Nature, est-il seulement libre donc responsable du mal qu’il commet ?
Cette seule question donne tout l’intérêt de re-lire à lecture d’un siècle qui succède au siècle de la banalité du mal, de la mort de masse, de l’homme-dieu, ces huit lettres. Huit lettres qui essayent d’en découvre avec la question du mal, son origine et sa légitimité ; la nature de la volonté de Dieu ; si l’homme peut-il exercer son libre-arbitre ?
Il est émouvant par exemple de lire un Blyenbergh qui tentent par tous les moyens de démontrer à un Spinoza qui lui soutint que le mal n’est rien, que cette proposition est parfaitement impossible. Le mal : pêché ? licence ? puissance naturelle qui s’exerce ? Les questions demeureront toutefois ouvertes, d’autant plus que les dernières lettres verront un Spinoza apporter une fin de non recevoir à un Blyenbergh avec lequel il ne s’entend définitivement plus.
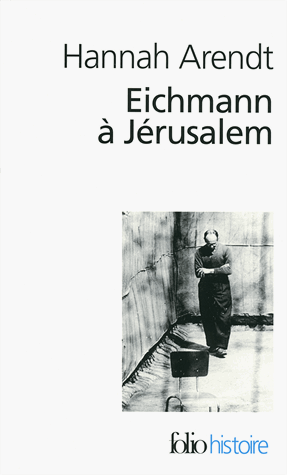 On pourrait même s'en tenir à cette terrible question : Puisse le mal être involontairement commis ? Car comme le montrera si brillamment Hannah Arendt dans son Eichmann à Jérusalem, dont le judicieux dossier de Folio+ reprend un extrait, la notion de mal ne suppose pas forcément une volonté de mal. Cette hypothèse métaphysique, largement débattue dans les lettres sur le mal, remet alors sur le devant de la scène philosophique, le grand problème du bien et du mal, dont Nietzsche saura, - avec quel génie ! -, dépasser…
On pourrait même s'en tenir à cette terrible question : Puisse le mal être involontairement commis ? Car comme le montrera si brillamment Hannah Arendt dans son Eichmann à Jérusalem, dont le judicieux dossier de Folio+ reprend un extrait, la notion de mal ne suppose pas forcément une volonté de mal. Cette hypothèse métaphysique, largement débattue dans les lettres sur le mal, remet alors sur le devant de la scène philosophique, le grand problème du bien et du mal, dont Nietzsche saura, - avec quel génie ! -, dépasser…
Malebranche et la vérité. Qu’est-ce que la vérité ? Ou plutôt, nous devrions dire : comment parvenir à une vérité universelle et indubitable ?
Dans la veine de l’école cartésienne, dont Malebranche, en petit cartésien, est l’un des représentants de la pensée, La Recherche de la vérité tente d’expérimenter une méthode philosophique qui permettrait à tous de découvrir une vérité entière, valant pour chacun, et donc indubitable. Une démarche qui pourrait nous paraître aujourd’hui des plus naïves et des plus vaines, depuis le XXème siècle et l’avènement d’une pensée scientifique qui, avec Poincarré, Einstein et Infield entre autres, nous a enseigné que le vrai n’était pas accessible, seul le vraisemblable était à la portée de la connaissance scientifique… Certes, on pourra également objecter à Malebranche d’être véritablement imbuvable dans ses démonstrations souvent rigoureuses et précises…
Mais quel plaisir de le suivre sur le chemin d’une démonstration qui vient à point dynamiter les théories fumeuses des gardiens du petit cortex, soutenant que l’opinion aurait droit de citer dans une discussion qui prétendrait faire la lumière sur le vrai et le faux, alors que toute opinion, nous le savons très bien, n’est que la somme de connaissances personnelles, bien souvent non vérifiées, et relatives à chacun.
Soyons clair : le titre même de cet ouvrage pourrait donner des maux de crâne aux moins paresseux d’entre vous… parmi vous, le projet même de rechercher ainsi la vérité pourrait vous sembler des plus laborieux. Certes ! Quand Malebranche se met en tête, dans les deux parties de son ouvrage majeur La Recherche de la vérité, de déconstruire l’imagination, - tout comme tenta de le faire en son temps Sartre – il y a fort à faire entre la définition duelle de l’imagination, le cerveau – tel qu’on le concevait à l’époque de Descartes -, la contagion et les erreurs. Mais avouons-le : que fait Malebranche si ce n’est de poursuivre le but même de la philosophie et de la science : c'est-à-dire en découdre une bonne fois pour toutes avec la définition de la vérité ? Considérons simplement notre expérience quotidienne et l’histoire de la pensée ! Facile alors de constater que l’esprit humain est engagé dans des contradictions, dans des erreurs, dans des préjugés. La connaissance de la vérité reposant alors sur la mise en doute de toutes les opinions reçues telles quelles, sans vérification, et sur les définition des caractéristiques des idées vraies. Et celle-ci ne saurait ne pas passer par la délicate expérience de l’imagination.
Allez ! tâchons de nous rappeler l’enseignement de Descartes : il faut ériger la raison en tribunal. Le bon sens, c’est-à-dire cette formidable faculté de distinguer le vrai d’avec le faux, et qui nous différencie de l’animal, doit disposer de tous les pouvoirs de « juger » tout objet qui se présente. Coextensive à la pensée, il est vrai que la raison est en nous une lumière naturelle, et comme la lumière du soleil éclaire la variété des choses du monde sans perdre son identité, en demeurant la même lumière, la pensée « jugeante » garde son unité sans jamais se briser ni se perdre, quels que soient les objets auxquels elle s’applique : quoi que je juge, c’est toujours moi qui juge ! La science même doit être définie à partir de ce foyer, comme une certaine façon de penser, ou de juger, et non à partir de la diversité de ses objets. Rejeter les opinions reçues, et jugées bonnes parce qu’elles étaient reçues, c’est retrouver ce pouvoir souverain de juger qui jusque-là passait inaperçu. Eriger la raison en tribunal constituera, quoi qu’en en dira, dans le contexte actuel qui tentent, bien désespérément, de disqualifier la philosophie au nom d’un scientisme des plus abjects, non pas une nouveauté, mais une révolution au sens strict, c-à-d un retour. Pour atteindre ce salvateur objectif, il nous faut bien conduire notre esprit par une méthode : « Ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien », écrivait en son temps Descartes dans son Discours de la méthode.

C’est à cette révolution cartésienne fondamentale pour la pensée moderne, c’est à cet héritage problématique, et à la démarche même de La Recherche de la vérité que s’attaque le petit dossier proposé par Frédéric de Bouzon, dans cette nouvelle collection philosophique Folio+ qui, n’ayons pas peur des mots, est une véritable merveille pédagogique et propédeutique. Qui était Malebranche, et quelle est donc la richesse exacte de son œuvre ? A quoi sert l’imagination ? Quel concept de la vérité ? Peut-on purifier l’esprit ? Autant de questions, autant de points abordés qui viennent s’ajouter à la merveilleuse et délicate lecture de ce chef-d’œuvre qu’on ne se lasse jamais de re-découvrir !
 Le pouvoir selon Foucault. Certains mauvais lecteurs de Foucault l’ont traité de suppôt de Hitler, d’autres ont cru l’enterrer il y a déjà vingt ans ; certains ont tenu contre vents et marées que ses écrits n’avaient pas l’once d’un relent philosophique… Constat : Vingt ans après sa mort, Michel Foucault demeure l’une des figures intellectuelles les plus éclairantes de notre époque.
Le pouvoir selon Foucault. Certains mauvais lecteurs de Foucault l’ont traité de suppôt de Hitler, d’autres ont cru l’enterrer il y a déjà vingt ans ; certains ont tenu contre vents et marées que ses écrits n’avaient pas l’once d’un relent philosophique… Constat : Vingt ans après sa mort, Michel Foucault demeure l’une des figures intellectuelles les plus éclairantes de notre époque.
La volonté de savoir, sous-titré : « Droit et pouvoir sur la vie » est un très court texte sur le « pouvoir ». Or, si l’on recherche chez Foucault une définition de la notion, on en trouvera une, finalement assez simple, mais risquant néanmoins de bousculer toutes nos idées préconçues. Qui sait ? Le pouvoir est un rapport de forces. Notez ici que le terme de « force » n’est pas écrit au singulier. Pour Foucault le rapport de force se conjugue toujours au pluriel. Car précisément, tout rapport de forces est nécessairement un « rapport de pouvoir ». On pourrait même dire avec Foucault qu’une force est toujours en rapport avec une autre, ce qui la conduit à n’avoir aucun autre objet ni aucun autre sujet que la force elle-même. Toute force est alors déjà un rapport, et ainsi un « pouvoir ».
D’où la double question posée judicieusement par Frédéric Rambeau qui offre un beau petit dossier au texte de Foucault : 1. Qu’est-ce qu’un pouvoir s’exerçant sur la vie ? 2. Sommes-nous libres de nos désirs ?
Comme dans Surveiller et punir, La volonté de savoir propose une relecture du « pouvoir » qui laisse à penser, voire présente une interprétation assez étonnante, et peu banale. Tout d’abord, Michel Foucault étudie le pouvoir au niveau de ses processus mineurs qui cernent et investissent le corps. Or, contre toute attente, il ne s’agit donc plus, comme on le ferait un peu trop précipitamment, d’étudier la question du pouvoir sous l’angle de grandes interrogations autour de la genèse de l’Etat ou les droits de la nature. A la lecture de Foucault, on réalise que tout le travail du pouvoir pour discipliner ses sujets s’opère autour d’une très fine technique politique des corps : il s’agit de rendre docile, de discipliner les individus sans que ces derniers naturellement, ne s’en aperçoivent.
Dans cette « microphysique » du pouvoir, Foucault remarque alors l’effort du pouvoir pour quadriller les corps, et les répartir dans l’espace. Il s’agit d’éviter quoi qu’il en coûte, le moindre désordre au sein de la société. Alors chacun doit être à sa place selon son rang, sa fonction, ses forces, etc. Que ce soit à l’usine, à l’école, à la caserne, le pouvoir doit contrôler l’activité, en atteignant l’intériorité même du comportement, jouant au niveau du geste dans sa matérialité la plus intime ; il doit également combiner les corps afin d’en extraire une utilité maximale. C’est ce qu’on pourra appeler la combinaison des forces. Cela entraîne Foucault à étudier les diverses techniques très méticuleuses de pédagogie initiées par le pouvoir, et ses règles très méticuleuses de dressage des individus dans les diverses strates du corps social.
Normaliser la conduite du corps ! Dans les ateliers, les écoles, les casernes, partout, les techniques disciplinaires qui vont assurer cette normalisation mettent à l’œuvre ce qu’on peut appeler une micropénalité. Châtier le corps rebelle, le corps indocile. Le dissuader de recommencer. Micropénalité qu’on ne doit pas confondre avec les grands mécanismes judiciaires étatiques, comme s’il n’existait qu’un seul pouvoir, le pouvoir d’Etat, et le pouvoir politique coexistent donc à côté d’un grand pouvoir, et existent omniprésents dans notre société comme tout un tas de micro-pouvoirs, ce qui permet alors à Michel Foucault de distinguer et d’opposer loi et norme. La loi étant ce qui s’applique aux individus de l’extérieur, essentiellement à l’occasion d’une infraction, la norme est ce qui s’applique aux individus l’intérieur, puisqu’il s’agit pour elle d’atteindre leur intériorité même en imposant à leur conduite une courbe déterminée.

Bref. Entre « droit de tuer », « bio-pouvoir », « politique du sexe », la normalisation des comportements par l’Etat apparaît alors comme une tyrannie terrible du groupe sur lui-même orchestrée par un monstre froid aux multiples pouvoirs, affirmant continuellement sa domination sur ses sujets.
Michel Foucault reste, à ce jour, terriblement subtil et novateur quand il écrit sur la libération sexuelle, les processus de contrôle des corps, et l’ordre sexuel qui tente de fragiliser notre visée « émancipatrice ».
Contre la « bien-pensance », ou l’art de ne plus penser, comment ne pas inciter à la lecture de ce petit ouvrage et bien sûr, dans la suite logique, à l’œuvre entière de Michel Foucault ?
Une mine d’idées et de pistes contre l’obscurantisme postmoderne que l’on subi aujourd’hui dans le marasme d’une pensée qui a, semble-t-il, cessé de penser…
(Texte établi à partir des éditions parues dans la collection Folioplus.)