De l'irréversibilité du temps (Jankélévitch)

Si, pour Augustin, la difficulté ne tient pas seulement à ce que l’éternité nous échappe, que le temps même qui nous emporte demeure un indicible mystère, et que toute sa substance tient dans l’instant indivisible qu’est le présent, le vrai problème du temps est évidemment qu'il n’est plus ou qui n’est pas encore, ou bien qu'il tient dans un présent instantané. Vladimir Jankélévitch soulève pourtant un problème supplémentaire, et qui tient de ce que chacun éprouve du temps, et qui n’est autre que son irréversibilité. Je continue ici, dans l'Ouvroir, grâce aux travaux d'Augustin, mon travail entamé récemment sur le temps.
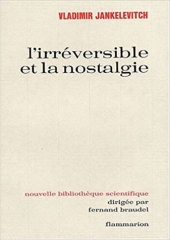 Un voyageur tel Ulysse, peut toujours revenir sur ses pas par exemple, il n’en reste pas moins que, sur l'axe du temps, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est perdu l'est à tout jamais. Cela montre que, ce qui a eu lieu est irrévocable. « Le temps est irréversible de la même manière que l'homme est libre : essentiellement et totalement », écrit Jankélévitch. Il y a déjà bien des choses dont on inverserait l’ordre en usage de la force et de la violence mais, en ce qui concerne le temps, cela est tout simplement impossible. De ceci découle la dimension profondément morale du temps. Une fois qu’un acte est réalisé, le voilà qui tombe irrémédiablement dans le passé (du plus immédiat au plus lointain), et ne peut désormais plus être corrigé. D’où le fait de le savoir, ou le sentiment moral impératif (selon que l’on définisse la moralité comme une science ou un sentiment), afin de ne pas commettre l’irréparable. Et sans la volonté, qui est ici décisive, rien n’est possible. On peut alors évoquer le tragique du temps dans la mesure où chacun d’entre nous a un passé, et des faits, sur lequel il ne peut plus rien, même s’il nous est loisible de modifier notre relation à notre propre passé. Ainsi, le passé menace de faire naître le regret ou le remords.
Un voyageur tel Ulysse, peut toujours revenir sur ses pas par exemple, il n’en reste pas moins que, sur l'axe du temps, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est perdu l'est à tout jamais. Cela montre que, ce qui a eu lieu est irrévocable. « Le temps est irréversible de la même manière que l'homme est libre : essentiellement et totalement », écrit Jankélévitch. Il y a déjà bien des choses dont on inverserait l’ordre en usage de la force et de la violence mais, en ce qui concerne le temps, cela est tout simplement impossible. De ceci découle la dimension profondément morale du temps. Une fois qu’un acte est réalisé, le voilà qui tombe irrémédiablement dans le passé (du plus immédiat au plus lointain), et ne peut désormais plus être corrigé. D’où le fait de le savoir, ou le sentiment moral impératif (selon que l’on définisse la moralité comme une science ou un sentiment), afin de ne pas commettre l’irréparable. Et sans la volonté, qui est ici décisive, rien n’est possible. On peut alors évoquer le tragique du temps dans la mesure où chacun d’entre nous a un passé, et des faits, sur lequel il ne peut plus rien, même s’il nous est loisible de modifier notre relation à notre propre passé. Ainsi, le passé menace de faire naître le regret ou le remords.
Avec Jankélévitch, on constate que l’irréversibilité est l’essence du temps. Et si aucun retour n’est concevable, chaque fois est alors en même temps la première et la dernière, ce que le philosophe français appelle la « primultimité ». La nostalgie devient moins le mal du retour, puisqu’on peut toujours revenir au point de départ que, l’impossibilité de redevenir de celui qu’on était au moment du départ. Fort heureusement, Jankélévitch demeure bergsonien et, si l’irréversible n’admet qu’un remède, ce n’est pas la nostalgie, mais plutôt le consentement joyeux de l’homme à la liberté créatrice à laquelle le temps nous ouvre dans le futur.
Néanmoins, maintenant que nous avons dit tout cela, nous n’avons pourtant pas épuisé le problème de l’irréversibilité du temps, puisqu’on peut encore croire devant celle-ci que l’on est conduit à s’interdire toute action et toute passivité. Ce n’est d’ailleurs pas seulement par « inconscience » des conséquences de leurs actes que les hommes agissent bien sûr, mais aussi parce qu’ils ignorent qu’en toute action, il faut rechercher l’action droite, l’action morale ou, plus modestement, l’action appropriée à une situation.
Venons-en alors au second et dernier point : si le passé échappe au contrôle de l’homme, il en va de même pour une autre dimension du futur, cette dimension qui se situe après la mort. Or, si la mort nous préoccupe plus que ce qu’il y avait pour nous avant la naissance, c’est parce que la mort symbolise une fin, une extinction. De la peur de la mort naît le désir d’immortalité. On notera que la plupart des théories de l’âme pensent l’âme comme éternelle. Que veut alors dire « être éternel » ? On pourra répondre peut-être pour conclure que, l’on est éternel dès lors que l’on n’est plus soumis au temps et à ses vicissitudes, à la vieillesse du corps ou encore à ce qu’Aristote appelait la corruption des êtres organiques.
Le retour en arrière impossible
Le voyageur revient à son point de départ, mais il a vieilli entre-temps ! [...] S'il était agi d'un simple voyage dans l'espace, Ulysse n'aurait pas été déçu ; l'irrémédiable, ce n'est pas que l'exilé ait quitté la terre natale : l'irrémédiable, c'est que l'exilé ait quitté cette terre natale il y a vingt ans. L'exilé voudrait retrouver non seulement le lieu natal, mais le jeune homme qu'il était lui-même autrefois quand il l'habitait. [...] Ulysse est maintenant un autre Ulysse, qui retrouve une autre Pénélope... Et Ithaque aussi est une autre île, à la même place, mais non pas à la même date ; c'est une patrie d'un autre temps. L'exilé courait à la recherche de lui-même, à la poursuite de sa propre image et de sa propre jeunesse, et il ne se retrouve pas. Et l'exilé courait aussi à la recherche de sa patrie, et maintenant qu'elle est retrouvée il ne la reconnaît plus. Ulysse, Pénélope, Ithaque : chaque être, à chaque instant, devient par altération un autre que lui-même, et un autre que cet autre. Infinie est l'altérité de tout être, universel le flux insaisissable de la temporalité. C'est cette ouverture temporelle dans la clôture spatiale qui passionne et pathétise l'inquiétude nostalgique. Car le retour, de par sa durée même, a toujours quelque chose d'inachevé : si le Revenir renverse l'aller, le « dédevenir », lui, est une manière de devenir; ou mieux : le retour neutralise l'aller dans l'espace, et le prolonge dans le temps ; et quant au circuit fermé, il prend rang à la suite des expériences antérieures dans une futurition ouverte qui jamais ne s'interrompt: Ulysse, comme le Fils prodigue, revient à la maison transformé par les aventures, mûri par les épreuves et enrichi par l'expérience d'un long voyage. [...] Mais à un autre point de vue le voyageur revient appauvri, ayant laissé sur son chemin ce que nulle force au monde ne peut lui rendre : la jeunesse, les années perdues, les printemps perdus, les rencontres sans lendemain et toutes les premières-dernières fois perdues dont notre route est semée.
Extrait du texte. Vladimir Jankélévitch, L'Irréversible et la Nostalgie, 1983.