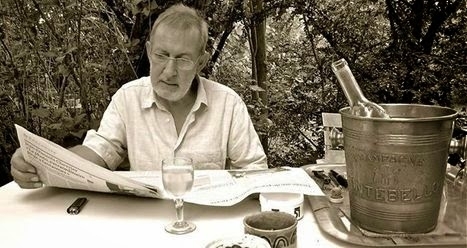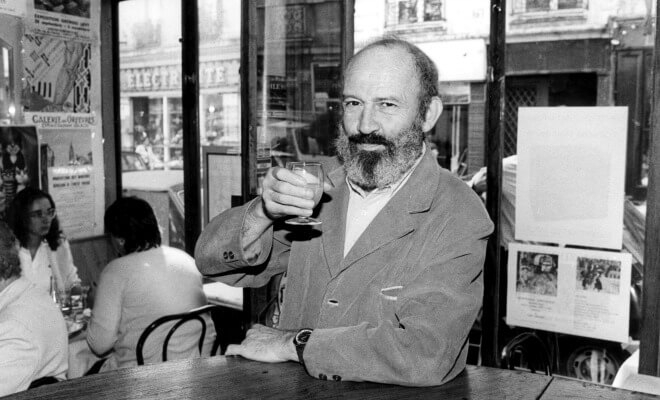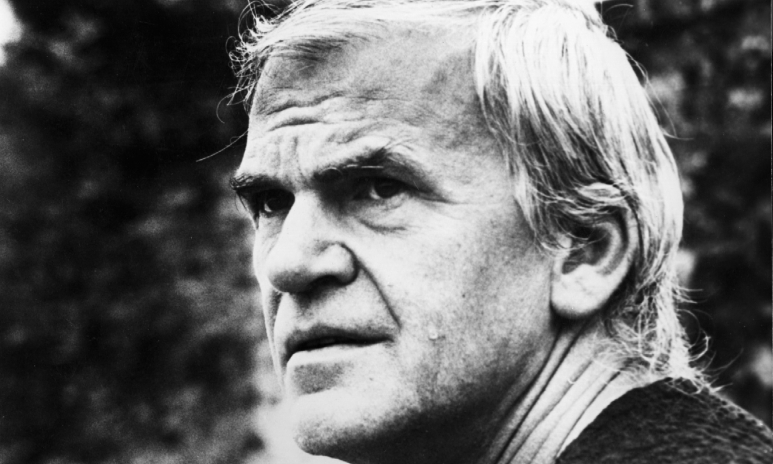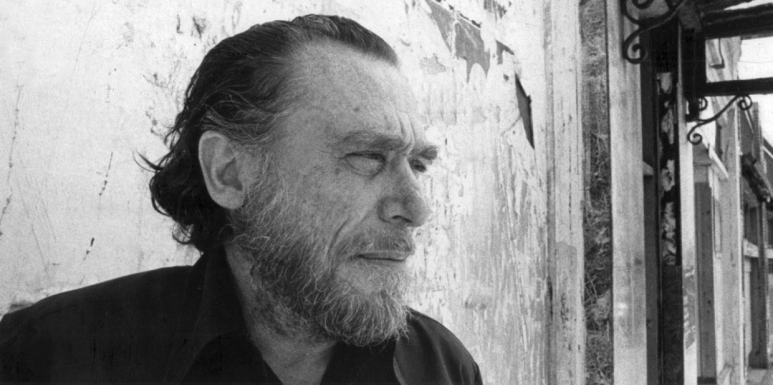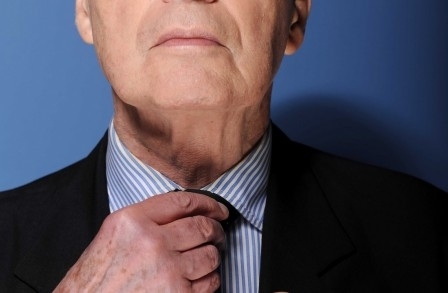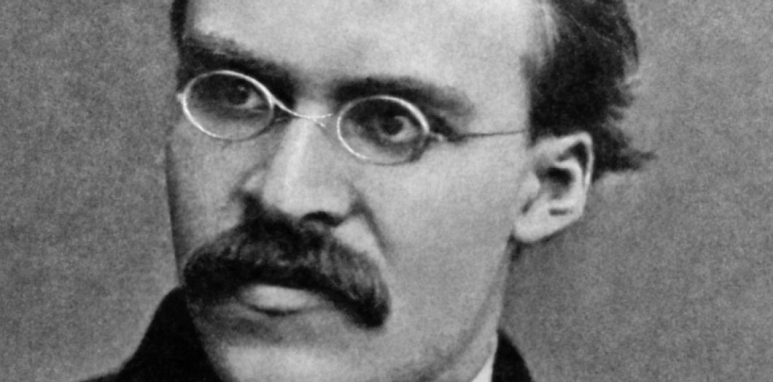À table avec Maryline Desbiolles : « On peut voir mes romans comme des digressions que j’essaie d’ordonner »

Écrivain et poète de l’arrière-pays niçois, je connais les romans et recueils de poésie de Maryline Desbiolles, et également l'auteur personnellement depuis au moins vingt ans. Elle fut d'abord mon professeur de lettres au lycée, avant de publier sans aucun fracas un premier roman Une femme de rien (Mazarine, 1987) qui m'avait impressionné et marqué, alors que je n'étais encore qu'un adolescent. Il aura fallu attendre un peu plus de dix ans, et la parution de son roman La Seiche (Seuil, 1998) pour voir cette oeuvre connaître un succès modeste mais encourageant sur la scène littéraire française. Depuis, Maryline Desbiolles publie à une belle cadence, au moins un roman par an, et tous prennent place dans la région du sud-est, épousant les couleurs et les senteurs d’une terre baignée de la lumière du soleil, du ciel bleu azur, et de la mer méditerranée. Depuis son subtil roman La seiche (Seuil, 1998), ses récits se font à partir de souvenirs, d’images de la mémoire, qui s’imbriquent, se superposent, comme autant de variations. Maryline Desbiolles est l’écrivain de l’errance, des déambulations de la mémoire, la voyageuse au long cours des moments éphémères, fugaces, discrets, se faufilant entre les personnages qui peuplent sa vie, hommes, femmes, artistes, grands-parents, et les occasions sont nombreuses de saisir les instants les plus fugitifs qui donnent soudain, sous sa plume, du sens à la vie. Cet entretien est paru dans la revue littéraire Boojum. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.